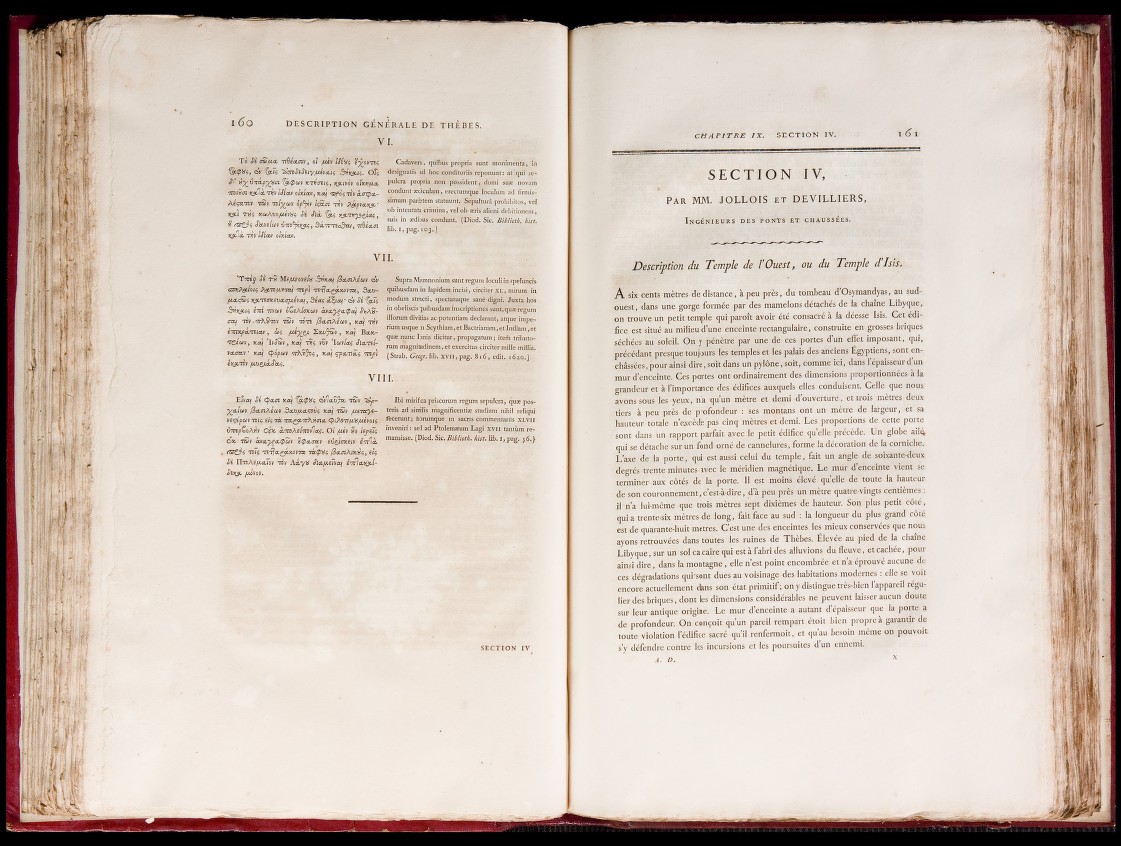
I 60 D E S C R I P T IO N GÉNÉRAL E DE THÉBES.
V I .
T o a tó fxd i r tQ é o u n v , 01 / u ì v ÌM \f:é é ^ o v t e s
&v /&7$ ^7n>StSiiy/uéva,iç O%
<JV v i n t p ^ y c n ^L (p c» v K a i m t , xjlivov o iw / x a ,
'ItDl'ÓGl t& ì * TTJV iJ ic t» o r n a i ', x,etj 'Zdfoc, TOV OL0TpcL-
ASçZLTdV TOV TB/^CiV f y ^ V / ç S a i T>JV P&pVcLiyL’
HSLi T»$ jcü iA u o ^ o e v ^ <Té «JYct v&'tviysçj.cLç,,
>1' / t ï r ç i ç S ù v e ic û v v m ^ x s ^ y 3 < t7 r ,7 îa5B £/, TtSécctn
X&lcL tjjV < JW o ìy ja v .
C a d a v e r a , qu ibu s p ro p r ia sun t m o n iin en ta , in
d e sign a r is ad h oc co n d ito riis re p o n u n t : a t q u i s e -
p u lc ra p ro p r ia n o n p o s s id e n t , d omi sua: novain
con d u n t aediculain, e re ctuinque Ioculuin ad firmis-
simum p a rie tem statuunt. S ep u ltu rà p ro h ib ito s, v e l
ob in tenta ta c r iin in a , v e l ob zeris a lien i d e b itio n em ,
suis in zedibus condunt. (D io d . S ic . Biblioth, hìst:
Iib . 1 , p a g . 103 . )
'T t t e p S ì r S MfyWovg/« SvKctf ßctmAeav cIv
am)A&ioiÇ A s/nv/Amaj v rz f) rn rrJcL^cKùV7rt, dcLV-
/XcLq&S XjLTé<nt£VcLGfA£Vcq, décLÇ X^letf * &V SÌ
•9w w $ £7n TivotìV ó^gA/tncwv ctMcLWcctpaj S ìiA S -
OVLf 70 V .* 7 ?A § 7 I3 V T O V T O T S ßcLOlASUV, KCtj 77JV
g 7 z ix fa .'t t t c t v , ¿ ) $ S x î / J S 'V > B c t x . -
$ & h f ë S X â ) ’ iV iT b lV , JCflq 7 1 ?$ Vt»V ’ l a v f d ç tfï GLTiÎ~
VcLOZtV • i c a ) * 7 , X.ce) ç ^ c tT ÏC C Ç TT Ejs)
ixSLTVY IàMÇJ.LS'Hj Ç,.
Su p ra M em n on ium sun t re gum lo cu li in sp e lun c is
quibusdam in Iapidein in c is i, c irc iter x l ~, inirum in
modum s t ru c t i, sp e cta tuque san è d ig n i. Ju x t a hos
in ob e lisc is quibiisd a in in sc rip tion e s sunt, quze re gum
illo rum divitia s a c p o ten tiam dé c la ran t, atq ue im p e rium
usq ue in S c y th ia in , e t B a c trian am , e t In d ia n i, e t
qusc n u n c Io n ia d ic itu r , p rop ag a tum ; item trib uto-
rum m a gn itu d in em , e t e x e rcitus c irc iter mille m illia .
( S tra b . Geogr. Iib . x v i i , p a g . 8 1 6 , ed it. 1 6 2 0 . )
V i l i .
EÌvcq SÌ tycLOl )caj f(g.<p'ii$ <&1clv%c, t o v " ^ o - I b i m irifica priscorum re gum se p u lc ra , qua: p o s-
% c u a v ßcLolAecov 3 clv/aclsdv$ kcl} t o v / J J c T tty i- te n s ad similis magnificentize Studium nihil re liqui
Vg^Eooiv t 01$ g/$ t o TüL^-'7fKy\oi(L Cj>iA97//x.i^d€Vo/$ fe c e ru n t ; horumque in sac ris commen tariis XLVII
v7rep£oAvv Q p t LTmAeiTCOvìcts. O / ¡uèv kv k f s 7$ Inven*” : sec* a(* Ptolemaeum L a g i x v i i tantum r e -
¿ * . r a t etpeumv « ¡ e tW » . f a l l mm™ e- (D io d - S ic . Bìblhth. hist. lib . i , p a g . ¡6 . }
W $ te t?c t^ jcxo vTO t o 0 V $ /3ct(nA/xH$, e/$
S ì H toA € /a.<u o v to v A c ty tf SlcLy.e7vcLf éTcìcux^i-
& Ì & /U 0V 0 V .
S E C T IO N IV
S EC T ION IV,
P a r MM. JO L L O I S e t D E V I L L I E R S ,
I n g é n i e u r s d e s p o n T s e t c h a u s s é e s .
Description du Temple de l Ouest, ou du Temple d Isis.
A six cents mètres de distance, à peu près, du tombeau d’Osymandyas, au sud-
ouest, dans une gorge formée par des mamelons détaches de la chaîne Libyque,
on trouve un petit temple qui paroît avoir été consacré a la deesse Isis. Cet édifice
est situé au milieu d’une enceinte rectangulaire, construite en grosses briques
séchées au soleil. On y pénètre par une de ces portes dun effet imposant, qui,
précédant presque toujours les temples et les palais des anciens Égyptiens, sont enchâssées
, pour ainsi dire, soit dans un pylône, soit, comme ici, dans 1 épaisseur d un
mur d’enceinte. Ces portes ont ordinairement des dimensions proportionnées à la
grandeur et à l’importance des édifices auxquels elles conduisent. Celle que nous
avons sous les yeux, n’a qu’un mètre et demi d’ouverture, et trois mètres deux
tiers à peu près de profondeur : ses montans ont un mètre de largeur, et sa
hauteur totale n’excède pas cinq mètres et demi. Les proportions de cette porte
sont dans un rapport parfait avec le petit édifice qu’elle précède. Un globe ail4
qui se détache sur un fond orné de cannelures, forme la décoration de la corniche.
L ’axe de la porte, qui est aussi celui du temple, fait un angle de soixante-deux
degrés trente minutes avec le méridien magnétique. Le mur d enceinte vient se
terminer aux côtés de la porte. Il est moins élevé qu’elle de toute la hauteur
de son couronnement, c’est-à-dire, d’à peu près un mètre quatre-vingts centièmes :
il n’a lui-même que trois mètres sept dixièmes de hauteur. Son plus petit côté,
quia trente-six mètres de long, fait face au sud : la longueur du plus grand côté
est de quarante-huit mètres. C’est une des enceintes les mieux conservées que nous
ayons retrouvées dans toutes les ruines de Thèbes. Élevée au pied de la chaîne
Libyque, sur un sol calcaire qui est à l’abri des alluvions du fleuve, et cachée, pour
ainsi dire, dans la montagne , elle n’est point encombrée et n’a éprouvé aucune de
ces dégradations qui'sont dues au voisinage des habitations modernes : elle se voit
encore actuellement dans son état primitif ; on y distingue très-bien l’appareil régulier
des briques, dont les dimensions considérables ne peuvent laisser aucun doute
sur leur antique origine. Le mur d’enceinte a autant d’épaisseur que la porte a
de profondeur. On conçoit qu’un pareil rempart étoit bien propre a garantir de
toute violation l’édifice sacré qu’il renfennoit, et quau besoin même on pouvoit
s’y défendre contre les incursions et les poursuites d un ennemi.
A . D . X