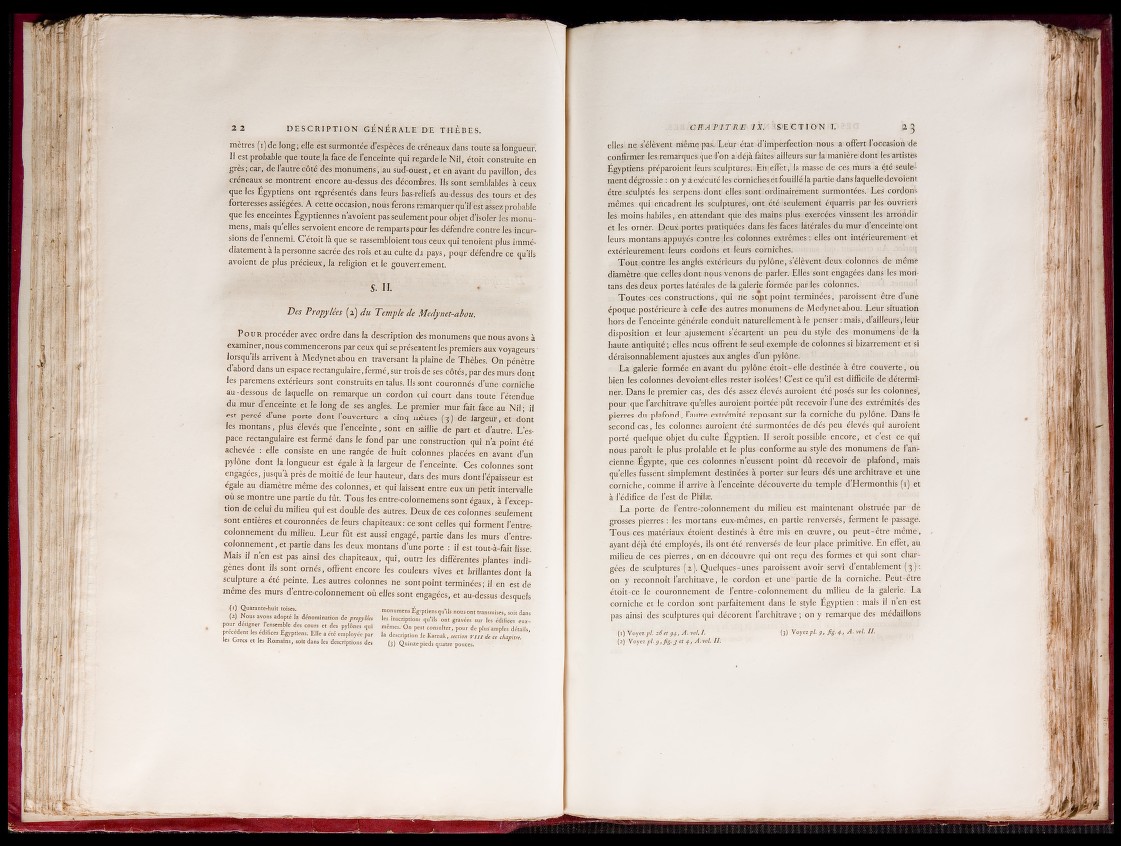
métrés (i)<Ie long; elle est surmontée d espèces de créneaux dans toute sa longueur.
II est probable que toute.la face de 1 enceinte qui regarde le Nil, étoit construite en
grès ; car, de I autre côté des monumens, au sud-ouest J et en avant du pavillon, des
créneaux se montrent encore au-dessus des décombres. Us sont semblables à ceux
que les Egyptiens ont représentes dans leurs bas-reliefs au-dessus des tours et des
forteresses assiégées. A cette occasion, nous ferons remarquer qu’il est assez probable
que les enceintes Égyptiennes n’avoient pas seulementpour objet d’isoler les monumens,
mais qu’elles servoient encore de rempartspour les défendre contre les incursions
de 1 ennemi. C étoit là que se rassembloient tous ceux qui tenoient plus immédiatement
a la personne sacree des rois et au culte du pays, pour défendre ce qu’ils
avoient de plus precieux, la religion et le gouvernement.
S- I I .
Des Propylées (2) du Temple de Medynet-abou.
P our procéder avec ordre dans la description des monumens que nous avons à
examiner, nous commencerons par ceux qui se présentent ies premiers aux voyageurs ’
lorsqu’ils arrivent à Medynet-abou en traversant la plaine de Thèbes. On pénètre
d abord dans un espace rectangulaire, fermé, sur trois de ses côtés, par des murs dont
les paremens extérieurs sont construits en talus. Ils sont couronnés d’une corniche
au-dessous de laquelle on remarque un cordon qui court dans toute letendue
du mur d enceinte et le long de ses angles. Le premier mur fait face au Nil; il
est percé d’une porte dont l’ouverture a cinq mètres (3) de largeur, et dont
les montans, plus élevés que l’enceinte, sont en saillie de part et d’autre. L espace
rectangulaire est fermé dans le fond par une construction qui n’a point été
achevée : elle consiste en une rangée de huit colonnes placées en avant d’un
pylône dont la longueur est égale à la largeur de l’enceinte. Ces colonnes sont
engagées, jusqu a près de moitié de leur hauteur, dans des murs dont l’épaisseur est
égale au diamètre même des colonnes, et qui laissent entre eux un petit intervalle
où se montre une partie du fût. Tous les entre-colonnemens sont égaux, à l’exception
de celui du milieu qui est double des autres. Deux de ces colonnes seulement
sont entières et couronnées de leurs chapiteaux: ce sont celles qui forment l'entre,-
colonnement du milieu. Leur fût est aussi engagé, partie dans les murs d’entre-
colonnement, et partie dans les deux montans d’une porte : il est tout-à-fait lisse.
Mais il n’en est pas ainsi des chapiteaux, qui, outre les différentes plantes indigènes
dont ils sont ornés, offrent encore les couleurs vives et brillantes dont la
sculpture a été peinte. Les autres colonnes ne sont point terminées; il en est de
même des murs d’entre-colonnement où elles sont engagées, et au-dessus desquels
(1) Quarante-huit toises. monumens Égyptiens qu'ils nous ont transmises, soit dans
(2) Nous avons adopte la dénomination de propylée, les inscriptions qu'ils ont gravées sur les édifices eur-
pour desIgner Iensemble des cours et des pylônes qui mêmes.'On peut consulter, pour de plus amples détails,
precedent les édifices Egyptiens. Elle a été employée par la description de Karnak, section v i n de ce chapitre.
les Grecs et les Romains, soit dans les descriptions des (3) Quinze pieds quatre pouces.
elles ne s'élèvent même pas. Leur état d’imperfection nous a offert l’occasion de
confirmer les remarques que l'on a déjà faites ailleurs sur la manière dont les artistès
Égyptiens préparaient leurs sculpturas.Tn effet, la masse de ces murs a été seulement
dégrossie : on y a exécuté les corniches et fouillé la partie dans laquelle dévoient
être sculptés les serpens dont eIles:sont.ordinairement surmontées. Les cordons
mêmes, qui encadrent les sculptures, ont été'seulement équarris par les ouvriers
les moins habiles, en attendant qüe des mains plus exercées vinssent les arrondir
et les orner. Deux portes pratiquées dans les faces latérales du mur d’enceinte ont
leurs montans appuyés contre les’ colonnes extrêmes: elles ont intérieurement et
extérieurement leurs cordons et leurs corniches.
Tout contre les angles extérieurs du pylône, s’élèvent deux colonnes de même
diamètre que celles dont iious venons de parler. Elles sont engagées dans les mori-
tans des deux portes latérales de la galerie formée par Içs colonnes.
Toutes ces constructions, qui ne sopt point terminées, paraissent être d’une
époque postérieure à celle des autres monumens de Medynet-abou. Leur situation
hors de l’enceinte générale conduit naturellement à le penser ; mais, d’ailleurs, leur
disposition et leur ajustement s’écartent un peu du style des monumens de la
haute antiquité; elles nous offrent le seul exemple de colonnes si bizarrement et si
déraisonnablement ajustées aux angles d’un pylône.
La galerie formée en avant du pylône étoit-elle destinée à être couverte, ou
bien les colonnes devoient-elles rester isolées î C’est ce qu’il est difficile de déterminer.
Dans le premier cas, des dés assez élevés auraient été posés sur les colonnes1,
pour que l’architrave qu’elles auraient portée pût recevoir l’une des extrémités des
pierres du plafond, l’autre extrémité reposant sur la corniche du pylône. Dans le
second cas, les colonnes auroient été surmontées de dés peu élevés qui auraient
porté quelque objet du culte Égyptien. Il serait possible encore, et c’est ce qui
nous paraît le plus probable et le plus conforme au style des monumens de l'aria
eienne Égypte, que ces colonnes n’eussent point dû recevoir de plafond, mais
qu’elles fussent simplement destinées à porter sur leurs dés une architrave et une
corniche, comme il arrive à l’enceinte découverte du temple d’Hermonthis (i) et
à l’édifice de l’est de Philæ.
La porte de l’entre-colonnement du milieu est maintenant obstruée par dè
grosses pierres : les montans eux-mêmes, en partie renversés, ferment le passage.
Tous ces matériaux étoient destinés à être mis en oeuvre, ou peut - être même,
ayant déjà été employés, ils ont été renversés de leur place primitive. En effet, au
milieu de ces pierres, on en découvre qui ont reçu des formes et qui sont chargées
de sculptures (2). Quelques-unes paraissent avoir servi d’entablement (3 ) :
on y reconnoît l’architrave, le cordon et une partie de la corniche. Peut-être
étoit-ce le couronnement de l’entre-colonnement du milieu de la galerie. La
corniche et le cordon sont parfaitement dans le style Égyptien : mais il n en est
pas ainsi des sculptures qui décorent l’architrave ; on y remarque des médaillons
(1) Voyez pl. 26 et 9 4 , A . val. 1. (3) Voyez pl. j/, fig. +, A . val. II.
(2) Voyez pl. (fjfig 'J et 4 , A . vol. II.