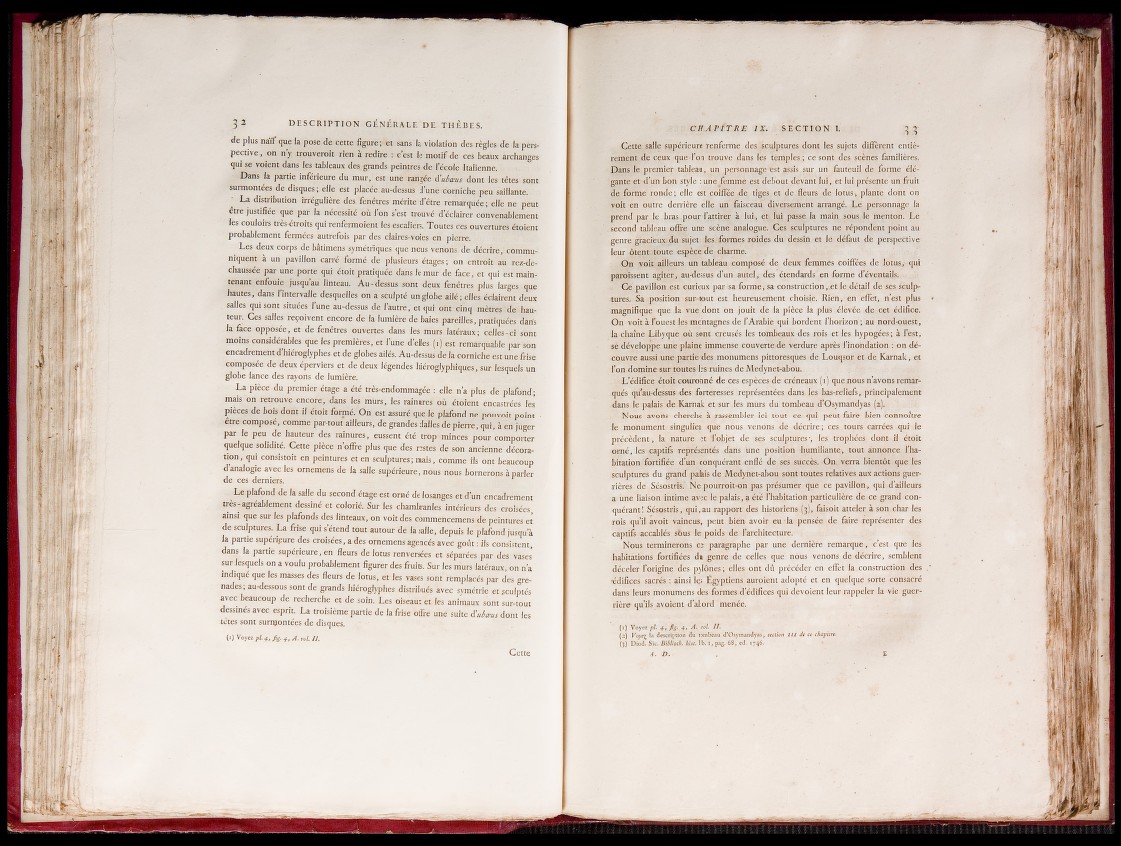
32 “>
de plus naïf que la pose de cette figure; et sans la violation des règles de la perspective
, on n y trouverait rien à redire : c est le motif de ces beaux archanges
qui se voient dans les tableaux des grands peintres de ¡’école Italienne.
Dans la partie inférieure du mur, est une rangée A'uboeus dont les têtes sont
surmontées de disques; elle est placée au-dessus d'une corniche peu saillante.
• La distribution irrégulière des fenêtres mérite d’être remarquée ; elle ne peut
etre justifiée que par la nécessité où l’on s’est trouvé d’éclairer convenablement
les couloirs très-étroits qui renfermoient les escaliers. Toutes ces ouvertures étoient
probablement fermées autrefois par des claires-voies en pierre.
Les deux corps de bâtimens symétriques que nous venons de décrire, communiquent
a un pavillon carré formé de plusieurs étages; on entrait au rez-de-
chaussée par une porte qui étoit pratiquée dans le mur de face, et qui est maintenant
enfouie jusqu’au linteau. Au-dessus sont deux fenêtres plus larges que
hautes, dans l’intervalle desquelles on a sculpté un globe ailé ; elles éclairent deux
salles qui sont situées l’une au-dessus de l’autre, et qui ont cinq mètres de hauteur.
Ces salles reçoivent encore de la lumière de baies pareilles, pratiquées darfs
la face opposée, et de fenêtres ouvertes dans les murs latéraux; celles-ci sont
moins considérables que les premières, et l’une d’elles (i) est remarquable par son
encadrement d’hiéroglyphes et de globes ailés. Au-dessus de la corniche est une frise
composée de deux éperviers et de deux légendes hiéroglyphiques, sur lesquels un
globe lance des rayons de lumière.
La pièce du premier étage a été très-endommagée : elle n’a plus de plafond;
mais on retrouve encore, dans les murs, les rainures où étoient encastrées les
pièces de bois dont il étoit formé. On est assuré que le plafond ne pouvoit point
être composé, comme par tout ailleurs, de grandes dalles de pierre, qui, à en juger
par le peu de hauteur des rainures, eussent été trop minces pour comporter
quelque solidité. Cette pièce n offre plus que des restes de son ancienne décoration,
qui consistoit en peintures et en sculptures; mais, comme ils ont beaucoup
d analogie avec les ornemens de la salle supérieure, nous nous bornerons à parler
de ces derniers.
Le plafond de la salle du second étage est orné de losanges et d’un encadrement
très - agréablement dessiné et colorié. Sur les chambranles intérieurs des croisées
ainsi que sur les plafonds des linteaux, on voit des commencemens de peintures et
de sculptures. La frise qui s’étend tout autour de la salle, depuis le plafond jusqu’à
la partie supérieure des croisées, a des ornemens agencés avec goût : ils consistent,
dans la partie supérieure, en fleurs de lotus renversées et séparées par des vases
sur lesquels on a voulu probablement figurer des fruits. Sur les murs latéraux, on n’a
indiqué que les masses des fleurs de lotus, et les vases sont remplacés par des grenades;
au-dessous sont de grands hiéroglyphes distribués avec symétrie et sculptés
avec beaucoup de recherche et de soin. Les oiseaux et les animaux sont sur-tout
dessinés avec esprit. La troisième partie de la frise offre une suite d’uboeus dont les
têtes sont surmontées de disques.
(i) Voyez pl. 4 , fig. g , A . vol. II.
Cette
Cette salle supérieure renferme des, sculptures dont les sujets diffèrent entièrement
de ceux que l’on trouve dans les temples; ce sont des scènes familières.
Dans le premier tableau, un personnage •fest assis sur un fauteuil de forme élégante
et d’un bon style : une femme est debout devant lui, et lui présente un fruit
de forme ronde; elle est coiffée de tiges et de fleurs de lotus, plante dont on
voit en outre derrière elle un faisceau diversement arrangé. Le personnage la
prend par le bras pour l’attirer à lui, et lui passe la main sous le menton. Le
second tableau offre une scène analogue. Ces sculptures ne répondent point au
genre gracieux du sujet; les formes roides du dessin et le défaut de perspective
leur ôtent toute espèce de charme.
On voit ailleurs un tableau composé de deux femmes coiffées de lotus, qui
paraissent agiter, au-dessus d’un autel, des étendards en forme d’éventails:
Ce pavillon .est curieux par sa fonne, sa construction,.et le détail de ses sculptures.
Sa position sur-tout est heureusement choisie. Rien, en effet, n’est plus «
magnifique que la vue dont on jouit de la pièce la plus élevée de cet édifice.
On voit à l’ouest les montagnes de l’Arabie qui bordent l’horizon ; au nord-ouest,
la chaîne Libyque où sont creusés les tombeaux des rois et les hypogées; à l’est,
sè développe une plaine immense couverte de verdure après l’inondation : on découvre
aussi une partie des monumens pittoresques de Louqsor et de Karnak, et
l’on domine sur toutes les ruines de Medynet-abou.
L ’édifice étoit couronné de ces espèces de créneaux (1) que nous n’avons remarqués
qu’au-dessus des forteresses représentées dans les bas-reliefs, principalement
dans le palais de Karnak et sur les murs du tombeau d’Osymandyas (2).
Nous avons cherché à rassembler ici tout ce qui peut faire bien connoitre
le monument singulier que nous venons de décrue ; ces tours carrées qui le
précèdent, la nature et l’objet de ses sculptures-, les trophées dont il étoit
orné, les captifs représentés dans une position humiliante, tout annonce l’habitation
fortifiée d’un conquérant enflé de ses succès. On verra bientôt que les
sculptures du grand palais de Medynet-abou sont toutes relatives aux actions guerrières
de Sésostris." Ne pourroit-on pas présumer que ce pavillon, qui d’ailleurs
a une liaison intime avec le palais, a été l’habitation particulière de ce grand conquérant!
Sésostris, qui, au rapport des historiens (3), faisoit atteler à son char les
rois qu’il avoit vaincus, peut bien avoir eu la pensée de faire représenter des
captifs accablés sbus le poids de l’architecture.
Nous terminerons ce paragraphe par une dernière remarque, c’est que les
habitations fortifiées du genre de celles que nous venons de décrire, semblent
déceler l’origine des pylônes; elles ont dû précéder en effet la.construction des
•édifices sacrés : ainsi les Égyptiens auraient adopté et en quelque sorte consacré
dans leurs monumens des formes d’édifices qui devoient leur rappeler la vie guerrière
qu’ils avoient d’abord menée.
(1) Voyez pl. 4., Jig., 4 , A . vol. II.
(2) Voye^ la description du tombeau, d’Osymandyas, section I I I de ce chapitre.
(3) Diod. Sic. Biblioth. hist. lib. i , pag. 68, ed. 1746.
A. D . . E