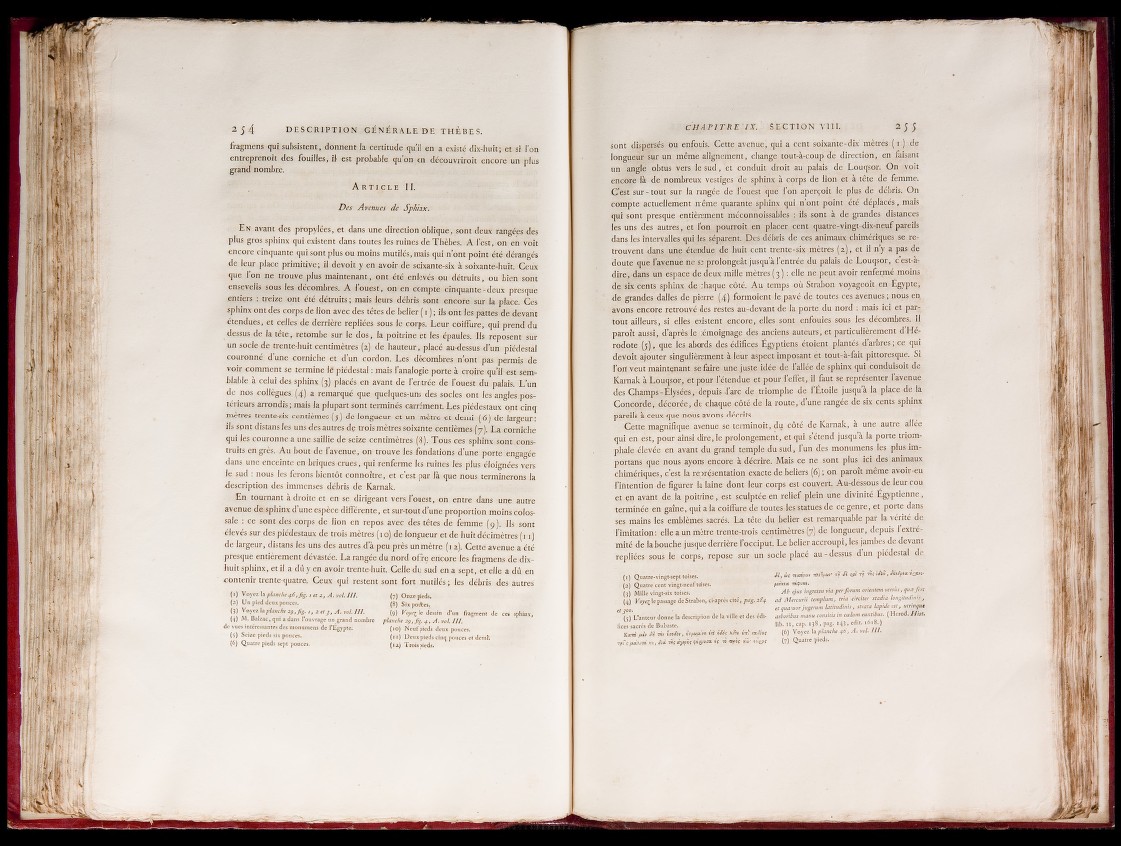
fragmens qui subsistent, donnent la certitude qu’il en a existé dix-huit; et si l'on
entreprenoit des fouilles, il est probable quon en découvriroit encore un plus
grand nombre.
A r t i c l e II.
Des Avenues de Sphinx.
E n avant des propylces, et dans une direction oblique, sont deux rangées des
plus gros sphinx qui existent dans toutes les ruines de Thèbes. A lest, on en voit
encore cinquante qui sont plus ou moins mutilés, mais qui n’ont point été dérangés
de leur place primitive; il devoit y en avoir de soixante-six à soixante-huit. Ceux
que l’on ne trouve plus maintenant, ont été enlevés ou détruits, ou bien sont
ensevelis sous les décombres. A l’ouest, on en compte cinquante-deux presque
entiers | treize ont été détruits ; mais leurs débris sont encore sur la place. Ces
sphinx ont des corps de lion avec des têtes de belier ( i ) ; ils ont les pattes de devant
étendues, et celles de derrière repliées sous le corps. Leur coiffure, qui prend du
dessus de la tête, retombe sur le dos, la poitrine et les épaules. Ils reposent sur
un socle de trente-huit centimètres (2) de hauteur, placé au-dessus d’un piédestal
couronné d’une corniche et d’un cordon. Les décombres n’ont pas permis de
voir comment se termine lé piédestal : mais l’analogie porte à crpire qu’il est semblable
à celui des sphinx (3) placés en avant de l’entrée de l’ouest du palais. L ’un
de nos collègues (4) a remarqué que quelques-uns des socles ont les angles postérieurs
arrondis; mais la plupart sont terminés carrément. Les piédestaux ont cinq
mètres trente-six centièmes (5) de longueur et un mètre et demi (6) de largeur:
ils spnt distans les uns des autres dç trois mètres soixante centièmes (7). La corniche
qui les couronne a une saillie de seize centimètres (8). Tous ces sphinx sont .construits
en grès. Au bout de l’avenue, on trouve les fondations d’une porte engagée
dans une enceinte en briques crues, qui renferme les ruines les plus éloignées vers
le sud : nous les ferons bientôt connoître, et c’est par là que nous terminerons la
description des immenses débris de Karnak.
En tournant à droite et en se dirigeant vers l’ouest, on entre dans une autre
avenue de sphinx d’une espèce différente, et sur-tout d’une proportion moins colossale
: ce sont des corps de lion en repos avec des têtes de femme (9). Ils sont
élevés sur des piédestaux de trois mètres (t o) de longueur et de huit décimètres (i i )
de largeur, distans les uns des autres d’à peu près un mètre (12). Cette avenue a été
presque entièrement devastee. La rangée du nord offre encore les fragmens de dix-
huit sphinx, et il a dû y en avoir trente-huit. Celle du sud en a sept, et elle a dû en
contenir trente-quatre. Ceux qui restent sont fort mutilés ; les débris des autres'
( 0 Voyez la planche 4 6 , fig. a 2 , A . vol. I I I . (7) Onze pieds.
(2) Un pied deux pouces. (8) Six poifces.
(5) Voyez \n planche Z ÿ ,fg . / , 2 e t j , A . vol. I I I . (9) Voyc^ le dessin d'un fragment de ces sphinx,
(4) M. Balzac, qui a dans l’ouvrage un grand nombre planche 2 p ,p g . 4 , A . vol. I I I ,
de vues intéressantes des monument de l'Egypte. (10) Neuf pieds deux pouces.
(5) Seize pieds six pouces. ( , , ) Deux pieds cinq pouces et demi;
(6) Quatre pieds sept pouces. (sa) Troispieds.
sont dispersés Ou enfouis. Cette avenue, qui a cent soixante-dix mètres ( i ) de
longueur sur un même alignement, change tout-à-coup de direction, en faisant
un angle obtus vers le sud, et conduit droit au palais de Louqsor. On voit
encore là de nombreux vestiges de sphinx à corps de lion et à tête de femme.
C’est sur-tout sur la rangée de l’ouest que l’on aperçoit le plus de débris. On
compte actuellement même quarante sphinx qui n’ont point été déplacés, mais
qui sont presque entièrement méconnoissables : ils sont à de grandes distances
les uns des autres, et l’on pourroit en placer cent quatre-vingt-dix-neuf pareils
dans les intervalles qui les séparent. Des débris de ces animaux chimériques se retrouvent
dans une étendue de huit cent trente-six mètres (2), et il n’y a pas de
doute que l’avenue ne se prolongeât jusqu’à l’entrée du palais de Louqsor, c est-a-
dire, dans un espace de deux mille mètres(3) : elle ne peut avoir renfeçmé moins
de six cents sphinx de chaque côté. Au temps où Strabon voyageoit en Egypte,
de grandes dalles de pierre (4) formoient le pavé de toutes ces avenues ; nous en
avons encore retrouvé des restes au-devant de la porte du nord : mais ici et partout
ailleurs, si elles existent encore, elles sont enfouies sous les décombres. Il
paroît aussi, d’après le témoignage des anciens auteurs, et particulièrement d Hérodote
(y), que les abords des édifices Égyptiens étoient plantés d arbres; ce qui
deVoit ajouter singulièrement à leur aspect imposant et tout-a-fait pittoresque. Si
fort veut maintenant se faire une juste idée de 1 allée de sphinx qui conduisoit de
Karnak à Louqsor, et pour l’étendue et pour l’effet, il faut se représenter 1 avenue
des Champs-Elysées, depuis -l’arc de triomphe de ¡Étoile jusqua la place de la
Concorde, décorée, de chaque côté de la route, dune rangée de six cents sphinx
pareils à ceux que nous avons décrits.
Cette magnifique avenue se terminoit, du côté de Karnak, a une autre allée
qui en est, pour ainsi dire, le prolongement, et qui s étend jusqu a la porte triomphale
élevée en avant du grand temple du sud, lun des monumens les plus im-
portans que nous ayons encore à décrire. Mais ce ne sont plus ici des animaux
chimériques, c’est la représentation exacte de beliers (6) ; on paroît meme avoir -eu
l’intention de figurer la laine dont leur corps est couvert. Au-déssous de leur cou
et çn avant de la poitrine, est sculptée en relief plein une divinité Égyptienne,
terminée en gaine, qui a la coiffure de toutes des statues de ce genre, et poite dans
ses mains les emblèmes sacrés. La tête du belier est remarquable par la vérité de
Limitation: elle a un mètre trente-trois centimètres (7) de longueur, depuis 1 extrémité
de la bouche jusque derrière l’occiput. Le belier accroupi, les jambes de devant
repliées sous le corps, repose sur un socle placé au - dessus d un piédestal de
( 1 ) Quatre-vingt-sept toises. R , “ f ■*«>>“ ' * » V » ' R * “ T? ï£s" " '
(2) Quatre cent vingt-neuf toises. /xnx.ta Tnçvxt. (
(3) Mille vingt-six toises. A b ejus ingressu via perforum orientem versus, quoefirt
(4) V°y*l le passage de Strabon, ci-après cité, pag. 284 ad Mercurii templum, tria circiter stadia longitudims,
_ ¿t quatuor jugerum latitudinis , strata lapide est, utrinqut
(5) L’auteur donne la description de la ville et des édi- arboribus manu consitis in coelum euntibus. ( Herod. Hist.
lices sacrés de Bubaste. ' lib. I l , cap. 13 8 , pag. 143. edit. l 6 ,8 )
KaTO /ttV <Aî m ïmJbv, içpoputyn tti é<fo'ç a/0k eV' çaJÎvc (6) Voyez la planche 4 0 , A . vol. I I I . _
TfCç /uaMçd xh , <h& ’nçeèyipnç iç 7i <a>f>oç nu' (7) Quatre pieds.