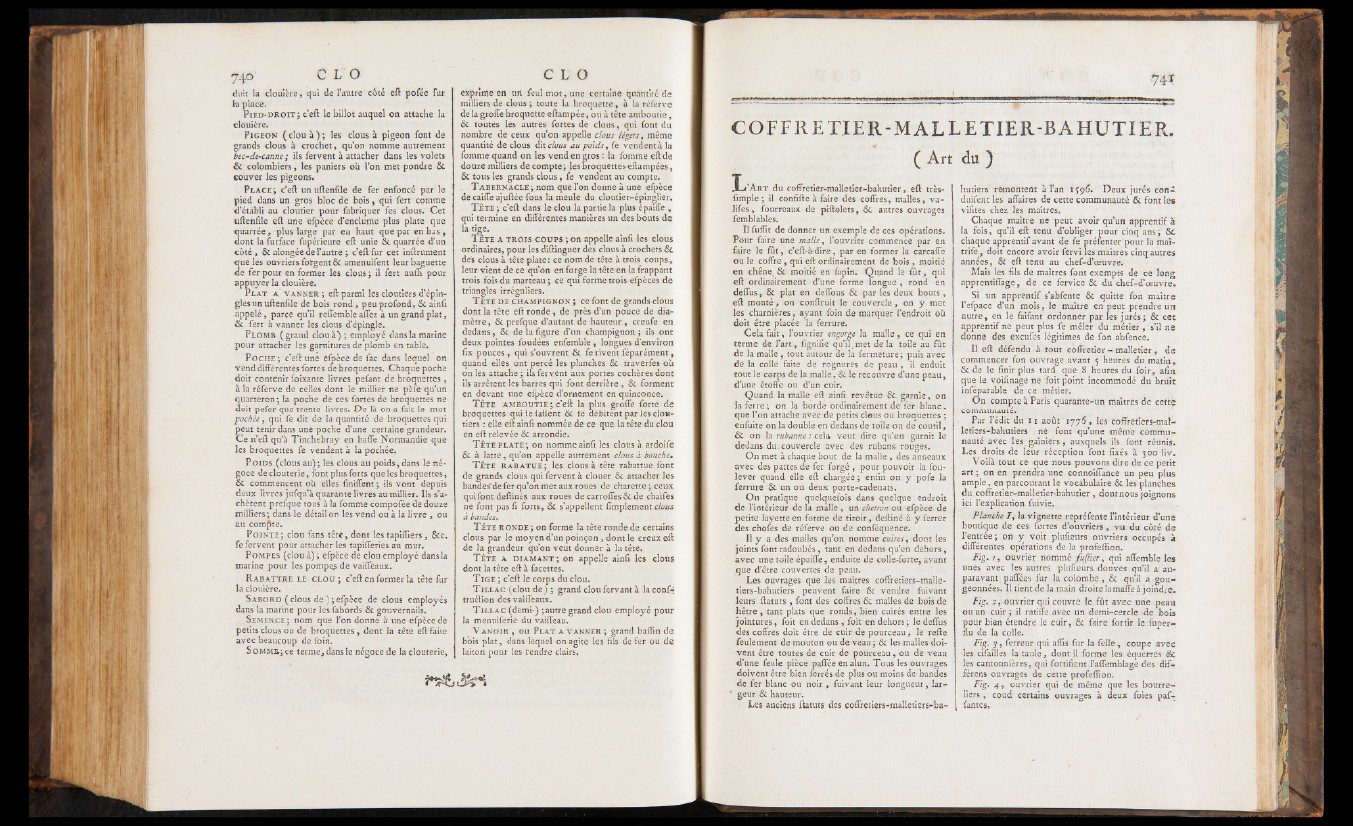
7401 C L O
duit la clouière, qui de l’autre côté eft pofée fur
la place.
Pied-d r o it ; c’eft le billot auquel on attache la
clouière.
Pigeon ( clou à ) ; les clous à pigeon font de
grands clous à crochet, qu’on nomme autrement
bec-de-canne ; ils fervent à attacher dans les volets
8c colombiers, les paniers où l’on met pondre 6c
couver les pigeons.
Pla c e ; c’eft un uftenfile de fer enfoncé par le
pied dans un gros bloc de bois 9 qui fert comme
«établi au cloutier pour fabriquer fes clous. Cet
uftenfile eft une efpèce d’enclume plus plate que
quarrée | plus large par en haut que par en bas ,
dont la furface fupérieure eft unie 8c quarrée d’un
cô té , 8c alongée de l’autre ; c’eft fur cet inftrument
que les ouvriers forgent 8c amenuifent leur baguette
de fer pour en former les clous ; il fert auffi pour
appuyer la clouière.
Pla t a vanner ; eft parmi les cloutiers d’épingles
un uftenfile de bois rond , peu profond, 8c ainfi
appelé, parce qu’il reffemble affez à un grand plat,
8c fert à vanner les clous d’épingle.
Plomb (grand cloua) ; employé dans la marine
pour attacher les garnitures de plomb en table.
Po ch e ; c’eft une efpèce de fac dans lequel on
vend différentes fortes de broquettes. Chaque poche
doit contenir foixante livres pefant de broquettes ,
à la réferve de celles dont le millier ne pèfe qu’un
quarteron; la poche de ces fortes de broquettes ne
doit pefer que trente livres. De-là on a fait le mot
■ pochée., qui fe dit de la quantité de broquettes qui
peut tenir dans une poche d’une certaine grandeur.
C e n’eft qu’à Tinchebray en baffe Normandie que
les broquettes fe vendent à la pochée.
P oids (clous au); les clous au poids, dans le négoce
de clouterie, font plus forts que les broquettes,
8c commencent où elles finiffent ; 41s vont depuis
deux livres jufqu'à quarante livres au millier. Ils s’achètent
prefque tous à la fomme compofée de douze
milliers ; dans le détail on les vend ou à la livre , ou
au compte.
Pointe; clou fans tête, dont les tapiffiers, 8Cc.
fe fervent pour attacher les tapifferies au mur.
Pompes (clou à) ; efpèce de clou employé dans la
marine pour les pompes de vaiffeaux.
R a battre le clou ; c’eft en former la tête fur
la clouière.
Sabord ( clous de ) ; efpèce de clous employés
dans la marine pour les fabords 8c gouvernails.
Semence; nom que l’on donne à une efpèce de
petits clous ou de broquettes, dont la tête eft faite
avec beaucoup de foin.
Somme»; ce terme, dans le négoce de la clouterie,
C L O
exprime en un feul mot, une certaine quantité 'dé
milliers de clous; toute la broquette, à la réferve
de la groffe broquette eftampée, ou à tête amboutie,
8c toutes les autres fortes de clous, qui font du
nombre de ceux qu’on appelle clous légers, même
quantité de clous dit clous au poids, fe vendent à la
fomme quand on les vend en gros : la fomme eft de
douze milliers de compte; Jesbroquetteseftampées,
8c tous les grands clous, fe vendent au compte.
T abernacle ; nom que l’on donne à une efpèce
de caiffe ajuftée fous la meule du cloutier-épinglier.
T ête ; c’eft dans le clou la partie la plus épaiffe ,
qui termine en différentes manières un des bouts de
la tige.
T ête a trois coups ; on appelle ainfi les clous
ordinaires, pour les diftinguer des clous à crochets 8c
des clous à tête plate : ce nom de tête à trois coups,
leur vient de ce qu’on en forge la tête en la frappant
trois fois du marteau ; ce qui forme trois efpèces de
triangles irréguliers.
T ete de champignon ; ce font de grands clous
dont la tête eft ronde, de près d’un pouce de diamètre
, 8c prefque d’autant de hauteur, creufe en
dedans ^ 8c de la figure d’un champignon ; ils ont
deux pointes foudées enfemble , longues d’environ
fix pouces, qui s’ouvrent 8c fe rivent féparément,
quand elles ont percé.les planches 8c traverfes où
on les attache ; ils fervent aux portes cochères dont
ils arrêtent les barres qui font derrière, 8c forment
en devant une efpèce d’ornement en quinconce.
T ête amboutie ; c’eft la plus groffe forte de
broquettes qui fe faffent 8c fe débitent par les clou-
tiers : elle eft ainfi nommée de ce que/ la tête du clou
en eft relevée 8c arrondie.
T ête plate ; on nomme ainfi les clous à ardoife
8c à latte, qu’on appelle autrement clous à bouche•
T ête r a b a tu e ; les clous à tête rabattue font
de grands clous qui fervent à clouer 8c attacher les
bande^de fer qu’on met aux roues de charette; ceux
qui font deftinés aux roues de carroffes 8c de chaifes
ne font pas fi forts, 8c s’appellent Amplement clous
à bandes.
T ête ronde; on forme la tête ronde de certains
clous par le moyen d’un poinçon, dont le creux eft
de la grandeur qu’on veut donner à la tête.
T ête a d iam an t ; on appelle ainfi les clous
dont la tête eft à facettes.
T ige ; c’eft le corps du clou.
T illac (clou de ) ; grand clou fervant à la confij
truftion des vaiffeaux.
T illac (demi-) ;autre grand clou employé pour
la menuiferie du vàiffeau.
V anoir , ou Plat a vanner ; grand baffin de
bois plat, dans lequel on agite les fils de fer ou de
laiton pour les rendre clairs.
‘7 4 r
COFFRETIER-MALLETIER-BAHUTIER.
( Art
Ï - i’A rt du coffretier-malletier-bahutier, eft très-
fimple; il confifte à faire des coffres, malles, va-
lifes, fourreaux de piftolets, 8c autres ouvrages
femblables.
Il fuffit de donner un exemple de ces opérations.
Pour faire une malle, l’ouvrier commence par en
faire le fût, c’eft-à-dire, par en former la carcaffe
ou le coffre, qui eft ordinairement de bois , moitié
en chênev 8c moitié en fapin. Quand le fût, qui
eft ordinairement d’une forme longue , rond en
deffus, 8c plat en deffous 8c par les deux bouts,
eft monté, on conftruit le couvercle, on y met
les charnières, ayant foin de marquer l’endroit où
doit être placée la ferrure.
Cela fait, l’ouvrier engorge la malle, ce qui en
terme de l’art , fignifie qu'il,met de là toile au fût
de la malle , tout autour de la fermeture; puis avec
de la colle faite de rognures de peau , il enduit
tout le corps de la malle, 8c le recouvre d’une peau,
d’une étoffe ou d’un cuir.
Quand la malle eft ainfi revêtue 8c garnie, on
la ferre ; on la borde ordinairement de fer blanc,
que l’on attache avec de petits clous ou broquettes ;
enfuite on la double en dedans de toile ou de coutil,
8c on la rubanne : cela veut dire qu’on - garnit le
dedans du. couvercle avec des rubans rouges.
On met à chaque bout de la malle , des anneaux
avec des pattes de fer forgé , pour pouvoir la fou-
lever quand elle eft chargée ; enfin on y pofe la
ferrure 8c un ou deux porte-cadenats.
On pratique quelquefois dans quelque endroit
de l’intérieur de la malle , un chetron ou efpèce de
petite layette en forme de tiroir, deftiné à y ferrer !
des chofes de réferve ou de conféquence.
Il y a des malles qu’on nomme cuires, dont les
joints font radoubés , tant en dedans qu’en dehors,
avec une toile épaiffe, enduite de colle-forte, avant ;
que d’être couvertes de peau.
Les ouvrages que les maîtres coffretiers-malle- |
tiers-bahutiers peuvent faire 8c vendre fuivant j
leurs ftatuts , font des coffres 8c malles de bois de |
hêtre , tant plats que ronds, bien cuirés entre les
jointures, foit en dedans , foit en dehors ; le deffus
des coffres doit être de cuir de pourceau, le refte
feulement de mouton ou de veau; 8c les malles doivent
être toutes de cuir de pourceau, ou de veau
d’une feule pièce paffée enalun. Tous les ouvrages
doivent être bien ferrés de plus ou moins de bandes
de fer blanc ou noir, fuivant leur longueur, lar-
‘ geur 8c hauteur.
Les anciens ftatuts des çoffretiers-malletiers-badu
)
hutiers remontent à l’an î $96. Deux jurés cofl-
duifent les affaires de cette communauté 8c font les
vifites chez les maîtres.
Chaque maître ne peut avoir qu’un apprentif à
la fois, qu’il eft tenu d’obliger pour cinq ans ; 8c
chaque apprentif avant de fe préfenter pour la maî-
trife, doit encore avoir fervi les maîtres cinq autres
années, 8c eft tenu au chef-d’oeuvre.
Mais les fils de maîtres font exempts de ce long
apprentiffage, de ce fervice 8c du chef-d’oeuvre#
Si un apprentif s’abfente 8c quitte fon maître
l’efpace d’un mois, le maître en peut prendre un
autre, en le faifant ordonner par les jurés; 8c cet
apprentif ne peut plus fe mêler du métier , s’il ne
donne des excufes légitimes de fon abfence.
Il eft défendu à tout coffretier - malletier, de
commencer fon ouvrage avant 5 heures du matin,
8c de le finir plus tard que 8 heures du foir, afin
que le. voifinage ne foit point incommodé du bruit
inféparable de ce métier.
On compte à Paris quarante-un maîtres de cette
communauté.
Par l’édit du 11 août 1776 , les coffretîers-mal-
letiers-bahutiers ne font qu’une même communauté
avec les gaîniers, auxquels ils font réunis.
Les droits de leur réception font fixés à 300 liv.
Voilà tout ce que nous pouvons dire de ce petit
art ; on en prendra une connoiffance un peu plus
ample, en parcourant le vocabulaire 8c les planches
du coffretier-malletier-bahutier, dont nous joignons
ici l’explication fuivie.
Planche I , la vignette repréfente l’intérieur d’une
boutique de ces fortes d’ouvriers, vu du côté de
l’entrée ; on y voit plufieurs ouvriers occupés à
différentes opérations de la profeffion.
Fig- 1, ouvrier nommé .fuflier, qui affemble les
unes avec les autres plufieurs, douves qu’il a auparavant
paffees fur la colombe, 8c qu’il a gou-
geonnées. Ii tient.de la main droite la maffe à joindre.
Fig. 2 , ouvrier qui couvre le fût avec une peau
ou un cuir ; il ratifie avec un demi-cercle de bois
pour bien étendre le cuir, 8c faire fortir le fuperr
flu de la colle.
Fig. 3 , ferreur qui affis fur la felle, coupe avec
les cifailles la taule, dont il forme les équerres 8c
les cantonnières, qui fortifient l’affemblage des dif-r
férens ouvrages de cette profeffion.
Fig. 4 , ouvrier qui de même que les bourreliers
, coud certains ouvrages à deux foies paf-
fantes*