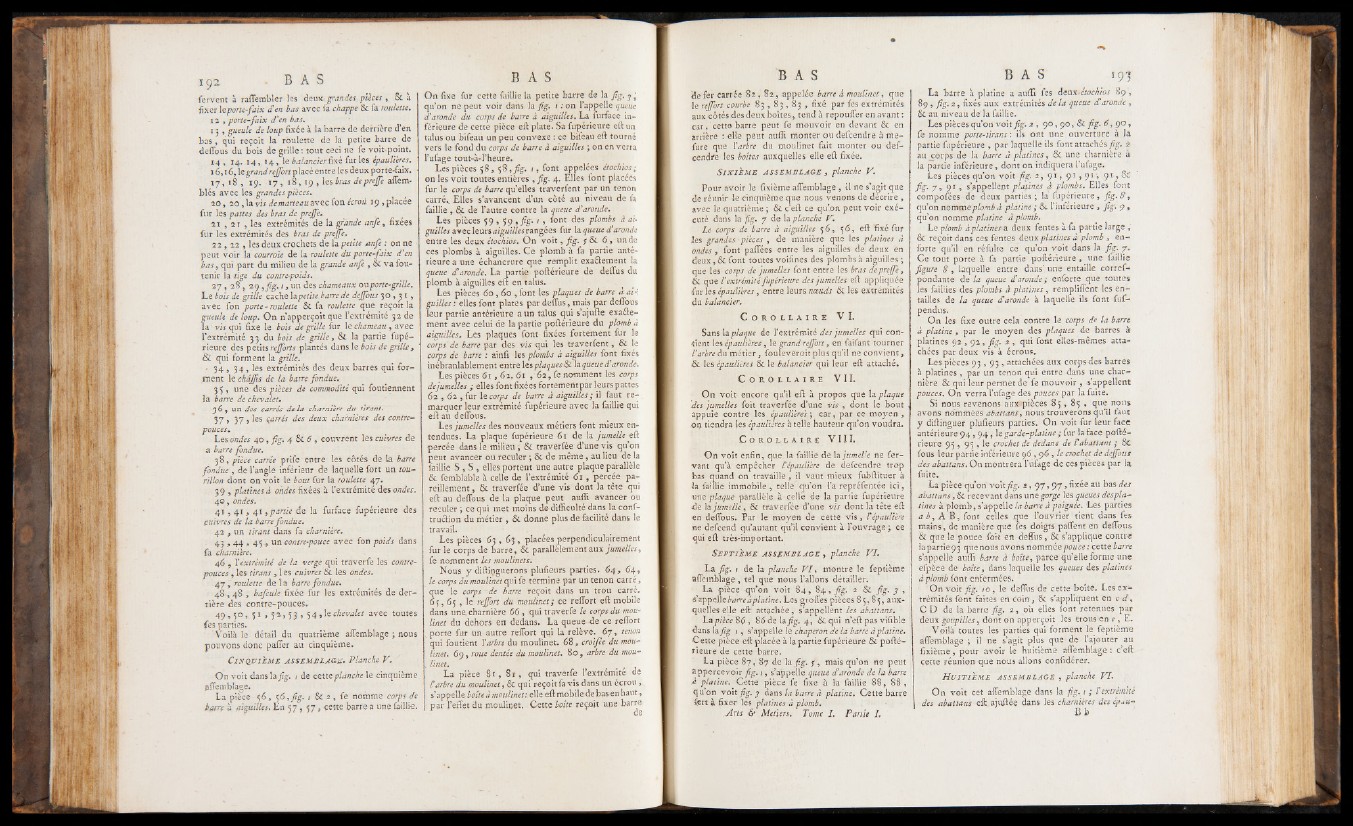
fervent à raflerobler les deux grandes , pièces,, & à
fixer le porte-faix £ en bas avec fa chappe 3c fa roulette.
12 , porte-faix £ en bas.
1 3 , gueule de loup fixée à la barre de derrière d’en
b as, qui reçoit la roulette de la petite barre de
deffous du bois de grille : tout ceci ne fe vohspoint.
14 , 14. 14, 14 , le b a la n c i e r furies épaulières.
1 6,16, \e grand rejfort placé entre les deux porte-faix.
1 7 , 1 8 , 19. 17 , 1.8, 19 , les bras depreffe affemblés
avec les grandes pièces.
20, 20, la vis de marteau avec fon ècroû 19 , placée
fur les pattes des bras de prejfe.
21 , 21 , les extrémités de la grande anfe, fixées
fur les extrémités des bras de prejfe.
2 2 ,22 , les deux crochets de la petite anfe : on ne
peut voir la courroie de la roulette du porte-faix d'en
bas, qui part du milieu de la grande anfe , 3c va fou-
tenir la tige du contre-poids.
2 7 ,2 8 , 29 yfig. t , un des chameaux ou porte-grille.
Le bois de grille cache la petite.barre de deffous 3 0 ,3 1 ,
avec fon porte-roulette 3c fa roulette que reçoit la
gueule de loup. On n apperçoit que l’extrémité 32 de
la' vis qui fixe le bois de grille fur le chameau, avec
l’extrémité 33* du bois de grille 3 3c la partie fupé-
rieure des petits refforts plantés dans le bois de grille 3
3c qui forment la grille.
| 34 , 34 , les extrémités des deux barres qui forment
le châjjis de la barre fondue.
3 5 , une des pièces de commodité qui foutiennent
la barre de chevalet.
3 6 , un des carrés delà charnière du tirant.
3 7 , 3 7 , les carrés des deux charnières des contre-
pouces.
Les ondes 40, fig. 4 3i 6 , couvrent les cuivres de
a barre fondue.
38, pièce carrée prife entre les côtés de la barre
fondue 3 de l’angle inférieur de laquelle fort un tourillon
dont on voit le bout fur la roulette 47.
39 , platines à ondes fixées à l’extrémité des ondes.
40, ondes.
4 1 , 4 1 , 4 1 3 partie de la furface fupérieure des
cuivres de la barre fondue.
42 3 un tirant dans fa charnière.
4 3 .4 4 .4 5 ., un contre-pouce avec fon poids dans
fa charnière.
46 , l'extrémité de lu verge qui traverfe les contre-
pouces , les titans , l es cuivres &. les ondes. •
4 7 , roulette d e là barre fondue.
48-, 48-3 bafcule fixée fur les extrémités de derrière
des contre-pouces.
49.50.. 5 1 ,5 2 ,5 3 , 5 4 ,1e chevalet avec toutes
fes parties.
Voilà le détail du quatrième affemblage ; nous
pouvons donc paffer au cinquième.
CINQUIEME ASSEMBLAGE. Planche V .
On voit dans la fig. 1 de cett t planche le cinquième
affemblage.
La pièce 56, 5 6 , / g . / & 2 , fe nomme corps de
barre à aiguilles, Én 5 7 ,5 7 , cette barre a une faillie.
O11 fixe fur cette faillie la petite barre de la fig. y
qu’on ne peut voir dans la fig. 1 : on l’appelle queue
d'aronde du corps de barre à aiguilles. La furface inférieure
de cette pièce eft plate. Sa fupérieure eft un
talus ou bifeau un peu convexe : ce bifeau eft tourné
vers le fond du corps de barre à aiguilles ; on en verra
l’ufage tout-à-l’heure.
Les pièces 58, 58, fig. 1 , font appelées étochios;
on les voit toutes entières , fig. 4. Elles font placées
fur le corps de barre quelles traverfent par un tenon
carré.. Elles s’avancent d’un côté au niveau de fa
faillie , 3ç de l’autre contre la queue d'aronde.
Les pièces 59 » 59 9 fig- 1 » font des plombs à al
guilles avec leurs aiguilles r années fur la queue d'aronde
entre les deux étochios. On v o it, fig. ƒ &. <5 , un de
ces plombs à aiguilles. Ce plomb à fa partie antérieure
a une échancrure que remplit exa&ement la
queue d'aronde. La partie poftérieure de deffus du
plomb à aiguilles eft en talus.
Les pièces 60,60 , font les plaques de barre à ai~,
guilles : elles font plates par deffus, mais par deffous
leur partie antérieure a un talus qui s’ajufte exaéie-
ment avec celui de la partie poftérieure du plomb à
aiguilles. Les plaques font fixées fortement fur le
corps' de barre par des vis qui les traverfent, & le
corps de barre : ainfi les plombs à aiguilles font fixés
inébranlablement entre les plaques & la queue d'aronde.
Les pièces 6 1 ,6 2 , 61 , 6 2 ,fe nomment les corps
de jumelles ; elles font fixées fortementpar leurs pattes
6 2 ,6 2 3 fur le corps de barre à aiguilles ; \l faut remarquer
leur extrémité fupérieure avec la faillie qui
eft au deffous.
Les jumelles des nouveaux métiers font mieux entendues.
La plaque fupérieure 61 de la jumelle eft
percée dans le milieu ; 3c traverfée d’une vis qu’on
peut avancer ou reculer ; & de même, au lieu de la
faillie S , S , elles portent une autre plaque parallèle
3c femblable à celle de l’extrémité 6 1 , percée pareillement
, & traverfée d’une vis dont la tête qui
eft au deffous de la plaque peut aufli avancer ou
reculer ; ce qui inet moins de difficulté dans la conf-
trucfion du métier , 3c donne plus de facilité dans le
travail.
Les pièces 63 ,6 3 placées perpendiculairement
fur le corps de barre, & parallèlement aux jumelles,
fe nomment les moulinets.
Nous y diftinguerons plufieurs parties. 64 s 64,
le corps du moulinet qui fe termine par un tenon carré,
que le corps de barre reçoit dans un trou carré.
65,65 , le rejfort du moulinet; ce reffort eft mobile
dans une charnière 66 , qui traverfe le corps du moulinet
du dehors en dedans. La queue de ce reffort
porte fur un autre reffort qui la relève. 67, tenon
qui foutient l'arbre du moulinet. 68, croifée du moulinet.
691 roue dentée du moulinet. 80, arbre du mou-
, linet. • r j
La pièce 81 , 81 , qui traverfe l’extrémité de
l'arbre du moulinet, 3c qui reçoit fa vis dans un ecrou,
s’appelle boîte à moulinet: elle eft mobile de bas en haut,
par l’effet du moulinet. Çette boîte reçoit une barre
r de
<5e fer carrée 82, 82, appelée barre à moulinet, que
le rejfort courbe 83 , 83 , 83 , fixé par fés extrémités
aux côtés des deux boîtes., tend à repouffer en.avant :
car, cette barre peut fe mouvoir en devant & en
arrière : «lie peut aufli monter ou defeendre à me-
fure que l'arbre du moulinet fait monter ou dèf-
cendfe ie$ boîtes auxquelles elle eft fixée.
S i x i è m e a s s e m b l a g e , planche V.
Pour avoir le fixième affemblage , il ne s’agit que
de réunir le cinquième que nous venons de décrire ,
avec le quatrième ; 3c c’eft ce qu’on peut voir exécuté
dans la fig. 7 de la planche V.
Le corps de barre à aiguilles 56, 5 6 t eft fixé fur
les grandes ■ pièces , de manière que les platines à
ondes, font paffées entre les aiguilles de deux en
deux, 3c font toutes voifines des plombs à aiguilles ;
que les corps de jumelles font entre les bras de prejfe s
3c que l'extrémité fupérieure des jumelles eft appliquée
fur les épaulières, entre leurs noeuds 3c les extrémités
du balancier.
C o r o l l a i r e VI .
Sans la plaque de l’ex tr émité des jumelles qui contient
les épaulières, le grand rejfort, en faifant tourner
l'arbre du métier, fouleveroit plus qu’il ne convient,
&i les épaulières 3c le balancier qui leur eft attaché.
C o r o l l a i r e V I I .
On voit- encore qu’il eft à propos que la plaque
des jumelles foit traverfée d’une vis , dont le bout ,
appuie contre les épaulières ; car, par ce moyen ,
on tiendra les épaulières à telle hauteur qu’oq voudra.
C o r o l l a i r e V I I I ,
On voit enfin, quel la faillie de la jumelle ne fer-
vant qu’à empêcher l'épaulière de defeendre trop
bas quand on travaille , il vaut mieux fubftituer à
la faillie immobile, telle qu’on l’a repréfentée ici,
une plaque parallèle, à celle de la partie fupérieure
de h jumelle, & traverfée d’une vis dont la tête eft
en deffous. Par le moyen de cette v is , Vépaulière
ne defeend qu’autant qu’il convient à l’ouvrage 3 ce
qui eft très-important.
S e p t i è m e a s s e m b l a g e , planche VI.
La fig. ; de la planche V I 3 montre le feptième
affemblage , tel que nous l’allons détailler.
La pièce qu’on voit 8 4 , 84, fig. 2 & fig. 3 ,
s’appelle barre àplatine. Les groffes pièces 85,85, auxquelles
elle eft attachée, s’appellent les abattans,
La pi:èce^6 , 86 de la fig. 4, & qui n’eft pas vifibîe
dans la fig 1 , s’appelle le chaperon de la barre à platine.
Cette pièce eft placée à la partie fupérieure & poftérieure
de cette barre.
La pièce 87, 87 de la fig. ƒ , mais qu’on ne peut
a p per ce voir fig. 1, s’appelle queue d'aronde de la barre
à platine. Cette pièce, fe fixe à la faillie 88, 88 ,
qu’on voit fig. y dans la barre à platine, Cette barre
(«rt à fixer les platines à plomb.
Arts 6» Métiers. Tome I. Partie I.
La barre à platine a aufli fes deux*étochios 89,
89, fig. 2 3 fixés aux extrémités de la queue £ aronde,
3c au, niveau de' la faillie.
Les pièces qu’ort voit fig. 2 , 90, 90, & fig. 6, 90,
Ce nomme porte-tirans : ils ont une ouverture à la
par tie fupérieure , par laquelle ils font attachés fig. 2
au. corps.de la barre à platines,. & une charnière a
la partie inférieure, dont on indiquera l’ufage.
Les pièces qu’on voit fig. 2, 9 1 , 9 1 , 9 1 '» 91 > &-
fig. 7 , 9 1 , s’appellent platines à plombs. Elles font
compofées de deux parties ; la füpériëure , fig. 8 ,
qu’on no mm e plomb à platine ; 3c l’inférieure , fig. 9 ,
qu’on nomme platine à plomb.
Le plomb à platines a deux fentes à fa partie large
3c reçoit dans ces fentes deux platines à plomb , en-
forte qu’il en réfulte ce qu’on voit dans la fig. y.
Ce tout porte à fa partie poftérieure, une faillie
figure 8 3 laquelle entre dans', une entaille corref-
pondante de la queue £aronde ; enforte que toutes
les faillies des plombs à platines, rempliffent les entailles
de la queue £ aronde à laquelle ils font fuf-
pendus.
On les fixe outre cela contre le corps de la barre
à platine, par le moyen des plaques de barres à
platines 92, 92, fig. 2 , qui font elles-mêmes attachées
par deux vis à écrous.
Les pièces 93 ,9 3 , attachées aux corps des barres
à platines, par un tenon qui entre dans une charnière
3c qui leur permet de fe mouvoir , s’appellent
pouces. On verra l’ufage des pouces par la fuite.
Si nous revenons aux^pièces 85 , 85 , que nous
avons nommées abattans3 nous trouverons qu’il faut
y diftinguer plufieurs parties. On voit fur leur face
antérieure 9 4 ,9 4 , le garde-platine ; fur la face poftérieure
95 , 95 » le crochet de dedans de l'abattant ; 3c
fous leur partie inférieure 9 6 ,9 6 , le crochet de deffous
des abattans. On montrera l’ûfage de ces pièces par la
fuite.
La pièce qu’on' voit fig. 2 ,9 7 ,9 7 , fixée au bas des
abattans , 3c recevant dans une gorge les queues des platines
à plomb, s’appelle la barre à poignée. Les parties
a b, A B , font celles .que l’ouvrier tient dans fes
mains , de manière que fes doigts paffent en deffous
3c que le pouce foit en deffus , & s’applique contre
la partie 9 3 que nous avons nommée pouce ; cette barre
s’appelle aufli barre à boîte3 parce qu’elle forme une
efpèce de boîte, dans laquelle les queues des platines
à plomb font enfermées.
On voit fig. 10, le deffus de cette boîte. Les extrémités
font faites en coin, 3c s’appliquent en c d ,
C D de la barre fig. 2 , où elles font retenues par
deux goupilles, dont on apperçoit les trous en e , E.
Vpilà toutes les parties qui forment le feptième
affemblage ; il ne. s’agit plus que de l’ajouter au
1 fixième, pour avoir le huitième affemblage : c’eft
cette réunion que nous allons confidérer.
H u i t i è m e a s s e m b l a g e , planche VI.
On voit cet affemblage dans la fig. 1 ; l'extrémité
des abattans eft. ajuftée dans les charnières des épuu-
B b