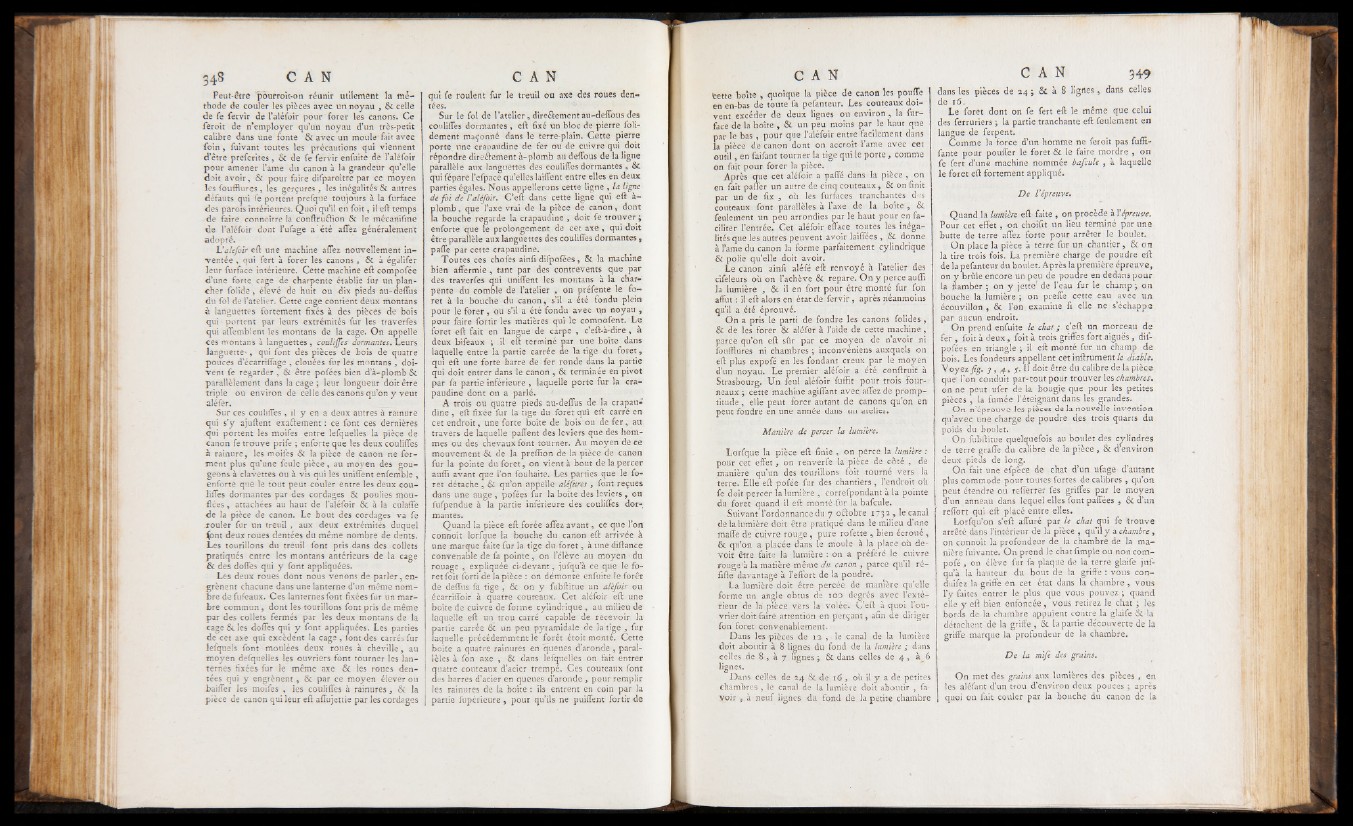
Peut-être pôurroit-on réunir utilement la méthode
de couler les pièces avec un noyau , & celle
de fe fervir de l’aléfoir pour forer les canons. Ce
feroit de n'employer qu'un noyau d’un très-petit
calibre dans une fonte & avec un moule'fait avec
foin , fuivant toutes les précautions qui viennent
d’être prefcrites, & de fe fervir enfuite de l’aléfoir
pour amener l’ame du canon à la grandeur qu’elle
doit avoir, & pour faire difparoître par ce moyen
les foufflures, les gerçures , les inégalités & autres
défauts qui fe portent prefque toujours à la furface
des parois intérieures. Quoi qu’il en foit, il eft temps
de faire connoître la conftruélion & le mécanifme
de l’aléfoir dont l’ufage a été allez généralement
adopté.
Valefoir eft une machine aflez nouvellement inventée
, qui fert à forer les canons , & à égalifer
leur furface intérieure. Cette machine eft compofée
d’une forte cage de charpente établie fur un plancher
folide, élevé de huit ou dix pieds au-deflùs
du fol de l’atelier. Cette cage contient deux montans
à languettes fortement fixés à des pièces de bois
qui - portent par leurs extrémités fur les traverfes
qui affembîent les montans de la cage. On appelle
ces montans à languettes , couliffes dormantes. Leurs
languette^, qui font des pièces de bois de quatre
pouces d’écarriflage , clouées fur les' montans , doivent
fe regarder , & être pofées bien d’à-plomb &
parallèlement dans la cage ; leur longueur doit être
triple ou environ de celle des canons qu’on y veut
aléfer.
Sur ces coulifles , il y en a deux autres à rainure
qui s’y ajuftent exaôement : ce font ces dernières
qui portent les moifes entre lefquelles la pièce de
canon fe trouve prife ; enforte que les deux couliffes
à rainure, les moifes & la pièce de canon ne forment
plus qu’une feule pièce, au moyen des gou-
geons à clavettes ou à vis qui les unifient enfemble ,
enforte que le tout peut couler entre les deux coulifles
dormantes par des cordages & poulies mou-
flées, attachées au haut de l’aléfoir & à la culafle
de la pièce de canon. Le bout des cordages va fe
rouler fur un treuil , aux deux extrémités duquel
^ont deux roues dentées du même nombre dé dents.
Les tourillons du treuil font pris dans des collets
pratiqués entre les montans antérieurs de la cage
& des dofles qui y font appliquées.
Les deux roues dont nous venons de parler, engrènent
chacune dans une lanterne d’un même nombre
de fufeaux. Ces lanternes font fixées fur un marbre
commun, dont les tourillons font pris de même
par des collets fermés par les deux montans de la
cage & les dofles qui y font appliquées. Les parties
de cet axe qui excèdent la cage , font des carrés fur
lefquels font moulées deux roues à cheville, au
moyen defquelles les ouvriers font tourner les lanternes
fixées fur le même axe & les roues dentées
qui y engrènent, & par ce moyen élever ou
baifler les moifes , les coulifles à rainures, & la
pièce de canon qui leur eft aflujettie par les cordages
qui fe roulent fur le treuil ou axe des roues dentées.
Sur le fol de l ’atelier, dire&ement au-deflous des
coulifles dormantes , eft fixé un bloc de pierre foli-
dement maçonné dans le terre-plain. Cette pierre
porte, une crapaudine de fer ou de cuivre qui doit
répondre directement à-plomb au deflous de la ligne
parallèle aux languettes des coulifles dormantes , &
qui fépare l’efpace qu’elles laiflent entre elles en deux
parties égales. Nous appellerons cette ligne , la ligne
de foi de L’aléfoir. C ’eft dans cette ligne qui eft à-
plomb, que l’axe vrai de la pièce de canon, dont
la bouche regarde la crapaudine , doit fe trouver ;
enforte que le prolongement de cet ax e, qui doit
être parallèle aux languettes des couliffes dormantes s
paffe par cette crapaudine.
Toutes ces choies ainfi difpofées, & la machine
bien affermie, tant par des contrevents que par
des traverfes qui unifient les montans à la char-'
pente du comble de l’atelier , on préfente le foret
à la bouche du canon, s’il a été fondu plein
pour le forer, ou s’il a été fondu avec up noyau ,
pour faire fortir les matières qui le compofent. Le
foret eft fait en langue de carpe , c’eft-à-dire, a
deux bifeaux ; j l eft terminé par une boîte dans
laquelle entre la partie carrée de la tige du foret,
qui eft une forte barre de fer ronde dans la partie
qui doit entrer dans le canon , & terminée en pivot
par fa partie inférieure , laquelle porte fur la crapaudine
dont on a parlé.
A trois ou quatre pieds au-deflus de la crapaudine
, eft fixée fur la tige du foret qui eft carré en
cet endroit, une forte boîte de bois ou de fer, au
travers de laquelle paffent des leviers que des hommes
ou des chevaux font tourner. Au moyen de ce
mouvement & de la preffion de là pièce de canon
fur la pointe du foret, on vient à bout de la percer
auffi avant que l’on fouhaite. Les parties que le foret
détache , & qu’on appelle aléfures , font reçues
dans une auge , pofées fur la boîte des leviers , ou
fufpendue à la partie inférieure des couliffes dormantes.
Quand la pièce eft forée allez avant, ce que l’on
connoît lorfque la bouche du canon eft arrivée à
une marque faite fur la tige du foret, à une diftance
convenable de fa pointe,, on l’élève au moyen - du
rouage , expliquée ci-devant, jufqu’à ce que le foret
foit forti de la pièce : on démonte enfuite le forêt
de deffus fa tige , & on y fubftitue un aléfoir ou
écarriffoir à quatre couteaux. Cet aléfoir eft une
boîte de cuivre de forme cylindrique , au milieu de
laquelle eft un trou carré capable de recevoir la
partie carrée & un peu pyramidale de la tige , fur
laquelle précédemment le forêt étoit monté. Cette
boîte a quatre rainures en ‘queues d’aronde , parallèles
à fon axe , & dans lefquelles on fait entrer
quatre couteaux d’acier trempé. Ces couteaux font
I des barres d’acier en queues d’aronde , pour remplir
les rainures de la boîte : ils entrent en coin par la
| partie fupérieure, pour qu’ils ne puiffent fortir de
fcette boîte , quoique la pièce de canon les pouffe
en en-bas de toute fa pefanteur. Les couteaux doivent
excéder de deux lignes ou environ, la fur-
face de la boîte , & un peu moins par le haut que
par le bas , pour que l’aléfoir entre facilement dans
la pièce de canon dont on accroît l’ame avec cet
outil, en faifant tourner la tige qui le porte , comme
on fait pour forer la pièce.
Après que cet aléfoir a paffé dans la pièce , on
en fait paffer un autre de cinq couteaux, & on finit
par un de fix , où les furfaces tranchantes des
couteaux font parallèles à Taxe de la boîte , &
feulement un peu arrondies par le haut pour en faciliter
l’entrée. Cet aléfoir efface toutes les inégalités
que les autres peuvent avoir laiffées , & donne
à l’ame du canon la forme parfaitement cylindrique
& polie qu’elle doit avoir.
Le canon ainfi aléfé eft renvoyé à l’atelier des
cifeleurs où on l’achève & repare. On y perce aufli
la lumière , & il en fort pour être monté fur fon
affût: il eft alors en état de fervir, après néanmoins
qu’il a été éprouvé.
On a pris le parti de fondre les canons folides ,
& de les forer & aléfer à l’aide de cette machine,
parce qu’on eft sûr par ce moyen de n’avoir ni
foufflures ni chambres ; inconvéniens auxquels on
eft plus expofé en les fondant creux par le moyen
d’un noyau. Le premier aléfoir a été conftruit à
Strasbourg. Un feul aléfoir fuffit pour trois fourneaux
; cette machine agiffant avec affez de promptitude
, elle peut forer autant de canons qu’on en
peut fondre en une année dans un atelier.
Manière de gercer la lumière.
Lorfque la pièce eft finie , on perce la lumière :
pour cet effet, on renverfe la pièce de côté , de
manière qu’un des tourillons foit tourné vers la
terre. Elle eft pofée fur des chantiers, l’endroit où
fe doit percer la lumière , correfpondant à la pointe
du foret quand il eft monté-fur la bafcule.
Suivant l’ordonnance du 7 octobre 1732 , le canal
de la lumière doit être pratiqué dans le milieu d’une
maffe de cuivre rouge , pure rofette , bien écroué ,
& qu’on a placée dans le moule à la place où de-
voit être faite la lumière : on a préféré le cuivre
rouge >à la matière même du canon , parce qu’il ré-
fifte davantage à l’effort de la poudre.
La lumière doit être percée de manière qu’elle
forme un angle obtus de 100 degrés avec l’extérieur
de la pièce vers la volée. C ’eft à quoi l’ouvrier
doit faire attention en perçant, afin de diriger
fon foret convenablement.
Dans les pièces de 12 , ■ le canal de la lumière
doit aboutir à 8 lignes du fond de la lumière ; dans
celles de 8 , à 7 lignes j & dans celles de 4., à_6
lignes.
Dans celles de 24 & de 16 , où il y a de petites
chambres , le canal de la lumière doit aboutir , fa-
y p ir , à neuf lignes du fond de la petite chambre
dans les pièces de 24 ; & à 8 lignes, dans celles
de 16.
Le forêt dont on fe fert eft le même que celui
des ferruriers ; la partie tranchante eft feulement en
langue de ferpent.
Comme la force d’un homme ne feroit pas fuffi-
fante pour pouffer le foret & le faire mordre , on
fè fert d’une machine nommée bafcule , à laquelle
le foret eft fortement appliqué.
De Vépreuve.
Quand la lumière eft faite, on procède à Vépreuve.
Pour cet effet, on choifit un lieu terminé par une
butte de terre affez forte pour arrêter le boulet.
On place la pièce à terre fur un chantier, & on
la tire trois fois. La première charge de poudre eft
de la pefanteur du boulet. Après la première épreuve,
on y brûle encore un peu de poudre en dedans pour
la flamber ; on y jette' de l’eau fur le champ ; on
bouche la lumière ; on preffe cette eau avec un
éçouvillon , & l’on examine fi elle ne s’échappe
par aucun endroit.
On prend enfuite le chat ; ç’eft un morceau de
fer , foit à deux, foit à trois griffes fort aigues, difpofées
en triangle ; il eft monté fur un champ de
bois. Les fondeurs appellent cetinftrument/e diable.
Voyez fig. 3 , 4 , 7. Il doit être du calibre de la pièce
que' l’on conduit par-tout pour trouver les chambres.
on ne peut ufer de la bougie que pour les petites
pièces , la fumée l’éteignant dans les grandes.
On n’éprouve les pièces de la nouvelle invention
qu’avec une charge de poudre des trois quarts du
poids du boulet.
On fubftitue quelquefois au boulet des cylindres
de terre graffe du calibre de la pièce , & d environ
deux pieds de long.
On fait une efp'èce de chat d’un ufage d’autant
plus commode pour toutes fortes de calibres , qu’on
peut étendre ou refferrer fes griffes par le moyen
: d’un anneau dans lequel elles font paffées , & d’un
reffort qui eft placé entre elles.
Lorfqu’on s’eft affuré par le chat qui fe trouve
arrêté dans l’intérieur de la pièce , qu’il y a chambre ,
on connoît la profondeur de la chambre de la manière
fuivante. On prend le chat fimple ou non com-
pofé, on élève fur fa plaque de la terre glaife jufqu’à
la hauteur du bout de la griffe : vous conduirez
la griffe en cet état dans la chambre, vous
l’y faites entrer le plus que vous pouvez ; quand
elle y eft bien enfoncée , vous retirez le chat ; les
bords de la chambre appuient contre la glaife &-la
détachent de la griffe, & la partie découverte de la
griffe marque la profondeur de la chambre.
De la mife des grains.
On met des grains aux lumières des pièces , en
les aléfant d’un trou d’environ deux pouces ; après
quoi on fait couler par la bouche du canon de la