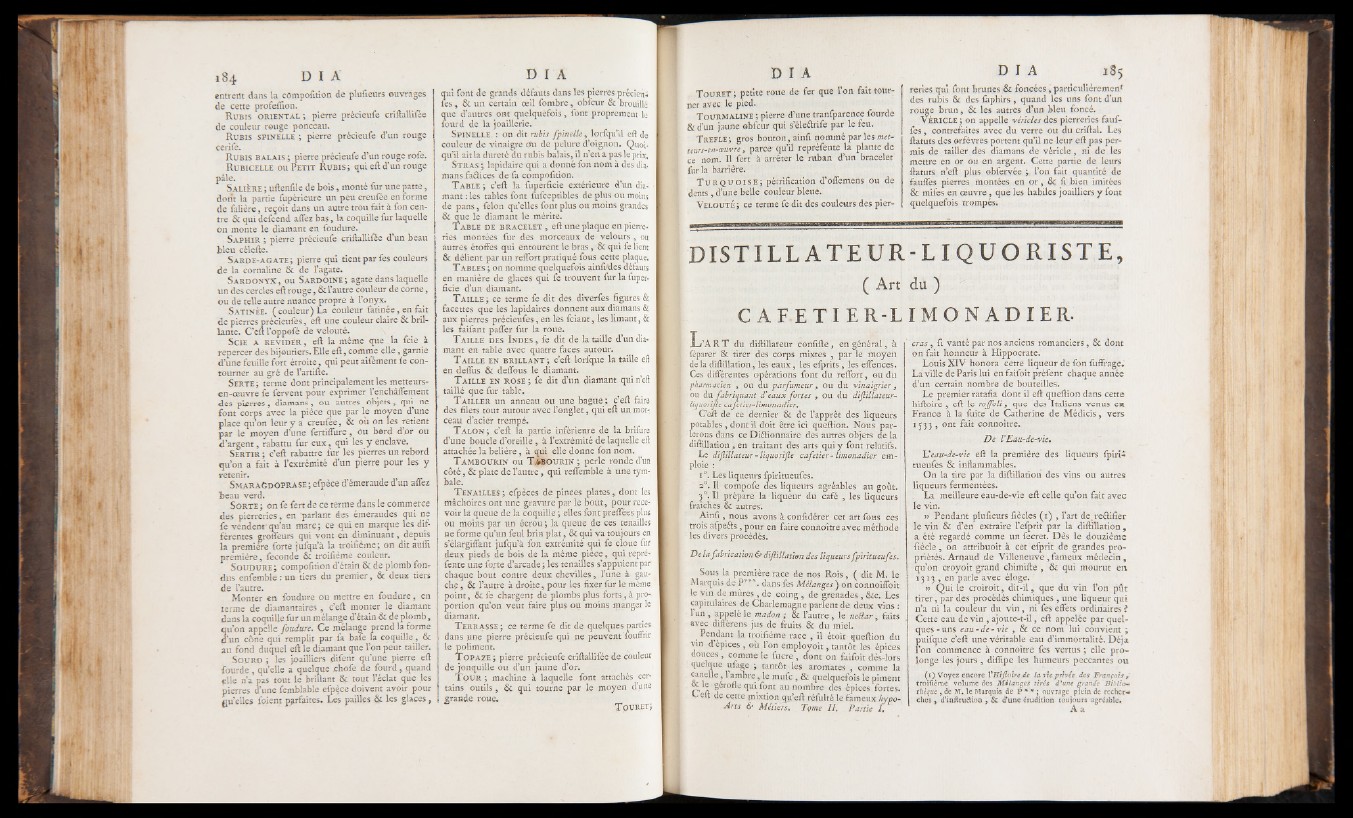
entrent dans la compofition de plufieurs ouvrages
de cette profefiion.
Rubis orien tal; pierre précieufe criftallifèe
de couleur rouge ponceau.
Rubis spinelle ; pierre précieufe d’un rouge
cerife.
Rubis balais ; pierre précieufe d’un rouge rofe.
Rubicelle ou Petit Rubis; qui eft d’un rouge
pâle.
Salière ; uftenfile de bois, monté fur une patte,
dont la partie fupérieure un peu creufée en forme
de falière, reçoit dans un autre trou fait à fon centre
& qui defcend allez bas, la coquille fur laquelle
on monte le diamant en foudure.
Saphir ; pierre précieufe criftallifèe d’un beau
bleu célefte.
Sarde-a g a t e ; pierre qui tient par fes couleurs
de la cornaline & dé l’agate.
Sa r d o n yx , ou Sardoine; agate dans laquelle
un des cercles eft rouge, & l’autre couleur de corne,
ou de telle autre nuance propre à l’onyx.
Satinée, (couleur) La couleur farinée, en fait
de pierres précieufes, eft une couleur claire & brillante.
C’eft l’oppefé de velouté. \
Scie a revidEr , eft la même que la fcie à
repercer des bijoutiers. Elle eft, comme elle, garnie
d’une feuille fort étroite, qui peut aifément le contourner
au gré de l’artifte.
Serte; terme dont principalement les metteurs-
en-oeuvre fe fervent pour exprimer l’encHâffement
des pierres, diamans, ou autres objets, qui ne
font corps avec la pièce que par le moyen d’une
place qu’on leur y a creufée, & ou on les retient
par le moyen d’une fertiffure, ou bord dor ou
d ’argent, rabattu fur eux, qui les y enclave.
Ser t ir ; c’eft rabattre fur les pierres un rebord
qu’on a fait à l’extrémité d’un pierre pour les y
retenir.
Sm araGdoprase; efpèce d’émeraude d un allez
beau verd.
Sorte ; on fe fert de ce terme dans le commerce
des pierreries, en 'parlant des émeraudes qui ne
fe vendent- qu’au marc ; ce qui en marque les différentes
groffeurs qui vont en diminuant, depuis
la première forte jufqu’à la troifieme; on dit aufli
première, fécondé & troifième couleur.
Soudure; compofition d’étain & de plomb fon*
dus enfemble : un tiers du premier, & deux tiers
de l’autre.
Monter en foudure ou mettre en foudure, en
terme de diamantaires , c’eft monter le diamant
dans la coquille fur un mélange d’étain & de plomb,
qu’on appelle foudure. Ce mélangé prend la forme
d’un cône qui remplit par fa baie 1a coquille, &
au fond duquel eft le diamant que l’on peut tailler.
Sourd ; les joailliers difent qu’une pierre eft
Lourde, qu’elle a quelque chofe de fourd, quand
file n’a pas tout le brillant & tout l’éclat que les
pierres d’une femblable efpçce doivent avoir pour
quelles foient parfaites. Les pailles & les glaces,
q ui font de grands défauts dans les pierres précieii-i
f e s , & u n certain oe il fo m b re , obfcur & brouillé
que d’autres on t qu elq uefo is, fo n t proprem ent le
lo u rd de la joaillerie.
Spin e l l e : on d it ru b is f p in e l l e , lorfqu’il eft de
couleur de vinaigre du de pelure d’oignon. Quoi,
qu’il ait la dureté du rubis balais, il n’en a pas le prix.
St r a s ; lapidaire qui a donné fon nom à des dia-
m a n sfa â ic e s de fa com pofition.
T a bl e ; c’eft la fuperficie extérieure d’un diam
ant : les tables fo n t fufceptibles de plus ou moins
de p a n s , félon qu’elles font plus o ù m oins grandes
& que le diam ant le m érite.
T a b l e d e b r a c e l e t , eft une plaque en pierreries
m ontées fur des m orceaux de velours , ou
autres étoffes qui en to u rent le b ra s, & qui fe lient
& délient par u n reffort p ratiqué fous cette plaque.
T a b l e s ; o n nom m e quelquefois ainfvdes défauts
en m anière de glaces qui fe tro u v en t fu r la fuper«
ficie d’u n diam ant.
T a il l e ; ce term e fe dit des diverfes figures &
facettes que les lapidaires d o nn en t aux diamans &
aux p ierres p récieu fes, en lès fc ia n t, les lim an t, &
les faifant paffer fu r la roue.
T a il l e d e s I n d e s , fe dit de la taille d’u n diam
an t en tab le avec quatre faces autour.
T a il l e e n b r il l a n t ; c’eft lorfque la taille eft
en deffus & deffous le diam ant.
T a il l e en r o s e ; fe dit d’u n diam ant q u in ’eft
taillé que fur table.
T a il l e r u n anneau ou une b a g u e ; c’eft faire
des filets to u t au to u r avec l’o n g le t, qui eft u n morceau
d’acier trem pé.
T a l o n ; c’eft la partie inférieure de la brifure
d’une boucle d’oreille , à l’extrém ité de laquelle eft
attachée la b e liè re , à q ui elle donne fon nom .
T a m b o u r in ou T a b o u r in ; p erle ronde d’un
c ô té , & plate de l’a u tre , q ui reffem ble à u n e tym-
bale.
T e n a il l e s ; efpèces de pinces p la te s, dont les
m âchoires o n t une gravure p ar le b o u t, pour recev
o ir la queue de la coquille ; elles font preffées plus
ou m oins par u n écrou ; la queue de ces tenailles
ne form e qu’un feul brin p la t, & qui va toujours en
s’élargiffant jufqu’à fon extrém ité qui fe "cloue fur
deux pieds de bois de la m êm e p ie c e , qui .repréfente
une fojrte d’arcade; les tenailles s’appuient par
chaque b o ut contre deux ch evilles, l’une à gauche
, & l’autre à d ro ite , pour les fixer fur le même
p o in t, & fe chargent de plom bs plus fo rts , à prop
ortion qu’on v e u t faire plus ou m oins ’m anger le
diam ant.
T e r r a s s e ; ce term e fe dit de quelques parties
dans u n e p ierre précieufe qui n e p euvent Touffrir
le polim ent.
T o p a z e ; pierre précieufe criftallifèe de couleur
de jonquille o u d’un jaune d’or.
TO U R ; m achine à laquelle font attachés certains
outils , & qui tourne p ar le m oyen d’une
g ran d e roue* TpURET;
T ouret; petite roue de fer que l’on fait tourner
avec le pied.
T ourmaline ; pierre d’une tranfparence Lourde
& d’un jaune obfcur qui s’éle&rife par le feu.
T refle; gros bouton, ainfi nommé par les met-
teurs-en-ceuvre, parce- qu’il repréfente la plante de
ce nom. Il fert à arrêter le ruban d’un bracelet
fur la barrière.
T u r q u o i s e ; pétrification d’offemens ou de
dents, d’une belle couleur bleue.
V elouté; ce terme fe dit des couleurs des pierferles
qui font brunes & foncées, particulièrement
des rubis & des faphirs, quand les uns font d’un
rouge brun, & les autres d’un bleu foncé.
V ericle ; on appelle véricles des pierreries fauf-
fes , contrefaites avec du verre ou du criftal. Les
ftatuts des orfèvres portent qu’il ne leur eft pas permis
de tailler des diamans de véricle, ni de les
mettre en or ou en argent. Cette partie de leurs
ftatuts n’eft plus obfervée ;. l’on fait quantité de
fauffes pierres montées en o r , & fi bien imitées
& mifes en oeuvre, que les habiles joailliers y font
quelquefois trompés.
DISTILL ATEUR-LI QUORISTE,
( Art du )
C A F E T I E R - L IMO N A D I E R .
L ’A R T du diftillateur conlifte 3 en général, à
féparer & tirer des corps mixtes , par le moyen
de la diftillation, les eaux, les efprits , les effences.
Ces différentes opérations font du reffort, ou du
pharmacien , ou du parfumeur, ou du vinaigrier,
ou du fabriquant d’eaux fortes 3 ou du diftillateur-
liquorifte cafetier-limonadier.
C’eft de ce dernier & de l’apprêt des liqueurs
potables , dont il doit être ici queftion. Nous parlerons
dans ce Dictionnaire des autres objets de la
diftillation, en traitant des arts qui y font relatifs.
Le diftillateur - liquorifte cafetier - limonadier emploie
:
i°. Les liqueurs fpîritueufes.
a0. Il compofe des liqueurs agréables au goût.
3°. Il prépare la liqueur du café , les liqueurs
fraîches & autres".
Ainfi , nous avons à confidérer cet art fous ces
trois afpe&s , pour en faire connoître avec méthode
les divers procédés.
De la fabrication & diftillation des liqueurs fpîritueufes.
Sous la première race de nos Rois, ( dit M. le
Marquis de P***, dans fes Mélanges ) on connoiffoit
le vin de mures, de coing , de grenades , <kc. Les
capitulaires de Charlemagne parlent de deux vins :
1 un , ajmele le madon ; & l’autre , le neSlar, faits
avec différens jus de fruits & du miel.
. Pendant la troifieme race , il étoit queftion du
vin d’épices , où l’on employoit, tantôt les épices
douces , comme le fucre , dont on faifoit dès-lors
quelque ufage ; tantôt les aromates , comme la
^nelle, l’ambre , le mufc , & quelquefois le piment
■ J-, ® ëérofle qui font au nombre des épices fortes.
C eft de cette mixtion qii’eft réfulté le fameux hypo-
Arts & Métiers. Tçme II. Partie I,
cras, fi vanté par nos anciens romanciers, & dont
on fait honneur à Hippocrate.
Louis X IV honora cette liqueur de fon fuffrage.
La ville de Paris lui en faifoit préfent chaque année
d’un certain nombre de bouteilles.
Le premier ratafia dont il eft queftion dans cette
hiftoire, eft le rojfoli, que des Italiens venus en
France à la fuite de Catherine de Médicis, vers
1 y 3 3 , ont fait connoître.
De VEau-de-vie.
eau-de-vie eft la première des liqueurs fpiri-
tueufes & inflammables.
On la tire par la diftillation des vins ou autres
liqueurs fermentées.
La meilleure eau-de-vie eft celle qu’on fait avec
le vin.
» Pendant plufieurs fiècles (1) , l’art de. rectifier
le vin & d’en extraire l’efprit par la diftillation,
a été regardé comme un fecret. Dès le douzième
fiècle, on attribuoit à cet efprit de grandes propriétés.
Arnaud de Villeneuve , fameux médecin,
qu’on croyoit grand chimifte , & qui mourut en
1313 , en parle avec éloge. '
» Qui le croiroit, dit-il, que du vin l’on pût
tirer, par des procédés chimiques , une liqueur qui
n’a ni la couleur du v in , ni fes effets ordinaires ?
Cette eau de vin , ajoute-t-il, eft appelée par quelques
- uns eau -de- vie , & ce nom lui convient ;
puifque c’eft une véritable eau d’immortalité. Déjà
l’on commence à connoître fes vertus ; elle prolonge
les jours , difllpe les humeurs peccantes ou
(1) Voyez encore VHiftoire.de ta vie privée des François?
troifième volume des Mélanges tirés d'une grande Biblio-
thèque , de M. le Marquis de P * * ; ouvrage plein de recherches
, d’inftruftion , & d’une érudition toujours agréable.
A a