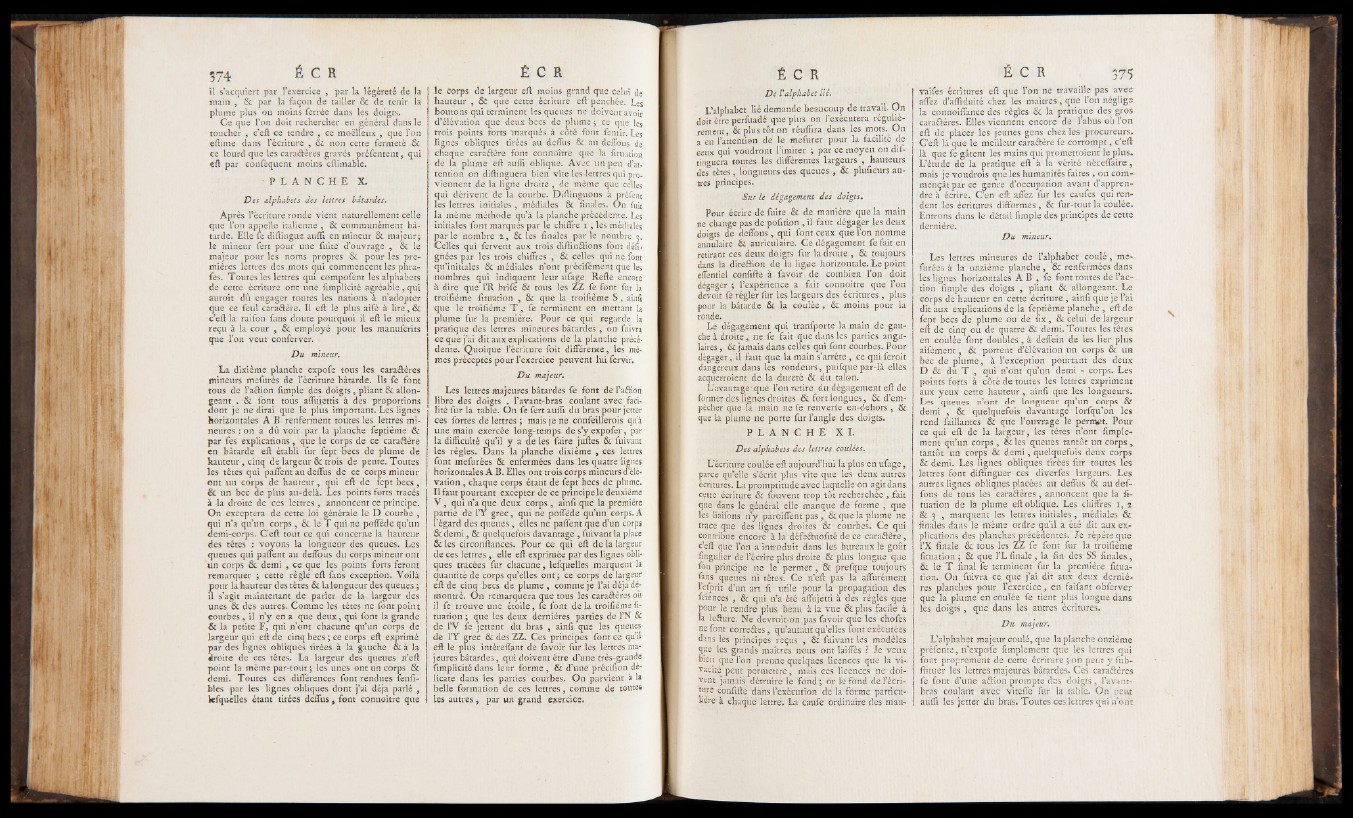
il s’acquiert par l’exercice , par la légèreté de la
main , & par la façon de tailler & de tenir la
plume plus ou moins ferrée dans les doigts.
Ce que l’on doit rechercher en général dans le
toucher , c’ell ce tendre , ce moelleux , que l’on
eftime dans l’écriture , & non cette fermeté &
ce lourd que les caradères gravés préfentent, qui
eft par conféquent moins eftimable.
P L A N C H E X.
Des alphabets des lettres bâtardes.
Après l’écriture ronde vient naturellement celle
que l’on appelle italienne , & communément bâtarde.
Elle le diftingue aufli en mineur & majeur;
le mineur fert pour une fuite d’ouvrage , & le
majeur pour les noms propres & pourles premières
lettres des mots qui commencent les phra-
fes. Toutes les lettres qui compofent les alphabets
de cette écriture ont une fimplicité agréable, qui
auroit dû engager toutes les nations à n’adopter
que ce feul caradère. Il eft le plus aifé à lire, &
c’eft la raifon fans doute pourquoi il eft le mieux
reçu à la cour , & employé pour les manufcrits
que l’on veut conferver.
Du mineur.
La dixième planche expofe tous les caradères
mineurs mefurés de l’écriture bâtarde. Ils fe font
tous de l’adion {impie des doigts, pliant & allongeant
, & font tous affujettis à des proportions
dont je ne dirai que le plus important. Les lignes
horizontales A B renferment toutes les lettres mineures
: on a dû voir par la planche feptième &
par fes explications, que le corps do ce caradère
en bâtarde eft établi fur fept becs de plume de
hauteur, cinq de largeur & trois de pente. Toutes
les têtes qui paflent au deffus de ce corps mineur
ont un corps de hauteur, qui eft de lept becs,
& un bec de plus au-delà. Les points forts tracés
à la droite de ces lettres , annoncent ce principe.
On exceptera de cette loi générale le D courbe ,
qui n’a qu’un corps , & le T qui ne poffède qu’un
demi-corps. C ’eft tout ce qui concerne la hauteur
des têtes : voyons la longueur des queués. Les
queues qui paflent au deffous du corps mineur ont
un corps & demi , ce que les points forts feront
remarquer ; cette règle eft fans exception. Voilà
pour la hauteur des têtes & la longueur des queues ;
il s’agit maintenant de parler de la largeur des
unes & des autres. Comme les têtes ne font point
courbes , il n’y en a que deux, qui font la grande
& la petite F, qui n’ont chacune qu’un corps de
largeur qui eft de cinq becs ; ce corps eft exprimé
par des lignes obliques tirées à la gauche & à la
droite de ces têtes. La largeur des queues n’eft
point la même par-tout ; les unes ont un corps &
demi. Toutes ces différences font rendues fenfi-
bles par les lignes obliques dont j’ai déjà parlé ,
kfquclles étant tirées deffus ^ font connoître que
le corps de largeur eft moins grand que celui de
hauteur , & que cette écriture eft penchée. Les
boutons qui terminent les queues ne doivent avoir
d’élévation que deux becs de plume ; ce que les
trois points forts 'marqués.à coté font fentir. Les
Lignes obliques tirées au deffus & au deffous de
chaque caradère font connoître que la fituation
de la plume eft aufli oblique. Avec un peu d’attention
on diftinguera bien vite les-lettrés qui proviennent
de la ligne droite , de même que celles
qui dérivent de la courbe. Diftinguons à préfent
les lettres initiales, médiales & finales. On fuit
la même méthode qu’à la planche précédente. Les
initiales font marqués par le chiffre i , les médiales
parle nombre 2, & les finales par le nombre 3,
Celles qui fervent aux trois diftindions font défi-
gnées par les trois chiffres , & celles qui ne font
qu’initiales & médiales n’ont précifément que les
nombres qui indiquent leur ufage. Refte encore
à dire que l’R brifé & tous les ZZ fe font fur la
troifième fituation , & que la troifième S , ainft
que le troifième T , fe terminent en mettant la
plume fur la première. Pour ce qui regarde la
pratique des lettres mineures bâtardes, on fuivra
ce que j’ai dit aux explications de la planche précédente.
Quoique l’écriture foit différente, les mêmes
préceptes pour l’exercice peuvent lui fervir.
Du majeur.
Les lettres majeures bâtardes fe font de l’adion
libre des doigts , l’aVant-bras coulant avec facilité
fur la table. On fe fert aufli du bras pour jetter
ces fortes de lettres ; mais je ne confeillerois qu’à
une main exercée long-temps de s’y expofer, par
la difficulté qu’il y a de les faire juftes & fuivant
les règles. Dans la planche dixième , ces lettres
font mefurées & enfermées dans les quatrelignes
horizontales A B. Elles ont trois corps mineurs d’élévation
, chaque corps étant de fept becs de plume.
Il faut pourtant excepter de ce principe le deuxième
V j qui n’a que deux corps , ainfi que la première
partie de l’Y grec, qui ne poflede qu’un corps. A
l’égard des queues , elles ne paflent que d’un corps
& demi, & quelquefois davantage , fuivant la place
& les circonftances. Pour ce qui eft de la largeur
de ces lettres, elle eft exprimée par des lignes obliques
tracées fur chacune, lefquelles marquent la
quantité de corps qu’elles ont ; ce corps de largeur
eft de cinq becs de plume , comme je l’ai déjà démontré.
On remarquera que tous les caradères ou
il fe trouve une étoile, fe font de la troifième fituation
; que les deux dernières parties de l’N &
de LV fe jettent du bras , ainfi que les queues
de l’Y grec & des ZZ. Ces principes font ce qu’il
eft le plus intéreffant de favoir fur les lettres majeures
bâtardes, qui doivent être d’une très-grande
fimplicité dans leur forme , & d’une précifion délicate
dans les parties courbes. On parvient à la
belle formation de ces lettres, comme de toutes
les autres, par un grand exercice.
De Valphabet lié.
L’alphabet lié demande beaucoup de travail. On
doit être perfuadé que plus on l’exécutera régulièrement
, & plus tôt on réuffira dans les mots. On
a eu l’attention de le mefiirer pour la facilité de
ceux qui voudront l’imiter ; par ce moyen on diftinguera
toutes les différentes largeurs , hauteurs
des têtes, longueurs des queues , & plufieurs autres
principes.
Sur le dégagement des doigts*
Peur écrire de fuite & de manière que la main
ne change pas de pofition , il faut dégager les deux
doigts de deffous , qui font ceux que l’on nomme
annulaire & auriculaire. Ce dégagement fe fait en
retirant ces deux doigts fur la droite , & toujours
dans la diredion de la ligne horizontale. Le point
effentiel confifte à favoir de combien l’on doit
dégager ; l’expérience a fait connoître que l’on
devoit fe régler fur les largeurs des écritures , plus
pour la bâtarde & la coulée , & moins pour la
ronde.
Le dégagement qui tranfporte la main de gauche
à droite, ne fe fait que dans lès parties angulaires
, & jamais dans celles qui font courbes. Pour
dégager, il faut que la main s’arrête, ce qui feroit
dangereux dans les rondeurs, puifque par-là elles
àcquerroient de la dureté & du talon.
L’avantage que l’on retire du dégagement eft de
former des lignes droites & fort longues, & d’empêcher
que la main ne fe renverfe en-dehors , &
que la plume ne porte fur l’angle des doigts.
P L A N C H E X I .
Des alphabets des lettres coulées.
L’écriture coulée eft aujourd’hui la plus en ufage,
parce qu’elle s’écrit plus vite que- les deux autres
écritures. La promptitude avec laquelle on agit dans
cette écriture & fouvent trop tôt recherchée , fait
que dans le général elle manque de forme , que
les liaifons n’y pàroiffent pas , & que la plume ne
trace que des lignes droites & courbes. Ce qui
contribue encore à la défeduofité de ce caradère ,
c’eft que l’on à introduit dans les bureaux le goût
fingulier de l’écrire plus droite & plus longue que
fon principe ne le permet , oc prefque toujours
fans queues ni têtes. Ce n’eft pas là affurément
l efprit d’un art fi utile pour la propagation des
fciences , & qui n’a été affujetti à des règles que
pour le rendre plus beau à la vue & plus facile à
la ledure. Ne devroit-on pas favoir que les chofes
ne font corredes, qu’autant qu’elles font exécutées
dans les principes reçus , & fuivant les modèles
que les grands maîtres nous ont îaiffès ? Je veux
bien que l’on prenne quelques licences que la vivacité
peut permettre, mais çes licences ne doivent
jamais détruire le fond ; or. le fond de l’écriture
confifte dans l’exécution de la forme particulière
à chaque lettre. La caufe ordinaire des ni auvaifês
écritures eft que l’on ne travaille pas avec
affez d’afliduité chez les maîtres, que l’on néglige
la connoiffance des règles & la pratique des gros
caradères. Elles viennent encore de l’abus où l’on
eft de placer les jeunes gens chez les procureurs.
C ’eft là que le meilleur caradère fe corrompt, c’eft
là que fe gâtent les mains qui promettoient le plus.
L’étude de la pratique eft à la vérité néceffaire ,
mais je voudrois que les humanités faites , on commençât
par ce genre d’occupation avant d’apprendre
à écrire. C ’en eft affez fur les caufes qui rendent
les écritures difformes, & fur-tout la coulée.
Entrons dans le détail fimple des principes de cette
dernière.
Du mineur.
Les lettres mineures de l’alphabet coulé, me-
furéès à la onzième planche, & renfermées dans
les lignes horizontales A B , fe font toutes de l’action
fimple des doigts , pliant & allongeant. Le
corps de hauteur en cette écriture , ainfi que je l’ai
dit aux explications de la feptième planche, eft de
fept becs de plume ou de fix , & celui de largeur
eft de cinq ou de quatre & demi. Toutes les têtes
en coulée font doubles, à deffein de les lier plus
aifément, & portent d’élévation un corps & un
bec de plume, à l’exception pourtant des deux
D & du T , qui n’ont qu’un demi - corps. Les
points forts à côté de toutes les lettres expriment
aux yeux cette hauteur, ainfi que les longueurs.
Les queues ri’ont de longueur qu’un corps &
demi , & quelquefois davantage lorfqu’on les
rend faillantes & que l’ouvrage le permet. Pour
ce qui eft de la largeur, les têtes n’ont Amplement
qu’un corps , & les queues tantôt un corps ,
tantôt un corps & demi, quelquefois deux corps
& demi. Les lignes obliques tirées fur toutes les
lettres font diftinguer ces diverfes largeurs. Les
autres lignes obliques placées au deffus & au deffous
de tous les caradères, annoncent que la fituation
de la plume eft oblique. Les chiffres 1, 2
& 3 , marquent les lettres initiales , médiales &
finales dans le même ordre qu’il a été dit aux explications
des planches précédentes. Je répète que
l’X finale & tous les ZZ fe font fur la troifième
fituation ; & que l’L finale, la fin des SS finales,
& le T final fe terminent fur la première fituation.
On fuivra ce que j’ai dit aux deux dernières
planches pour l’exercice, en faifant obferver
que la plume en coulée fe tient plus longue dans
les doigts, que dans les autres écritures.
Du majeur.
L’alphabet majeur coulé, que la planche onzième
prêfente, n’expofe Amplement que les lettres qui
font proprement de cette écriture ; on peut y fub-
ftituer les lettres majeures bâtardes. Ces caradères
fe. font d’une adion prompte des doigts , l’avant-
bras coulant avec viteffe fur la table. On peut
aufli les-jetter du bras. Toutes ces.lettres qui n’ont
\