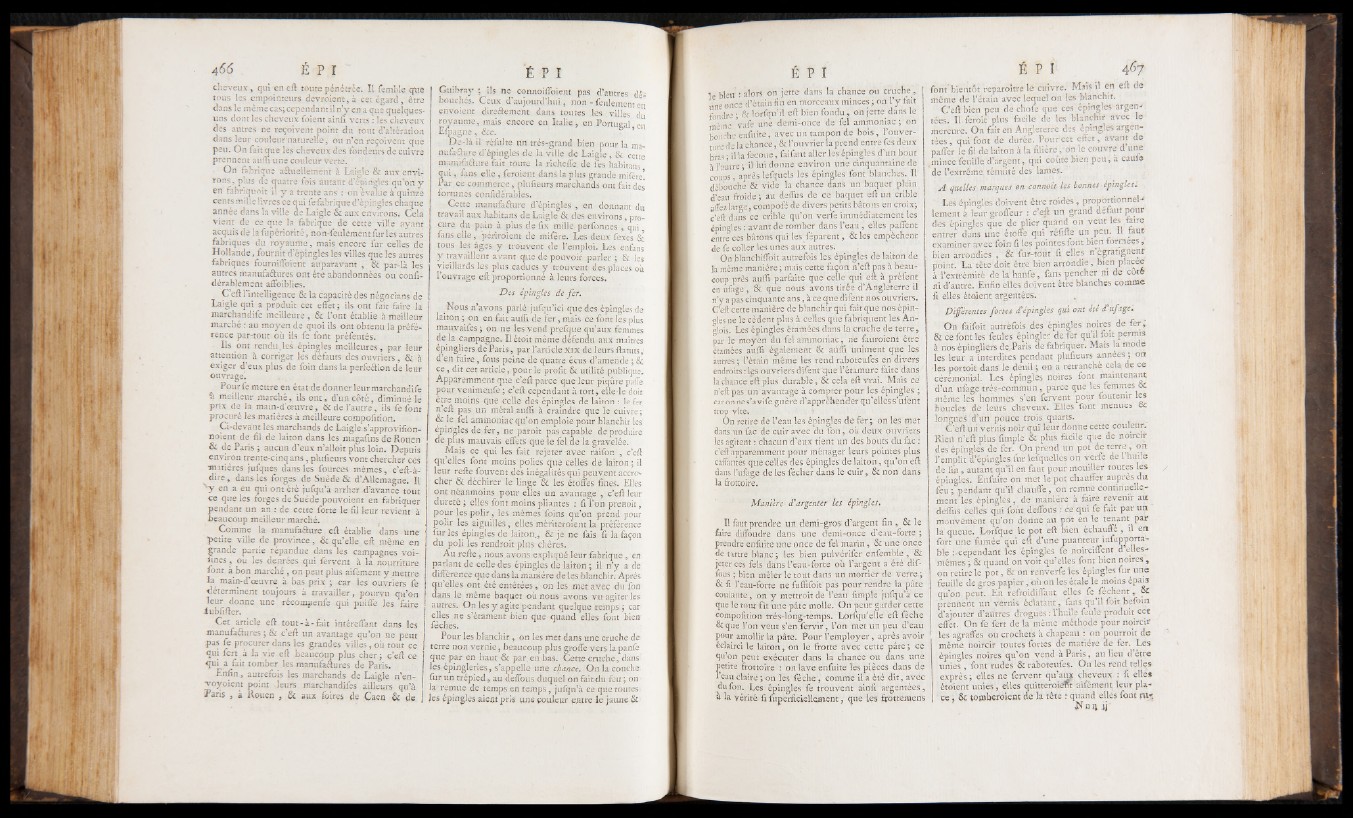
cheveux, qui en eft toute pénétrée. Il fenible que
tous les empointeurs devraient, à cet égard, être
dans le même cas; cependant il n’y en a que quelques-
uns dont les cheveux foient ainfi verts : les cheveux
des autres ne reçoivent point du tout d’altération
dans leur couleur naturelle, ou n’en reçoivent que
peu. On fait que les cheveux des fondeurs de cuivre
prennent aufii une couleur verte.
On fabrique actuellement à Laigle & aux envir
rons, plus de quatre fois autant d’épingles qu’on y
en fabriquoit il y a trente ans : on évalue à quinze
cents mille livres ce qui fe fabrique d’épingles chaque
année dans la ville de Laigle & aux environs; Cela
vient de ce que la fabrique de cette ville ayant
acquis de la fupériorité, non-feulement fur les autres
fabriques du royaume, mais encore fur celles de
Hollande, fournit d’épingles les villes que les autres
fabriques fourniffoient auparavant , 8c par-là les
autres manufactures ont été abandonnées ou confi-
dérablement affoiblies.
Guibray ; ils ne connoiffoient pas d’autres dé*
bouchés. Ceux d’aujourd’h ui, non - feulement en
envoient directement dans toutes les villes du
royaume, mais encore en Italie, en Portugal en
Efpagne, &c.
De-là il réfulte un très-grand bien pour la manufacture
d’épingles de la ville de Laigle , & cette
manufacture fait .toute la riche,fie de les habitans
q u i, fans elle , feraient dans la plus grande mifère!
Par ce commerce, plufieurs marchands ont fait des
fortunes confidérables. .
Cette manufacture d’épingles , en donnant du
travail aux habitans de Laigle & des environs, procure
du pain à plus de fix mille perfonnes , qui
fans elle, périraient de mifère. Les deux fexes 8c
tous les âges : y trouvent de l’emploi. Les enfans
y travaillent avant que de pouvoir parler ; & les
vieillards les plus caducs y trouvent des places où
l’ouvrage eft proportionné à leurs forces.
C ’eft l’intelligence & la capacité des négocions de
Laigle qui a produit cet effet; ils ont fait faire la
marchandife meilleure , & l’ont établie à meilleur
marché : au moyen de quoi ils ont obtenu la préférence
par-tout où ils fe font préfentés.
Ils ont rendu Jes épingles meilleures -, par leur
attention à corriger les défauts des ouvriers , & à
exiger d.’eux plus de foin dans la perfe&ion de leur
ouvragel
Pour fe mettre en état de donner leur marchandife
^ meilleur marché, ils ont, d’un côté, diminué le
prix de la main-d’oe uvre, & de l’autre, ils fe font
procuré les matières à meilleure compofition.
Ci-devant les marchands de Laigle s’approvifion-
noient de fil de laiton dans les magafins de Rouen
& de Paris ; aucun d’eux n’alloit plus loin. Depuis
environ trente-cinq ans, plufieurs vont chercher ces
matières jufques dans les fources mêmes, c’eft-à-
dire, dans les forges de Suède 8c d’Allemagne. Il
’ y en a eu qui ont été jufqu’à arrher d’avance tout
ce que les forges de Suède pouvoient en fabriquer
pendant un an : de cette forte le fil leur revient à
beaucoup meilleur marché.
Comme la manufa&ure eft établie dans une
faetite ville de province, 8c qu’elle eft même en
grande partie répandue dans les campagnes voil
e s , où les denrées qui fervent à la nourriture
font à bon marché , on peut plus aifément y mettre
la main-d’oeuvre à bas prix ; car les ouvriers fe
déterminent toujours à travailler, pourvu qu’on
leur donne une' récompenfe qui puifte les faire
iubfifter.
Cet article eft tout-à-fait intéreffant dans les
mamifa&ures ; & c’eft un avantage qu’on ne peut
pas fe procurer dans les grandes villes, où tout ce
qui fert à la vie eft beaucoup plus cher ; c’eft ce
qui a fait tomber les manufactures de Paris.
Enfin, autrefois les marchands de Laigle n’en-
voyoient point leurs marchandifes ailleurs qu’à
SParis , à Rouen , & aux foires de Caen 8c de
Des épingles de fer.
Nous n’avons parlé jufqu’ici que des épingles de
laiton; on en fait aufii de. fe r , mais ce font les plus
mauyaifes ; on ne les vend prefque qu’aux femmes
de la campagne. Ilétoit même défendu aux maîtres
épingliers de Paris, par l’article x ix de leurs ftatuts,
d’en faire, fous peine de quatre écus d’amende ; 8c
c e , dit cet article, pour le profit 8c utilité publique.
Apparemment que c’eft parce que leur piqûre pafte
pour venimeufe; c’eft cependant à tort, elle le doit
être moins que celle des épingles de laiton : le fer
n’eft pas un métal aufii à craindre que le cuivre ;
oc le fel ammoniac qu’on emploie pour blanchir les
épinglés de fer, ne paroît pas capable de produire
de plus mauvais effets que le.fel de la gravelée.
Mais ce qui lés fait rejeter avec ràifon , c’eft
qu’elles font moins polies que celles de laiton ; il
leur refte fouvent des inégalités qui peuvent accro
cher 8c déchirer le linge 8c les.étoffes fines. Elles
ont néanmoins pour elles un avantage , c’eft leur
dureté ; elles font moins pliantes : fi l’on prenoit,
pour les polir, les mêmes foins qu’on prend pour
polir les aiguilles, elles mériteraient la préférence
fur les épingles de laiton., 8c jè ne fais fi la façon
du poli les rendrait plus chères. :
Au refte, nous avons expliqué leur fabrique , en
parlant de celle des épingles de laiton ; il n’y a de
différence que dans la manière de les blanchir. Après
qu’elles ont été entêtées, on les met avec du. fon
dans le même baquet où nous avons vu agiter les
autres. On les y agite pendant quelque temps ; car
elles ne s’étament bien que quand elles font bien
fèches.
Pour les blanchir , on les met dans une cruche de
terre non vernie, beaucoup plus groffe vers la panfe
que par en haut 8c par. en bas. Cette cruche , dans
les.épingleries, s’appelle une cfiance. On là couche
fur un trépied, au deffous duquel on fait du feu ; on
la remue de temps en temps, jufqu’à ce que toutes
}es épingles aient pris une couleur entre le jaune &
le bleu : alors on jette dans la chance ou cruche,
une once d’étain fin en morceaux minces; on l’y fait
fondre ; 8c lorfqu’il eft bien fondu, on jette dans le
mèmè vafe une demi-once de fel ammoniac ; on
bouche enfuite, avec un tampon de bois, l’ouverture
delà chance, 8c l’Ouvrier la prend entre fes deux
bras ; il la fecoue, faifant aller les épingles d’un bout
à l’autre ; il lui donne environ une cinquantaine de
coups, après lefquels les épingles font blanches. Il
débouche 8c vide la chance dans un baquet plein
d’eau froide ; au deffus de ce baquet eft un crible
affezlarge, compofè de divers petits bâtons en croix;
e’eft dans ce crible qu’on verle immédiatement les
épingles : avant de tomber dans l’eau, elles paffent
entre ces bâtons qui les féparent, 8c les empêchent
de fe coller les unes aux autres.
On blanchiffoit autrefois les. épingles de laiton de
la même manière; mais cette façon n’eft pas à beaucoup
près aufii parfaite que celle qui eft. à préfent
en ufage, 8c que nous avons tirée d’Angleterre il
n’y a pas cinquante ans, à ce que difent nos ouvriers.
C’eft cette manière de blanchir qui fait que nos épingles
ne le cèdent plus à celles que fabriquent les An-
glois. Les épingles étamées dans la cruche de terre,
par le moyen du fel ammoniac, rie faitroient être
étamées aufii également 8c aufii uniment que les
autres ; l’étain même les rend raboteufes en divers
endroits : l^s ouvriers difent queTétamure faité dans
la chance eft plus durable, & cela eft vrai. Mais ce
n’eft pas . un avantage à compter pour les épingles ;
car on ne s’avife guère d’appréhender qu’elles s’ufent
trop vite.
On retire de l’eau les épingles de fer ; on les met
dans un fac de cuir avec du fon, où deux ouvriers
les agitent : chacun d’eux tient un des bouts du fac : j
c’eft apparemment pour ménager leurs pointés plus
caftantes que celles des épingles de laiton, qu’on eft
dans l’ufage de les fécher dans le cuir, 8c non dans
la frottoire.
Manière d'argenter les épingles.
Il faut prendre un demi-gros d’argent fin , 8c le
faire diffoudre dans une demi-once d’eau-forte ;
prendre enfuite une once de fel marin, 8c une once
de tartre blanc ; les bien pulvérifer enfemble, 8c
jeter ces fels dans l’eau-forte où l’argent a été dif-
fous ; bien mêler le tout dans un mortier de verre.;
& fi l’eau-forte ne fuffifoit pas pour rendre la pâte
coulante, on y mettrait de Peau fimple jufqu’à ce
que le tout fît une pâte molle. On peut garder cette
compofition très-long-temps. Loriqu’elle' eft fèche
& que l’on veut s’enfervir, l’on met un peu d’eau
pour amollir la pâte. Pour l’employer, après avoir
éclairci le laiton, on le frotte avec cette pâte; ce
qu’on peut exécuter dans la chance ou dans une
petite frottoire : on lave enfuite les pièces dans de
l’eau claire ; on les fèche , comme il a été dit, avec
du fon.. Les épingles fe trouvent ainfi argentées,
a la vérité fi fuperfiçiellement, aue les foottemens
font bientôt reparaître le cuivre. Mais il cto de
même de Pétain avec lequel on les blanchit.
C ’eft bien peu de chofe que ces épingles argentées.
Il 1 ferait plus facile de les blanchir avec le
mercure. On fait en Angleterre des épingles argentées,
qui font de durée. Pour'cet effet, avant de
paffer le fil de laiton à la filière, on le couvre d une
mince feuille d’argent, qui coûté bien peu, à caufe
de l’extrême, ténuité des lames.
A quelles, marques on connoit les bonnes épinglesi .
Les épingles doivent être roides, proportionnel-*
lement à leur groffeur : c’eft un grand défaut pour
dés épingles que de plier quand on veut les faire
entrer dans une étoffe qui réfifte un peu. 11 faut
examiner avec foin fi les pointés font bien formées,
bien arrondies , 8c fur-tOuf . f i elles n’égratignent
point. La tête doit être bien arrondie, bien placée
à l’extrémité de là hanfe, fans pencher ni de cote
ni d’autre. Enfin elles doivent être blanches comme
fi elles étaient argentées. .
Différentes 'fortes d'épingles qui ont ete d ufage•
On faifoit autrèfois des épingles noires de fer,
8c ce font les feules épinglée de fer qu’il (oit permis
à nos épingliers de^Paris de fabriquer. Mais la mode
les leur a interdites pendant plufieurs années ; on
■ les portoit dans le deuil ; on a retranché cela de ce
cérémonial. Les épingles noires font maintenant
d’un ufage très-commun, parce que les femmes OC
même les hommes s’en fervent pour foutenir les
boucles de leurs cheveux. Elles font menues oc
longues.^d’un pouce trois quarts.
C ’eft u ri vernis noir qui leur donne cette couleur.
Rien n’eft plus fimple & plus facile que de noircir
des épingles de fer. On prend un pot de terre:, on
l’emplit d’épingles fur lefquelles on verfe de 1 huile
de lin , autant qu’il en faut pour mouiller toutes les
épingles. Enfuite ôn met le pot chauffer auprès du
feu; peridant qu’il chauffe, on remue continuellement
les épingles, de manière à faire revenir au
deffus celles qui font deffous : ce qui fe fait par un
mouvement qu’on donne au pot en le tenant par
la queue. Lorfque le pot eft bien échauffé , il en
fort une fumée qui eft d’une puanteur infupporta-
ble .‘.cependant les épingles (e noirciffent d elles-
mêmes ; 8c quand on voit qu’ elles font bien noires ,
on retire le pot, 8c on renverfe les épingles fur une
feuille de gros papier ,• où on les étale le moins épais
qu’on, peut. En refroidiflant elles fe fèchent, oc
prennent un vérnis éclatant, fans qu’il foit befom
d’ajouter d’autres drogues : l’huile feule produit cet
effet. On fe fert de la même méthode pour noircir
les agraffes ou crochets à chapeau : on pourroit de
même noircir toutes fortes de matière de fer. Les
épingles noires qu’on vend à Paris, au lieu d’être
unies , font rudes 8c raboteufes. On les rend telles
exprès ; elles 11e fervent qu’aux cheveux : fi elle*
étoient unies, elles quitteraient aifément, leur place
, 8c tomberaient de la tête :• quand elles font rut
i j'