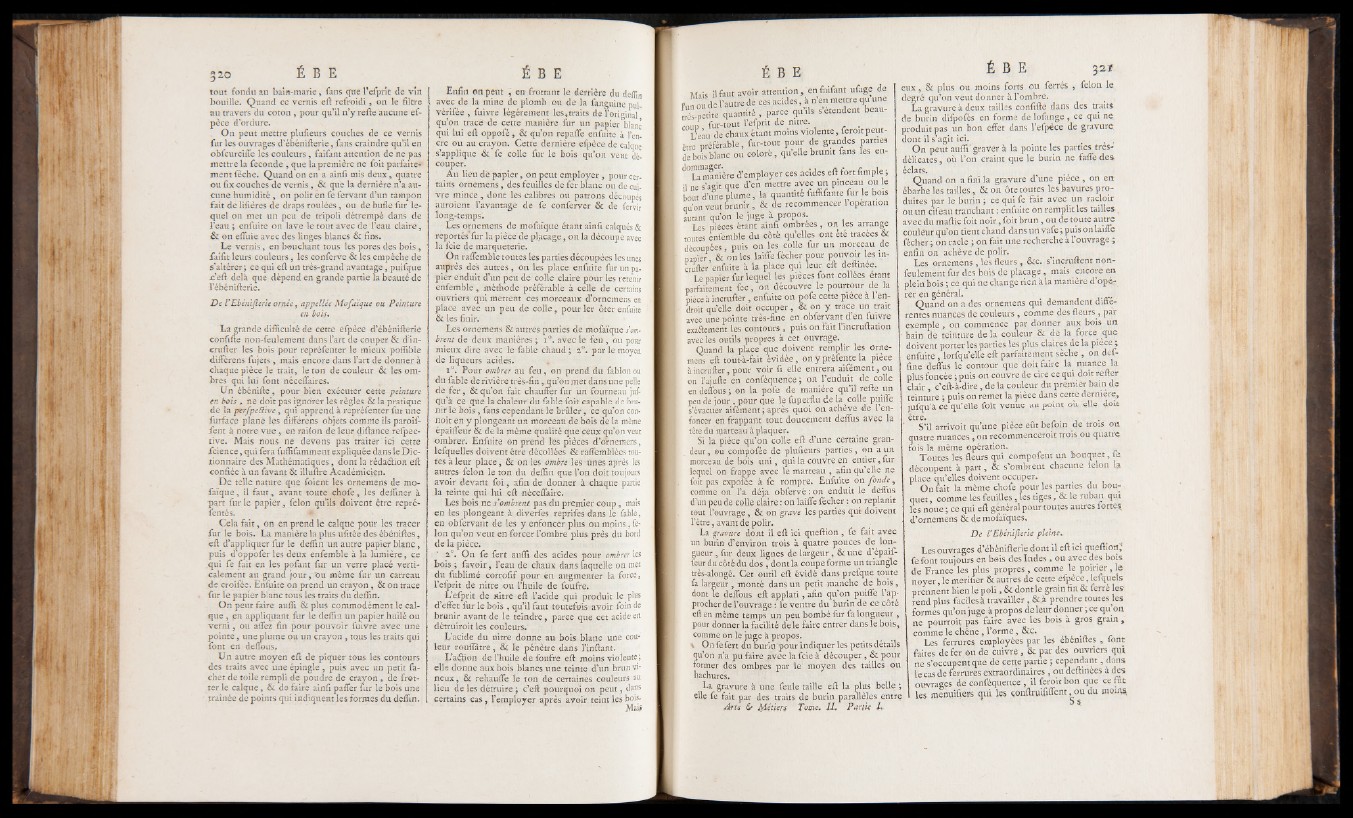
tout fondu au bain-marie, fans que l'efprit de vin
bouille. Quand ce vernis eft refroidi, on le filtre
au travers du coton, pour qu’il n’y refte aucune ef-
pèce d’ordure.
On peut mettre plufieurs couches de ce vernis
fur les ouvrages d’ébénifterie, fans craindre qu’il en
obfcureiffe les couleurs, faifant attention de ne pas
mettre la fécondé , que la première ne foit parfaitement
fèche. Quand on en a ainfi mis deux, quatre
ou fix couches de vernis, & que la dernière n’a aucune
humidité , on polit en fe fervant d’un tampon
fait de lifières de draps roulées, ou de bufle fur lequel
on met un peu de tripoli détrempé dans de
l’eau ; enfui te on lave le tout avec de l’eau claire,
& on efluie avec des linges blancs & fins.
Le vernis, en bouchant tous les pores des bois,
faifit leurs couleurs, les conferve & les. empêche de
s’altérer; ce qui eft un très-grand avantage, puifque
•c’eft delà que dépend en grande partie la beauté de
l’ébénifterie.
De VEbénijlerie ornée, appellée Mofaïque ou Peinture
en bois.
La grande difficulté de cette efpèce d’ébénifterie
confine non-feulement dans l’art de couper & d’in-
erufter les bois pour repréfenter le mieux poffible
différens fujets , mais encore dans l’art de donner à
chaque pièce le trait, le ton de couleur & les ombres
qui lui font néceffaires.
Un ébénifte, pour bien exécuter cette peinture
en bois , ne doit pas igndrer les règles & la pratique
de la perfpeêtïve, qui apprend à repréfenter fur une
furface plané les différens objets comme ils paroifi-
fent à notre v u e , en rail on de leur diftance refpec-
tive. Mais nous ne devons pas traiter ici cette
fcience, qui fera fuffifamment expliquée dans le Dictionnaire
des Mathématiques, dont la rédaction eft
confiée à un favant & illuftre Académicien.
De telle nature que foient les ornemens de mofaïque
, il faut, avant toute chofe, les deffiner à
part fur le papier , félon qu’ils doivent être repré*
tentés.
Cela fait, on en prend le calque pour les tracer
fur le bois. La manière la plus ufitée des ébéniftes,
eft d’appliquer fur le deffin un autre papier blanc,
puis d’oppofer les deux enfemble à la lumière, ce
qui fe fait en les pofant fur un verre placé verticalement
au grand jour, t>u même fur un carreau
de croifée. Eiifuite on prend un crayon , & on trace
fur le papier blanc tous les traits du deffin.
On peut faire auffi & plus commodément le calque
, en appliquant fur le deffin un papier huilé ou
verni, ou affez fin pour pouvoir fuivre avec une
pointe, une plume ou un crayon, to.us les traits qui
font en deffous.
Un autre moyen eft de piquer tous les contours
des traits avec une épingle, puis avec un petit fa-
chet de toile rempli de poudre de crayon, de frotter
le calque, & de faire ainfi paffer fur le bois une
traînée de points qui indiquent les formes du deffin.
Enfin on peut en frottant le derrière du defTm
avec de la mine de plomb ou de la fanguine pub
vérifée , fuivre légèrement les*traits de l’original
qu’on tracé^de cette manière fur un papier blanc
qui lui eft oppofé, & qu’on repafle enfuite à l’en-
cre ou au crayon. Cette dernière efpèce de calque
s’applique & fe colle fur le bois qu’on veut découper.
Au lieu dé papier, on peut employer , pour certains
ornemens, des feuilles de fer blanc ou de cuivre
mince, dont les calibres ou patrons découpés
auroient l’avantage de fe conferver & de fervir
long-temps'.
Les ornemens de mofaïque étant ainfi calqués &
reportés fur la pièce de placage, on la découpe avec
la fcie de marqueterie.
On raffemble toutes les parties découpées les unes
auprès dés autres, on les place enfuite fur un papier
enduit d’un peu de colle claire pour les retenir
enfemble, méthode préférable à celle de certains
ouvriers qui mettent ces morceaux d’ornemens en
place avec un peu de colle, pour 1er ôter enfuite
& les finir.
Les ornemens & autres parties de mofaïque som-
brent de deux manières ; i°. avec le feu , ou pour
mieux dire avec le fable chaud ; par le moyen
de liqueurs acides.
i° . Pour ombrer au feu, on prend du fablonou
du fable de rivière très-fin, qu’on met dans une pelle
de fe r , & qu’on fait chauffer fur un fourneau juf-
qu’à ce que la chaleur du fable foit capable de brunir
le bois, fans cependant le brûler, ce qu’on con-
noît en y plongeant un morceau de bois de la même
épaiffeur & de la même qualité que ceux qu’on veut
ombrer. Enfuite on prend lés pièces d’ornemens,
lefquelles doivent être décollées & raffemblées toutes
à leur place, & on les ombre les Unes après les
autres félon le ton du deffin que l’on doit toujours
avoir devant fo i , afin de donner à chaque partie
la teinte qui lui eft néceffaire.
Les bois ne s’ombrent pas du premier coup, mais
en les plongeant à diverfes reprifes dans le fable,
en obfervant de les y enfoncer plus ou moins , félon
qu’on veut en forcer l’ombre plus près du bord
de la pièce.
2°. On fe fert auffi des acides pour ombrer les
bois ; favoir, l’eau de chaux dans laquelle on met
du fublimé corrofif pour en augmenter la force,
l’efprit de nitre ou l’huile de foufre.
L’efprit de Ritre eft l’acide ,qui produit le plus
d’effet fur le bois , qu’il faut toutefois avoir foin de
brunir avant de le teindre, parce que cet acide en
détruiroit les couleurs.
L’acide du nitre donne au bois blanc une couleur
rouffâtre, & le pénètre dans l’inftant.
L’aâion de l’huile de foufre eft moins violente ;
elle donne aux bois blancs une teinte d’un brun vineux,
& rehauffe le ton de certaines couleurs au
lieu de les détruire ; c’eft pourquoi on peut, dans
certains cas, l’employer après avoir teint les bois.
Mai>
Mais il faut avoir attention, en faifant ufage de
IW u de l’autre de ces acides, à n’en mettre qttune
très-petite quantité, parce qu’ils s’étendent beaucoup,
fur-tout l’efpnt de nitre. .
L’eau de chaux étant moins violente, feroitpeut-
être préférable, fur-tout pour de grandes parties
de bois blanc ou coloré, qu’elle brunit fans les en-
La minière d’employer ces acides eft fort fimple ;
il ne s’aait que d’en mettre avec un pinceau ou le
bout d’une plume, la quantité fuffifante fur le bois
qu’on veut brunir, & de recommencer 1 opération
autant qu’on le juge .à propos.
Les pièces étant ainfi ombrées, on les arrange
toutes enfemble du côté qu’elles ont été tracées &
découpées, puis on les colle fur un tporceau de
papier & on les laiffe fécher pour pouvoir les in-
cnifter enfuite à la place qui leur eft deftinée.
Le papier fur lequel les pièces font collées étant
parfaitement fe c , on découvre le pourtour de la
pièce à incrufter , enfuite on pofe cette pièce à l'endroit
qu’elle doit occuper, & on y trace un trait
avec une pointe très-fine en obfervant d’en fuivre
exaftement les contours, puis onîait l’incruftation
avec les outils propres à cet ouvrage.
Quand la place que doivent remplir les ornemens
eft tout-à-fait évidée, on y préfente la pièce
à incrufter, pour voir fi elle entrera aifément, ou
on l’ajufte en conféquence ; on l’enduit de colle
en deffous ; on la pofe de manière qu’il refte un
peu de jour , pour que le fùperflu de la colle pùiffe
s’évacuer aifément ; après quoi on achève de l’enfoncer
en frappant tout doucement deffus avec la
tête du marteau à plaquer.
Si la pièce qu’on colle eft d’une certaine grandeur.,
ou compofée de plufieurs parties, qn a un
morceau de bois u n i, qui la couvre en entier, fur
lequel on frappe avec le marteau , afin qu’elle ne J
foit pas expofèe à fe rompre. Enfuite on fonde,
comme on l’a déjf. obfervé : on enduit le deftîis
d’un peu de colle claire : on laiffe fécher : on replanit
tout l’ouvrage, & on grave les parties qui doivent
l’être, avant de polir.
La gravure dont il eft ici queftion , fe fait avec
un burin d’environ trois à quatre pouces de longueur
, fur deux lignes de largeur, & une d’épaif-
leur du côté du dos , dont la coupe forme un triangle
très-alongé. Cet outil eft évidé dans prefque toute
fa largeur, monté dans un petit manche de bois,
dont le deffous eft applati, afin qu’on puiffe l’approcher
de l’ ouvrage : le ventre du burin de ce côté
eft en même temps un peu bombé fur fa longueur,
pour donner la facilité de le faire entrer dans le bois,
comme on le juge à propos.
\ On fe fert du buriq pour indiquer les petits détails
qu’on n’a pu faire ^avec la fcie à découper , & pour
former des ombres par le moyen des tailles ou
hachures.
La gravure à une feule taille eft la plus belle ;
elle fe fait par des traits dp burin parallèles entrç
Arts 6* £içtiers Tome. II, Partie T
eux, & plus ou moins forts ou ferrés , félon le
degré qu?on veut donner à l’ombre. ,
La gravure à deux tailles confifte dans des traits,
de burin difpofés en forme de lofange , ce qui ne.
produit pas un bon effet dans l’efpèce de gravure
dont il s’agit ici. . * .
On peut auffi' graver à la pointe les parties tres-
délicates, où l’on craint que le burin ne faffe des
éclats.
Quand on a fini la gravure d’une pièce , on eit
ébarbe les tailles, & on ôte toutes les bavures produites
par le burin ; ce qui fe fait avec un racloir
ou un cifeau tranchant : enfuite on remplit les tailles .
avec du maftic foit noir,, foit brun, ou de toute autre
couleur qu’on tient chaud dans unvafe; puis on laiffe
fécher ; on racle ; on fait une recherche à l’ouvrage ;
enfin on achève de polir.
Les ornemens , les fleurs , &c. s’incrüftent non-
feulement fur des bois de placage, mais encore en
plein bois ; ce qui ne change rien à la manière d’opérer
en général. ■ .
Quand on a des ornemens qui demandent differentes
nuances de couleurs , comme des fleurs, par
exemple, on commence par donner aux bois un
• bain de teinture de la couleur & de la force que
doivent porter les parties les plus claires de la piece ,
enfuite , lorfqu’elle eft parfaitement sèche , on def-
fine deffus le contour que doit faire la nuance la
plus foncée ; puis on couvre de cire ce qui doit refter
clair , c’eft-à-dire, de la couleur du premier bain de
teinture ; puis on remet la pièce dans cette dernière,
jufqu’à ce qu’elle foit venue au point où elle doit
être. ' . . . . . . j •
S’il arrivoit qu’une piece eut beloin de trois ou
quatre nuances, on recommenceroit trois ou quatre
fois la même opération.
Toutes les fleurs qui compofent un bouquet, le
découpent à part, & s’ombrent chacune félon la
- place qu’elles doivent occuper.
On fait la même chofe pour les parties du bouquet
, comme les feuilles, les tiges, & le ruban qui
les noue ; ce qui eft général pour toutes autres fortes,
d’ornemens & de mofaïques.
De VEbénijlerie pleine.
Les ouvrages d’èbénifterie dont il eft ici queftion?
fe font toujours en bois des Indes, ou avec des bois
de France les plus propres , comme le poirier, le
noyer, le meriùer & autres de cette efpèce, lefquels
prennent bien le poli, & dont le grain fin & ferré les
rend plus faciles à travailler , 8U prendre toutes les
formes qu’on juge à propos de leur donner ; ce qu on
ne pourroit pas faire avec les bois à gros grain ,
comme le chêne, l’orme, &ç.
Les ferrures employées par les ébéniftes , font
faites de fer ou de cuivre , & par des ouvriers qui
ne s’occupent que de cette partie ; cependant, dans
le cas de ferrures extraordinaires , ou deftinées à des
ouvrages de conféquence , il feroit bon que ce fut
1 les roenuifiers qui les çonftruififfent, ou du moins.
S s