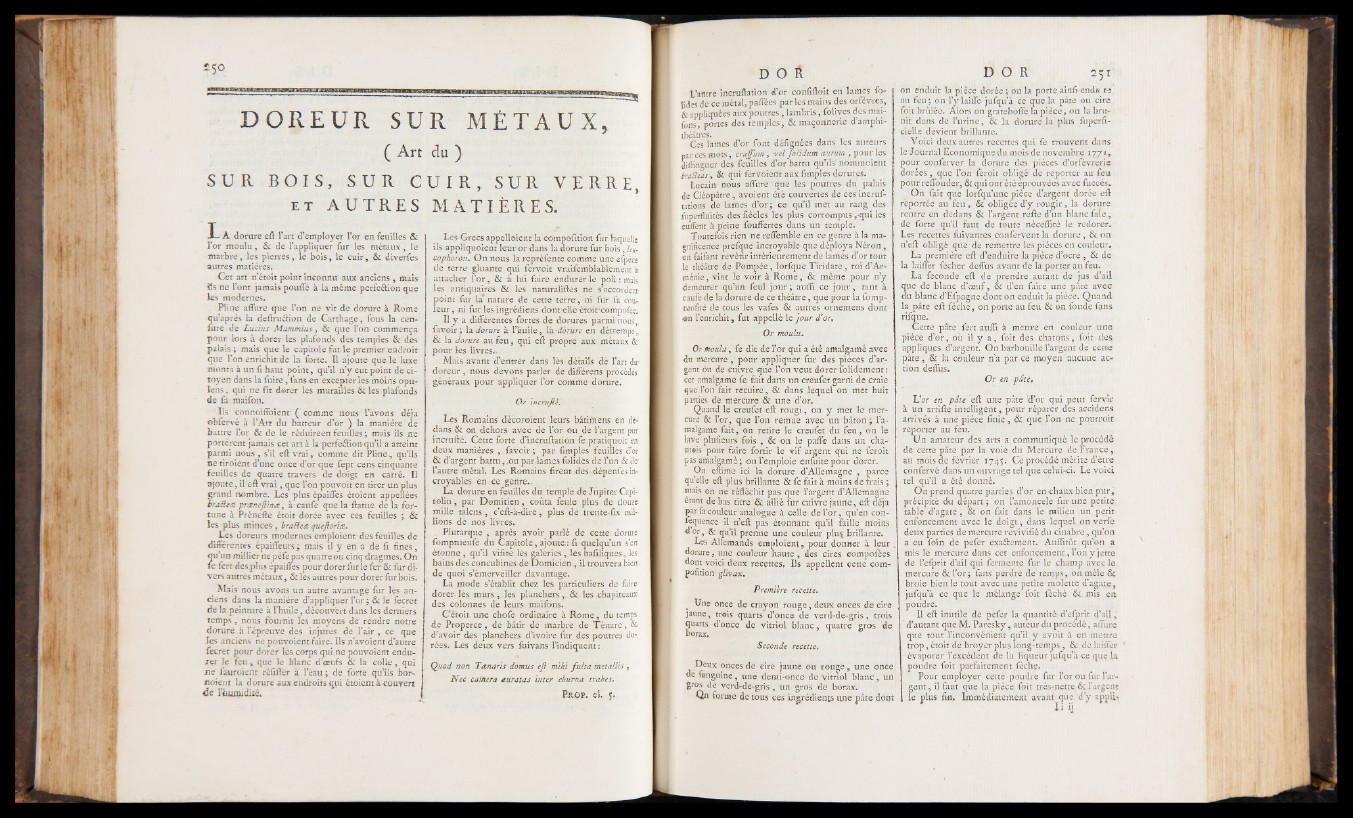
DOREUR SUR MÉTAUX,
( Art du )
S U R B O I S , S U R C U I R , SUR V E R R E ,
e t A U T R E S MA T I È R E S .
I - A dorure eft l’art d’employer For en feuilles &
l’or moulu, & de l’appliquer fur les m é ta u x le
marbre, les pierres, le bois, le c u i r 6 c diverfes
autres matières.-
Cet art n’étoit point inconnu' aux anciens , mais
îls ne l’ont jamais pouffé à la même perfection que
les modernes.
Pline affure que l’on ne vit de dorure à Rome
qu’après la deffrucfion de Carthage, fous la cen-
fure de Lucius Mummius, & que l’on commença
pour lors à dorer les plafonds des temples & des
palais ; mais que le capitole futle premier endroit
que l’on enrichit.de la forte. Il ajoute que le luxe
monta à un fi haut point, qu’il n’y eut point de citoyen
dans la fuite, fans en excepter les moins opu-
lens, qui ne fît dorer les murailles 6c les plafonds
de fa maifon.
Ils connoiffoient- ( comme nous l’avons déjà
©bfervé à l’Art du batteur d’or ) la manière de
battre lîor & de le réduireen feuilles ; mais ils ne
portèrent jamais cet art à la perfe&ion qu’il a atteint
parmi nous , s’il eff vrai, comme dit Pline, qu’ils
Be tiroient d’une once d’or que fept cens cinquante
feuilles de quatre travers de doigt en carré. Il
ajoute, il eff v ra i, que l’on pouvoit en tirer un plus
grand nombre. Les plus épaiffes étoient appellées
bmctecz pranefiïrut, à'caufe que la ffatue de la fortune
à Préneôe étoit dorée avec ces feuilles ; &
lés plus minces-, braElecz quefioriee.
Les doreurs modernes emploient des feuilles de
différentes épaiffeurs;■ mais il y en a de fi fines,
qu’un millier ne pèfepas quatre ou cinq dragmes. On
ie fert desplus épaifles pour dorer fur le fer & fur divers
autres métaux, &les autres pour dorer fur bois.
Mais nous avons un autre avantage fur lès anciens
dans la manière d’appliquer l’or ; & lè fecret
de la peinture à l’huile,découvert dans les derniers
temps, nous fournit les moyens dè rendre notre
dorure à l’épreuve des injures de l’air , ce que
les anciens ne pouvoient faire. Ils n’avoient d’autre
fecret pour dorer lés corps qui ne pouvoiènt endurer
le feu , que le blanc d’oeufs 6c la colle, qui
ne fauroient réfiffèr a l’èau ; dé forte qu’ils bot-
noient la dorure aux endroits qui étoient à couvert
de 1’buQkidité.
Les Grecs appelaient la compofition fur laquelle
ils appliquoient leur or dans la dorure fur bois, leu-
cophoron. On nous la repréfente comme une efpèce
de terre gluante qui fervoit vraifemblablement à
attacher l’or , & à lui faire endurer le poli : mais
les antiquaires & les naturaliftes ne. s’accordent
point fur la* nature de cette terre , ni fur fa couleur
, ni fur les ingrédiens dont ellè étoit compofée,-.
Il y a différentes fortes de dorures parmi nous ,,
fa voir ; la dorure à l’huile, Xk-dorure en détrempe,.
& la dorure au feu , qui eff propre aux métaux &’
pour lés livres.--
Mâis -avant d’entrer dans lès détails dè l’art dir
doreur , nous devons parler de différens procéder
généraux pour appliquer l’or comme dorure.
Or incrufie.
Les Romains dècoreiènt leurs bâtimens en de»
dans.6c en dehors avec de l’or ou de l’argent pur
incrufté. Cette forte d’incruftation fe pratiquoit en
deux manières-, ,fàvoir ; par fimples feuillès d’or
& d’argent battu ,,ou par lames folidès de l’un & dé
l’autre métal* Les Romains firent des. dépenfes incroyables
en.ee genre-
La dorure en feuilles dû temple de Jupiter Capitolin
, par Domitien, coûta feule plus de douze
mille talens ,. c’eft-à-dire , plus de trente-fix millions
dè nos livres.
Plutarque ,. après avoir parlé de cette dorure'
fomptueufe du Capitole, ajoute: fi quelqu’un.s’en-
étonne , qu’il vifite les galeries, lés bafiliques, les
bains des concubines de Domicien, il trouvera bien-
de quoi s’émerveiller davantage.
La mode s’établit chez les particuliers de faire
dorer-lès murs , les planchers ,„6c. les chapiteaux*
des colonnes de leurs maifons.
C’étoit. une chofe ordinaire à Rome, du temps
de Properce, de bâtir dè marbre de Téiiare, &
d’avoir des planchers d’ivoire ftir des poutres dorées.
Les deux vers fuivans l’indiquent:.
Quod non Tctnaris domus efl mihi fulta metallis,,
Nec ca filera aurai as inter eburna trabes.
Prop. el. 5.
L’antre incruftation d’or confiftoit en lames fondes
de ce métal, paffées parles mains des orfèvres,
& appliquées aux poutres, lambris, folives des maifons,
portes des temples , . & maçonnerie d’amphithéâtres.
Ces lames d’or font défignées dans les auteurs
par ces mots, crajfum, vel folidum aururn , pour les
diftinguer des feuilles d’or battu qu’ils nommoient
bratieas, & qui fervoient aux fimples dorures.
Lucain nous affure que les poutres du palais
de Cléopâtre, avoient.été couvertes de ces incruf-
tations de lames d’o r ; ce qü’il mét au rang des
fuperflnités des fiêcles les plus corrompus ,-qui les
euffent à peine fouffertes dans un temple.
Toutefois rien ne reffemble en ce genre à la magnificence
prefque incroyable que déploya Néron,
en faifant revêtir intérieurement de lamés d’or tout
le théâtre de Pompée, lorfque Tiridate, roi d’A rménie,
vint le voir à Rome, 6c même pour n’y
demeurer qu’un feul jour; auffi ce jour, tant à
caufe de la dorure de ce théâtre, que pour la fomp-
•tuofitè de tous les vafes 6c autres ornemens dont
«n l'enrichit, fut appellé le jour d’or*
Or moulu.
Or moulu, fe dit de l’or qui a été amalgamé avec
du mercure, pour appliquer fur des pièces d’argent
ou de -cuivre que l’on veut dorer iolidement :
cet amalgame fe fait dans un creufet garni de craie
que l’on fait recuire, 6c dans lequel on met huit
parties de mercure & une d’or.
Quand le creufet efl: rougi, on y met le mercure
& l’or, que l’on remue avec un bâton ; l’amalgame
fait, on retire le creufet du feu, on le
lave plufieurs fois , & on le paffe dans un chamois
pour faire fortir le v if argent qui ne feroit
pas amalgamé ; on l’emploie enfuite pour dorer.
On eftime ici la dorure d’Allemagne , parce
qu’elle eff plus brillante & fe fait à moins de frais ;
mais on ne réfléchit pas que l’argent d’Allemagne
étant de bas titre 6c allié fur cuivre jaune, eff déjà
■ par fa couleur analogue à celle de l’o r , qu’en confluence
il n’eft pas étonnant qu’il faille moins
d or, 6c qu’il prenne une couleur plu$ brillante.
Les Allemands emploient, pour donner à leur .
dorure, une couleur haute, des cires compofées
dopt voici deux recettes, Ils appellent cette com-
fofition glivax,
Première recette.
Une once de crayon rouge, deux onces de cire
jaune, trois quarts d’once de verd-de-gris, trois
quarts d’once de vitriol blanc, quatré gros de
borax.
Seconde recette,
Deux onces de cire jaune ou rouge, une once
dé fanguine, une demi-once- de vitriol blanc, un
gros de verd-de-gris, un gros de borax.
Qu forme de tous ces ingrédients une pâte dont
on enduit la pièce dorée ; on la porte ainfi-endis te
au feu ; on l’y laiffe jufqu’à ce que la pâte ou cire
foit brûlée. Alors on grateboffe la pièce, on la brunit
dans de Turine, & la dorure.la plus fuperfi-
cielle devient brillante.
Voici deux autres recettes qui fe trouvent dans
le Journal-Economique du mois de novembre 1771,
pour conferver la dorure des pièces d’orfèvrerie
dorées, que Ton feroit obligé de reporter au feu
pour reffouder, 6c qui ont été éprouvées avec fuccès.
On fait que lorfqu’une pièce d’argent dorée eff
reportée au feu , 6c obligée d’y rougir, la dorure
rentre en dedans 6c l’argent refte d’un blanc fale,
de forte qu’il faut de toute nécefîité le redorer.
Les recettes fuivantes confervent la dorure, 6c on
n’eff obligé que de remettre les pièces en couleur.
La première eff d’enduire la pièce d’ocre, ôc de
la laiffer fécher deffus avant de la porter au feu.
La fécondé eff de prendre autant de jus d’ail
que de blanc d’oe uf, oc d’en faire une pâte avec
du blanc d’Efpagne dont on enduit la pièce. Quand
la pâte eff fèché, on porte au feu 6c on foude fans
rifque.
Cette pâte fort auffi à mettre en couleur une
pièce d’o r, ou il y a , foit des chatons, foit des
appliques d’argent. On barbouille l’argent de cette
pâte, 6c la couleur n’a par ce moyen aucune action
deffus»
Or en pâte.
Vor en pâte eff une pâte 'd’or qui peut fervir
à un artifte intelligent,. pour réparer des accidens
arrivés à une pièce finie, 6c, que l’on ne pourroit
reporter au feu.
Un amateur des arts a communiqué le procédé
de cette pâte par la voie.du Mercure de France,
au mois de février 1745. Ce procédé mérite d’être
confervé dans un ouvrage tel que celui-ci. Le voici
tel qu’il a été donné.
On prend quatre parties d’or en ■ chaux-bien pur,'
précipité du départ; on l’amoncele fur une petite
table d’agate, 6c on fait dans le milieu un petit
enfoncement avec le doigt, dans lequel onverfe
deux parties de mercure revivifié du cinabre, qu’on
a eu foin de pefer exactement. Auflitôt qu’on a
mis le mercure dans cet enfoncement, l’on y jette
de l’efprit d’ail qui fermente fur le champ avec le
mercure 6c l’o r; fans perdre de temps, on mêle 6c
broie bien le tout avec une petite molette d’agate,
jufqu’à ce que le mélange foit féché 6c mis en
poudre.
Il eff inutile de pefer la quantité d’efprit d’a i l,'
d’autant que M. Paresky, auteur du procédé, affure
que tout l’inconvénient qu’il y avoit à en mettre
trop, étoit de broyer plus long-temps , 6c de laiffer
évaporer l’excédent de la liqueur jufqu’à çe que la
poudre foit parfaitement fèchç.
Pour employer cette poudre fur l’or ou fur l'argent,
il faut que la pièce foit très-nette 6c.l’argent
le plus fin. Immédiatement avant que d’y appli-
1 1