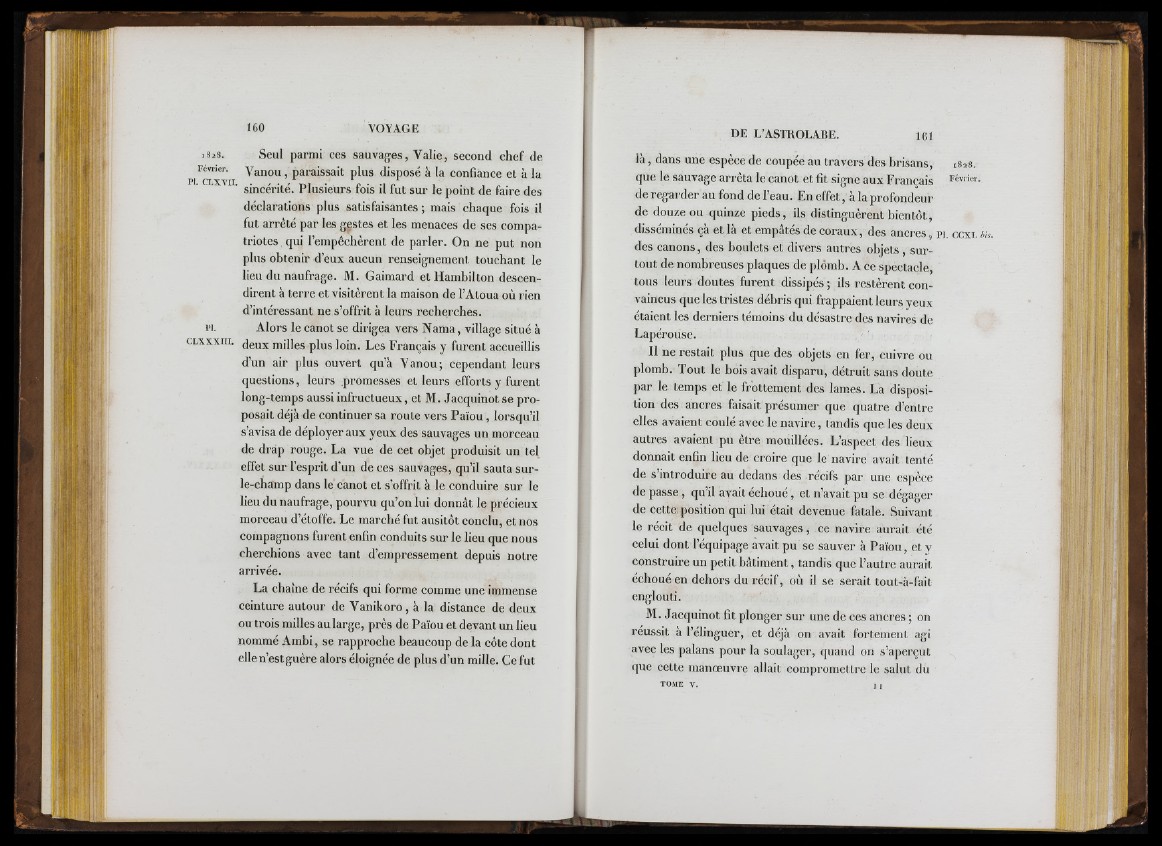
. -5
' »
ji: : ;
iM
160 VOYAGE
1.H2S.
Février.
Pi. C L X Y U .
P L
C LX X X I I I .
Seul parmi ces sauvages, Valie, second chef de
Vanou, paraissait plus disposé à la confiance et à la
sincérité. Plusieurs fois il fut sur le point de faire des
déclarations plus satisfaisantes ; mais chaque fois il
fut arrêté par les gestes et les menaces de ses compatriotes
qui l’empêchèrent de parler. On ne put non
pins obtenir d’eux aucun renseignement touchant le
lieu du naufrage. M. Gaimard et Hambilton descendirent
à terre et visitèrent la maison de l’Atoua où rien
d’intéressant ne s’offrit à leurs recherches.
Alors le canot se dirigea vers Nama, village situé à
deux milles plus loin. Les Français y furent accueillis
d’un air plus ouvert qu’à Vanou; cependant leurs
questions, leurs promesses et leurs efforts y furent
long-temps aussi infructueux, et M. Jacquinot se proposait
déjà de continuer sa route vers P a ïo u , lorsqu’il
s’avisa de déployer aux yeux des sauvages un morceau
de drap rouge. La vue de cet objet produisit un tel
effet sur l’esprit d’un de ces sauvages, qu’il sauta sur-
le-champ dans le canot et s’offrit à le conduire sur le
lieu du naufrage, pourvu qu’on lui donnât le précieux
morceau d’étoffe. Le marché fut ausilôt conclu, et nos
compagnons furent enfin conduits sur le lieu que nous
cherchions avec tant d’empressernent depuis notre
arrivée.
La chaîne de récifs qui forme comme une immense
ceinture autour de Vanikoro , à la distance de deux
ou trois milles au large, près de Païou et devant un lieu
nommé Ambi, se rapproche beaucoup de la côte dont
elle n’estguère alors éloignée de plus d’un mille. Ce fut
DE L’ASTROLABE.
là , dans une espèce de coupée an travers des brisans, iSas.
que le sauvage arrêta le canot et fit signe aux Français Fév. i«r.
de regarder au fond de l’eau. En effet, à la profondeur
de douze ou quinze pieds, ils distinguèrent bientôt,
disséminés çà et là et empâtés de coraux, des ancres, pi. c c x l /,h.
des canons, des boulets et divers autres objets, surtout
de nombreuses plaques de plomb. A ce spectacle,
tous leurs doutes furent dissipés ; ils restèrent convaincus
que les tristes débris qui frappaient leurs yeux
étaient les derniers témoins du désastre des navires de
Lapérouse.
Il ne restait plus que des objets en fer, cuivre ou
plomb. Tout le bois avait disparu, détruit sans doute
par le temps cl le frottement des lames. La disposition
des ancres faisait présumer que quatre d’entre
elles avaient coulé avec le navire, tandis que les deux
autres avaient pu être mouillées. L’aspect des lieux
donnait enfin lieu de croire que le navire avait tenté
de s’introduire au dedans des récifs par une espèce
de passe , qu’il avait échoué, et n’avait pu sc dégager
de cette position qui lui était devenue filiale. Suivant
le récit de quelques sauvages, ce navire aurait été
celui dont l’équipage avait pu se sauver à Païou, et v
construire un petit bâtiment, tandis que l’autre aurait
échoué en dehors du récif, où il se serait tout-à-fait
englouti.
M. Jacquinot fit plonger sur une de ces ancres ; on
réussit à l’élinguer, et déjà on avait fortement agi
avec les palans pour la soulager, quand on s’aperçut
que cette manoeuvre allait compromettre le salut du
TOM E V .