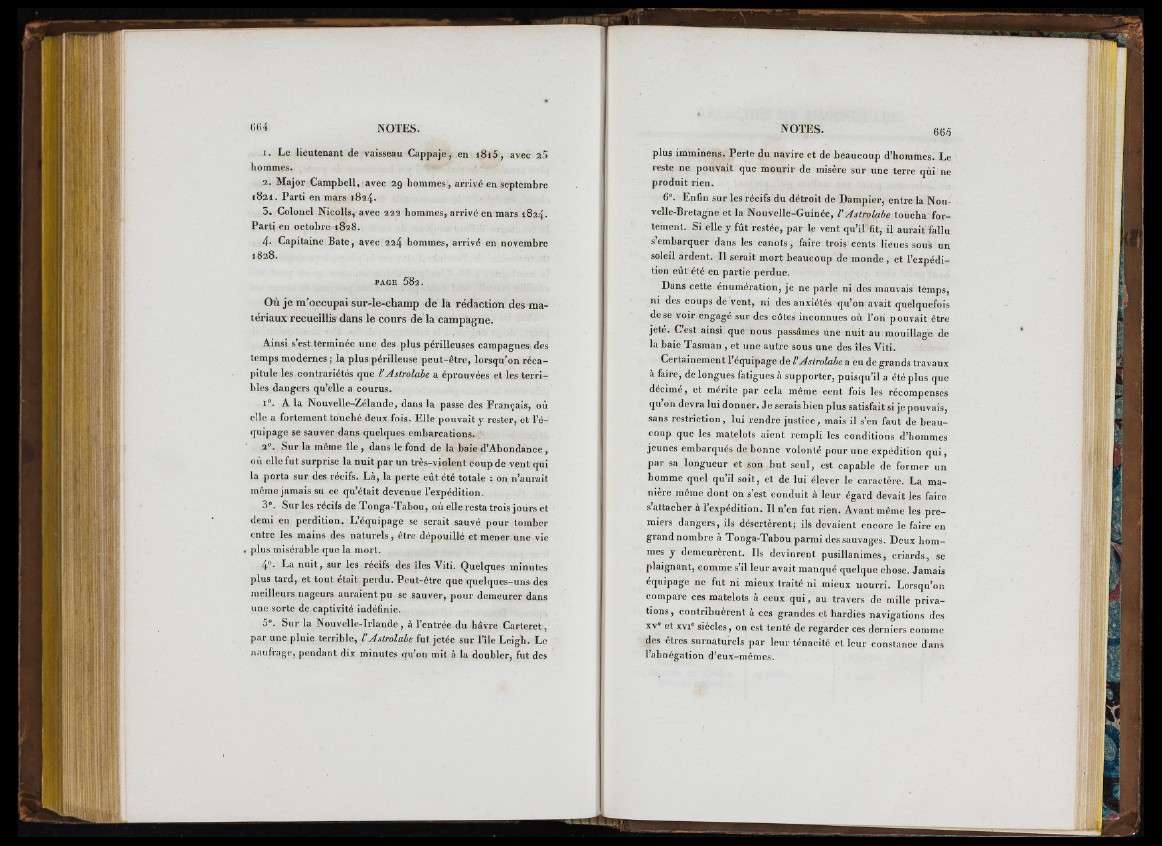
1. Le lieutenant de vaisseau Cap p aje , en i 8i 5 , avec 25
hommes.
2. Major Campbell, avec 29 hommes, arrivé en septembre
1821. Parti en mars 1824.
3. Colonel Nicolls, avec 222 hommes, arrivé en mars 1824.
Parti en octobre 1828.
4. Capitaine Ba te , avec 224 hommes, arrivé en novembre
1828.
PA G E 5 8 2 .
O ù je m 'o c cup a i sur-le-champ de la réd ac tion des maté
riaux recueillis dans le cours de la campagne.
Ainsi s’est terminée une des plus périlleuses campagnes des
temps modernes ; la plus périlleuse peut-être, lorsqu’on récapitule
les contrariétés que l’Astrolabe a éprouvées et les terribles
dangers qu’elle a courus.
1°. A la Nouvelle-Zélande, dans la passe des Français, où
elle a fortement touché deux fois. Elle pouvait y rester, et l’équipage
se sauver dans quelques embarcations.
2». Sur la même île , dans le fond de la baie d’Abondance ,
où elle fut surprise la nuit par un très-violent coup de vent qui
la porta sur des récifs. L à , la perte eût été totale : on n’aurait
même jamais su ce qu’était devenue l’expédition.
3”. Sur les récifs de Tonga-Tabou, où elle resta trois jours et
demi en perdition. L ’équipage se serait sauvé pour tomber
entre les mains des naturels, être dépouillé et mener une vie
, plus misérable que la mort.
4". La nuit, sur les récifs des îles Viti. Quelques minutes
plus tard, et tout était perdu. Peut-être que quelques-uns des
meilleurs nageurs auraient pu se sauver, pour demeurer dans
une sorte de captivité indéfinie.
5®. Sur la Nouvelle-Irlande, à l’entrée du havre Carteret,
par une pluie terrible, l’Astrolabe fut jetée sur l ’île Leigh. Le
naufrage, pendant dix minutes qu’on mit à la doubler, fut des
plus imminens. Perte du navire et de beaucoup d’hommes. Le
reste ne pouvait que mourir de misère sur une terre qui ne
produit rien.
6°. Enfin sur les récifs du détroit de Dampier, entre la Nouvelle
Bretagne et la Nouvelle-Guinée, l'Astrolabe toucha fortement.
Si elle y fût restée, par le vent qu’il fît, il aurait fallu
s’embarquer dans les canots, faire trois cents lieues sous un
soleil ardent. Il serait mort beaucoup de monde , et l’expédition
eût été en partie perdue.
Dans cette énumération, je ne parle ni des mauvais temps,
ni des coups de vent, ni des anxiétés qu’on avait quelquefois
de se voir engagé sur des cotes Inconnues où l ’on pouvait être
jeté. C’est ainsi que nous passâmes une nuit au mouillage de
la baie Tasman , et une autre sous une des îles V iti.
Certainement l’équipage de l'Astrolabe a eu de grands travaux
à faire, de longues fatigues à supporter, puisqu’il a été plus que
décimé, et mérite par cela même cent fois les récompenses
qu’on devra lui donner. Je serais bien plus satisfait si je pouvais,
sans restriction, lui rendre ju stice , mais il s’en faut de beaucoup
que les matelots aient rempli les conditions d’hommes
jeunes embarqués de bonne volonté pour une expédition q u i,
par sa longueur et son but seul, est capable de former un
homme quel qu’il so it, et de lui élever le caractère. La manière
même dont on s’est conduit à leur égard devait les faire
s’attacher à l’expédition. Il n’en fut rien. Avant même les premiers
dangers, ils désertèrent; ils devaient encore le faire en
grand nombre à Tong.a-Tabou parmi des sauvages. Deux hommes
y demeurèrent. Ils devinrent pusillanimes, criards, sc
plaignant, comme s’il leur avait manqué quelque chose. Jamais
équipage ne fut ni mieux traité ni mieux nourri. Lorsqu’on
compare ces matelots à ceux q u i, au travers de mille privations,
contribuèrent à ces grandes et hardies navigations des
XV* et xvi° siècles, on est tenté de regarder ces derniers comme
des êtres surnaturels par leur ténacité et leur constance dans
l’abnégation d’eux-mêmes.