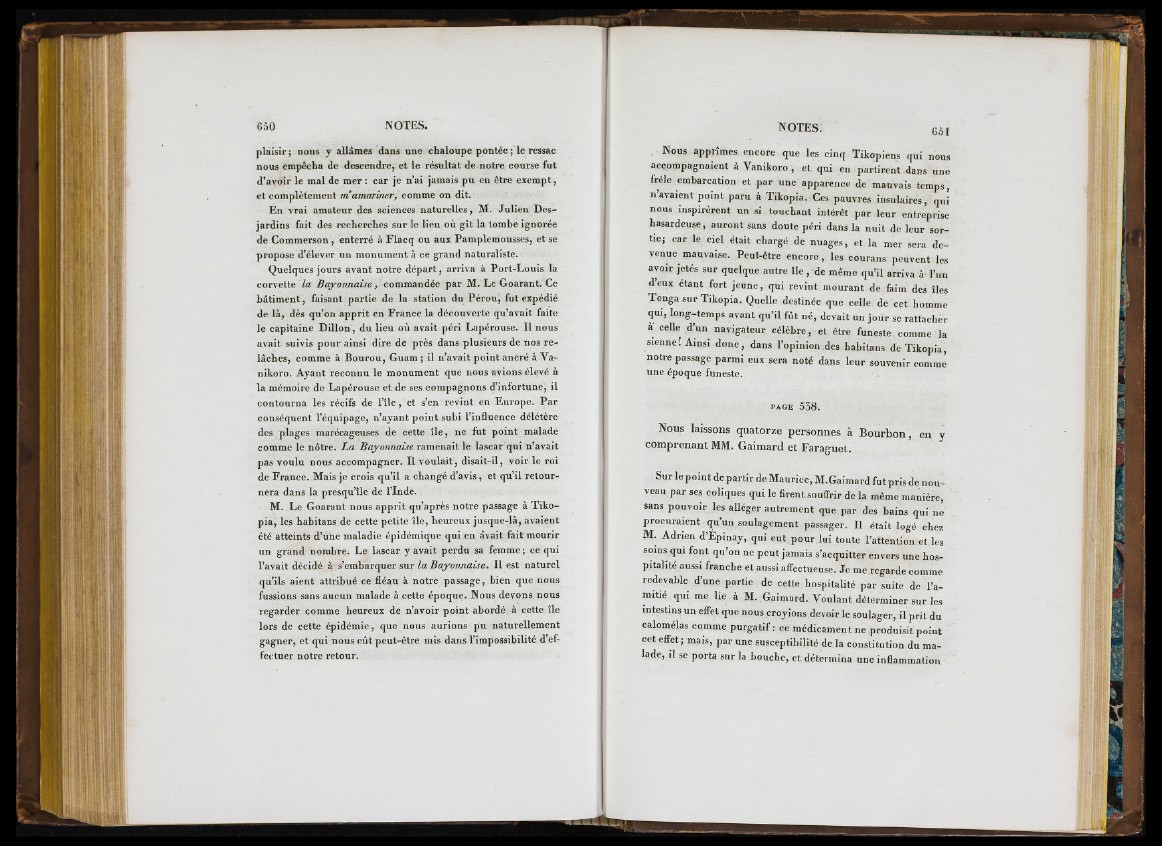
plaisir; nous y allâmes dans une ehaloupe pontée; le ressac
nous empêcha de descendre, et le résultat de notre course fut
d’avoir le mal de mer : car je n’ai jamais pu en être exempt,
et complètement m amariner, comme on dit.
En vrai amateur des sciences naturelles, M. Julien Desjardins
fait des recherches sur le lieu où gît la tombe ignorée
de Commerson, enterré à Flacq ou aux Pamplemousses, et se
propose d’élever un monument à ce grand naturaliste.
Quelques jours avant notre départ, arriva à Port-Louis la
corvette la Bayonnaise, commandée par M. Le Goarant. Ce
bâtiment, faisant partie de la station du Pérou, fut expédié
de là, dès qu’on apprit en France la découverte qu’avait faite
le capitaine Dillon, du lieu où avait péri Lapérouse. Il nous
avait suivis pour ainsi dire de près dans plusieurs de nos relâches,
comme à Bourou, Guam ; il n’avait point ancré à Vanikoro.
Ayant reconnu le monument que nous avions élevé à
la mémoire de Lapérouse et de ses compagnons d’infortune, il
contourna les récifs de l’ile , et s’en revint en Europe. Par
conséquent l’équipage, n’ayant point subi l’influence délétère
des plages marécageuses de cette île, ne fut point malade
comme le nôtre. La Bayonnaise ramenait le lascar qui n’avait
pas voulu nous accompagner. Il voulait, disait-il, voir le roi
de France. Mais je crois qu’il a changé d’avis, et qu’il retournera
dans la presqu’île de l’Inde.
M. Le Goarant nous apprit qu’après notre passage à Tikopia,
les babitans de cette petite île, heureux jusque-là, avaient
été atteints d’une maladie épidémique qui en avait fait mourir
un grand nombre. Le lascar y avait perdu sa femme; ce qui
l'avait décidé à s’embarquer sur la inyonnaàc. Il est naturel
qu’ils aient attribué ce fléau à notre passage, bien que nous
fussions sans aucun malade à cette époque. Nous devons nous
regarder comme heureux de n’avoir point abordé à cette île
lors de cette épidémie, que nous aurions pu naturellement
gagner, et qui nous eût peut-être mis dans l’impossibilité d’effectuer
notre retour.
Nous apprîmes encore que les cinq Tikopiens qui nous
accompagnaient à Vanikoro , et qui en partirent dans une
frele embarcation et par une apparence de mauvais temps,
n’avaient point paru à Tikopia. Ces pauvres insulaires, qui
nous inspirèrent un si touchant intérêt par leur entreprise
hasardeuse, auront sans doute péri dans la nuit de leur sortie;
car le ciel était chargé de nuages, et la mer sera devenue
mauvaise. Peut-être encore, les courans peuvent les
avoir jetés sur quelque autre î le , de même qu’il arriva à l’un
d’eux étant fort jeune, qui revint mourant de faim des îles
Tonga sur Tikopia. Quelle destinée que celle de cet homme
qui, long-temps avant qu’il fût né, devait un jour se rattacher
à celle d’un navigateur célèbre, et être funeste comme la
sienne! Ainsi donc, dans l’opinion des babitans de Tikopia,
notre passage parmi eux sera noté dans leur souvenir comme
une époque funeste.
PAGE 538.
Nous laissons quatorze personnes à Bourbon, en y
comprenant MM. Gaimard et Faraguet.
Sur le point de partir de Maurice, M.Gaimard fut pris de nouveau
par ses coliques qui le firent souffrir de la même manière,
sans pouvoir les alléger autrement que par des bains qui ne
procuraient qu’un soulagement passager. II était logé chez
M. Adrien d’Épinay, qui eut pour lui toute l’attention et les
soins qui font qu’on ne peut jamais s’acquitter envers une hospitalité
aussi franche et aussi affectueuse. Je me regarde comme
redevable d’une partie de cette hospitalité par suite de l’amitié
qui me lie à M. Gaimard. Voulant déterminer sur les
intestins un effet que nous croyions devoir le soulager, il prit du
ealomélas comme purgatif: ce médicament ne produisit point
cet effet; mais, par une susceptibilité de la constitution du malade,
il se porta sur la bouche, et détermina une inflammation