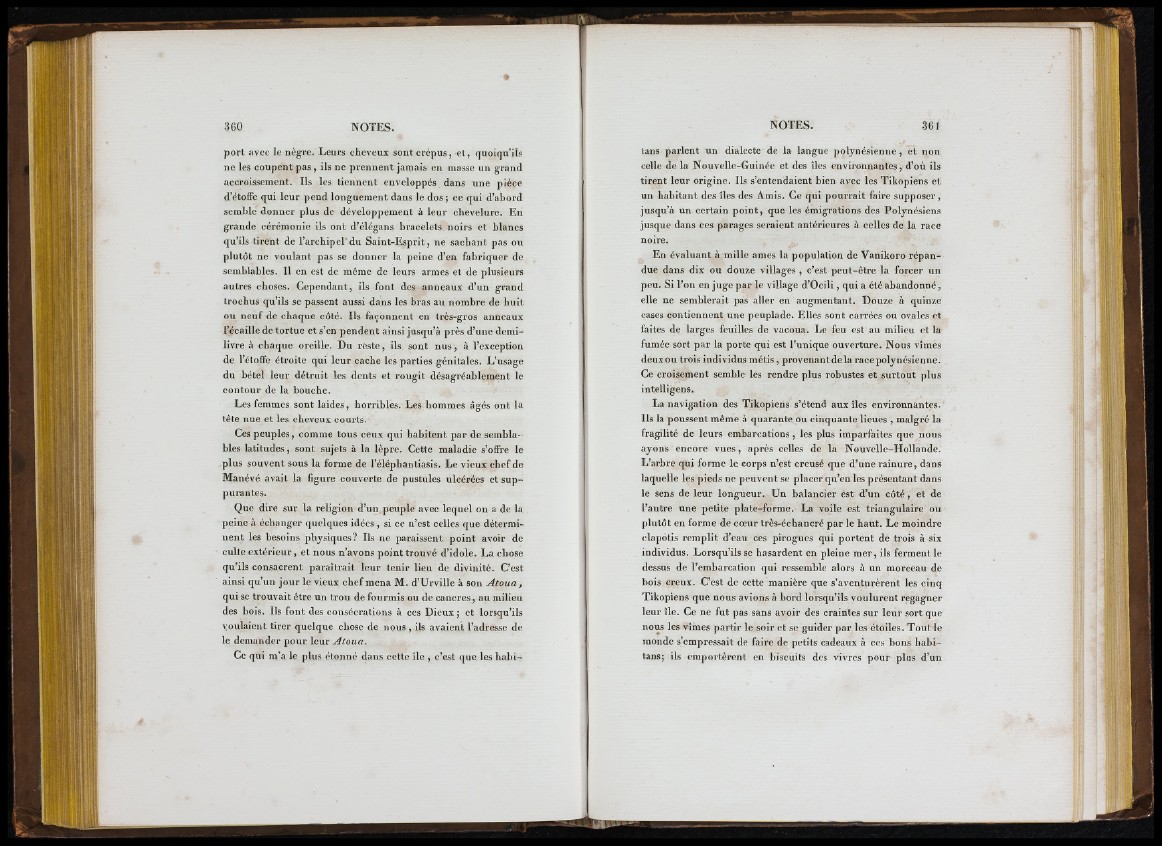
port avec le nègre. Leurs cheveux sont crépus, e t , quoiqu’ils
ne les coupent pas, ils ne prennent jamais en masse un grand
accroissement. Ils les tiennent enveloppés dans une pièce
d’étoffe qui leur pend longuement dans le dos ; ce qui d’abord
semble donner plus de développement à leur chevelure. En
grande cérémonie ils ont d’élégans bracelets noirs et blancs
qu’ils tirent de l ’arcbipcl du Saint-Esprit, ne sachant pas ou
plutôt ne voulant pas se donner la peine d’en fabriquer de
semblables. Il en est de même de leurs armes et de plusieurs
autres choses. Cependant, ils font des anneaux d’un grand
trocbus qu’ils se pa,ssent aussi dans les bras au nombre de huit
ou neuf de chaque côté. Ils façonnent en très-gros anneaux
l’écaille de tortue et s’en pendent ainsi jusqu’à près d’une demi-
livre à chaque oreille. Du reste, ils sont nus, à l’exception
de l’étoffe étroite qui leur cache les parties génitales. L ’usage
du bétel leur détruit les dents et rougit désagréablement le
contour de la bouche.
Les femmes sont laides, horribles. Les hommes âgés ont la
tête nue et les cheveux courts.
Ces peuples, comme tous ceux qui habitent par de semblables
latitudes, sont sujets à la lèpre. Cette maladie s’offre le
plus souvent sous la forme de l ’éléphantiasis. Le vieux chef de
Manévé avait la figure couverte de pustules ulcérées et suppurantes.
Que dire sur la religion d’un peuple avec lequel on a de la
peine à échanger quelques idées , si ce n’est celles que déterminent
les besoins physiques? Ils ne paraissent point avoir de
culte extérieur, et nous n’avons point trouvé d’idole. La chose
qu’ils consacrent paraîtrait leur tenir lieu de divinité. C ’est
ainsi qu’un jour le vieux chef mena M. d’Urville à son A to u a ,
qui sc trouvait être un trou de fourmis ou de cancres, au milieu
des bois. Ils font des consécrations à ces Dieux ; et lorsqu’ils
voulaient tirer quelque chose de nous , ils avaient l ’adresse de
le demander pour leur A to u a .
Ce qui m’a le plus étonné dans cette île , c ’est que les h ab itans
parlent un dialecte de la langue polynésienne , et non
celle de la Nouvelle-Guinée et des îles environnantes, d’où ils
tirent leur origine. Ils s’entendaient bien avec les Tikopiens et
un habitant des îles des Amis. Ce qui pourrait faire supposer,
jusqu’à un certain point, que les émigrations des Polynésiens
jusque dans ces parages seraient antérieures à celles de la race
noire.
En évaluant à mille ames la population de Vanikoro répandue
dans dix ou douze villages , c’est peut-être la forcer un
peu. Si l ’on en juge par le village d’O c i l i , qui a été abandonné,
elle ne semblerait pas aller en augmentant. Douze à quinze
cases contiennent une peuplade. Elles sont carrées ou ovales et
faites de larges feuilles de vacoua. Le feu est au milieu et la
fumée sort par la porte qui est l ’unique ouverture. Nous vîmes
deux ou trois individus métis, provenant de la race polynésienne.
Ce croisement semble les rendre plus robustes et surtout plus
intclligens.
La navigation des Tikopiens s’étend aux îles environnantes.
Ils la poussent même à quarante ou cinquante lieues , malgré la
fragilité de leurs embarcations, les plus imparfaites que nous
ayons encore vue s , après celles de la Nouvelle-Hollande.
L ’arbre qui forme le corps n’est creusé que d’une rainure, dans
laquelle les pieds ne peuvent se placer qu’en les présentant dans
le sens de leur longueur. Un balancier est d’un côté , et de
l’autre une petite plate-forme. La voile est triangulaire ou
plutôt en forme de coeur très-échancré par le haut. Le moindre
clapotis remplit d’eau ces pirogues qui portent de trois à six
individus. Lorsqu’ils sc hasardent en pleine mer, ils ferment le
dessus de l ’embarcation qui ressemble alors à un morceau de
bois creux. C’est de cette manière que s’aventurèrent les cinq
Tikopiens que nous avions à bord lorsqu’ils voulurent regagner
leur île. Ce ne fut pas sans avoir des craintes sur leur sort que
nous les vîmes partir le soir et se guider par les étoiles. Tout le
monde s’empressait de faire de petits cadeaux à ces bons habilans;
ils emportèrent en biscuits des vivres pour plus d’un