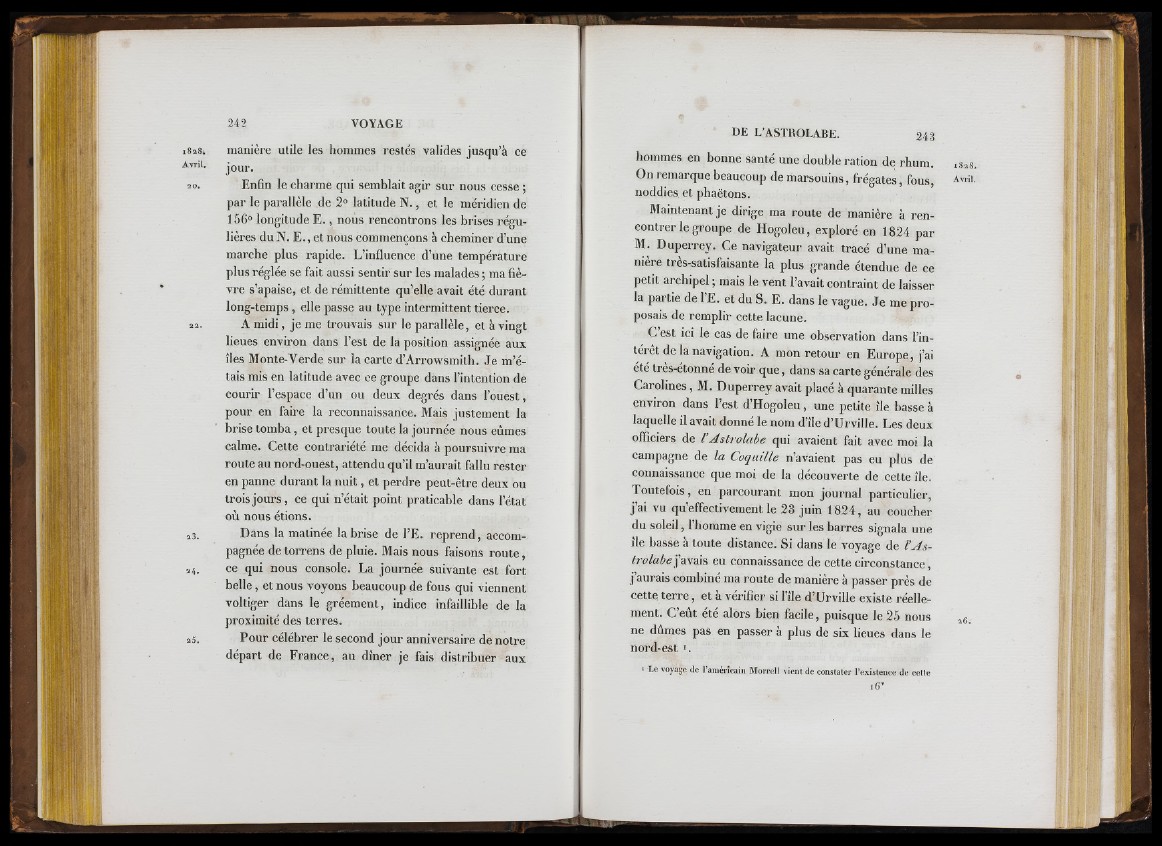
a 4.
25.
manière utile les hommes restés valides jusqu’à ce
jour.
Enfin le charme qui semblait agir sur nous cesse ;
par le parallèle de 2° latitude N ., et le méridien de
156° longitude E . , nous rencontrons les brises régulières
duN. E ., et nous commençons à cheminer d’une
marche plus rapide. L’influence d’une température
plus réglée se fait aussi sentir sur les malades ; ma fièvre
s’apaise, et de rémittente qu’elle avait été durant
long-temps , elle passe au type intermittent tierce.
A midi, je me trouvais sur le parallèle, el à vingt
lieues environ dans l’est de la position assignée aux
îles Monte-Verde sur la carte d’Arrowsmilh. Je m’étais
mis en latitude avec ce groupe dans l’intention de
courir l’espace d’un ou deux degrés dans l’ouest,
pour en faire la reconnaissance. Mais justement la
brise tom b a, et presque toute la journée nous eûmes
calme. Celte contrariété me décida à poursuivre ma
route au nord-ouest, attendu qu’il m’aurait fallu rester
en panne durant la n u it, et perdre peut-être deux ou
trois jo u rs , ce qui n’était point praticable dans l’état
où nous étions.
Dans la matinée la brise de l’E. reprend, accompagnée
de torrens de pluie. Mais nous faisons ro u te ,
ce qui nous console. La journée suivante est fort
b elle, et nous voyons beaucoup de fous qui viennent
voltiger dans le gréement, indice infaillible de la
proximité des terres.
Pour célébrer le second jo u r anniversaire de notre
départ de France, au dîner je fais distribuer aux
hommes en bonne santé une double ration de rhum.
On remarque beaucoup de marsouins, frégates, fous,
noddies et phaëtons.
Maintenant je dirige ma route de manière à rencontrer
le groupe de Hogoleu, exploré en 1824 par
M. Duperrey. Ce navigateur avait tracé d ’une manière
très-satisfaisante la plus grande étendue de ce
petit archipel ; mais le vent l’avait contraint de laisser
la partie de l’E. et du S. E. dans le vague. J e me proposais
de remplir cette lacune.
C’est ici le cas de faire une observation dans l’intérêt
de la navigation. A mon retour en Europe, j’ai
été très-étonné de voir q u e , dans sa carte générale des
Carolines, M. Duperrey avait placé à quarante milles
environ dans l’est d’Hogoleu, une petite île basse à
laquelle il avait donné le nom d’île d’Urville. Les deux
officiers de F Astrolabe qui avaient fait avec moi la
campagne de la Coquille n’avaient pas eu plus de
connaissance que moi de la découverte de cette île.
Toutefois, en parcourant mon journal particulier,
j ’ai vu qu’effectivement le 23 juin 1824, au coucher
du soleil, l’homme en vigie sur les barres signala une
île basse à toute distance. Si dans le voyage de FAs-
j’avais eu connaissance de cette circonstance,
j’aurais combiné ma route de manière à passer près de
cette te r r e , et à vérifier si l’île d’Urville existe réellement.
C’eût été alors bien facile, puisque le 25 nous
ne dûmes pas en passer à plus de six lieues dans le
nord-est i.
I L e voyage de l’américain M orrell y ie iUde constater l’existence de cette
i6'‘
1 :
M'sin
!î