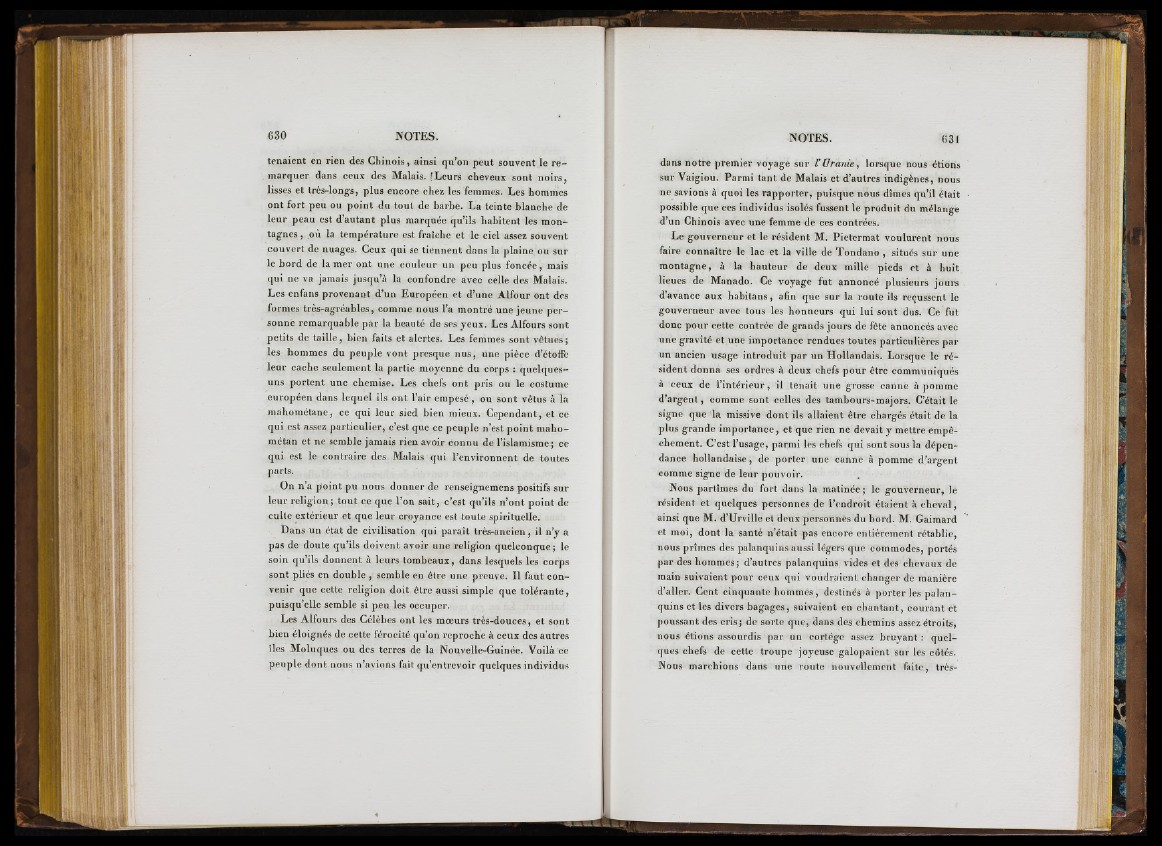
i r
15
I k : ;
tenaient en rien des Chinois, ainsi qu’on peut souvent le remarquer
dans ceux des Malais. fLeurs cheveux sont noirs,
lisses et très-longs, plus encore chez les femmes. Les hommes
ont fort peu ou point du tout de barbe. La teinte blanche de
leur peau est d’autant plus marquée qu’ils habitent les montagnes
, où la température est fraîche et le ciel assez souvent
couvert de nuages. Ceux qui se tiennent dans la plaine, ou sur
le bord de la mer ont une couleur un peu plus foncée, mais
qui ne va jamais jusqu’à la confondre avec celle des Malais.
Les enfans provenant d’un Européen et d’une A lfour ont des
formes très-agréables, comme nous l’a montré une jeune personne
remarquable par la beauté de ses yeux. Les Alfours sont
petits de ta ille , bien faits et alertes. Les femmes sont vêtues;
les hommes du peuple vont presque nus, une pièce d’étoffe
leur cache seulement la partie moyenne du corps : quelques-
uns portent une chemise. Les chefs ont pris ou le costume
européen dans lequel ils ont l ’air empesé, ou sont vêtus à la
mahométane, ce qui leur sied bien mieux. Cependant, et cc
qui est assez particulier, c ’est que ce peuple n’est point malio-
métan et ne semble jamais rien avoir connu de l ’islamisme; ce
qui est le contraire des Malais qui l ’environnent de toutes
parts.
On n’a point pu nous donner de renseignemens positifs sur
leur religion ; tout ce que l ’on sait, c ’est qu’ils n’ont point de
culle extérieur et que leur croyance est toute spirituelle.
Dans un état de civilisation qui parait très-ancien, il n’y a
pas de doute qu’ils doivent avoir une religion quelconque; le
soin qu’ils donnent à leurs tombeaux, dans lesquels les corps
sont pliés en double , semble en être une preuve. II faut convenir
que cette religion doit être aussi simple que tolérante,
puisqu’elle semble si peu les occuper.
Les Alfours des Célèbes ont les moeurs très-douces, et sont
bien éloignés de cette férocité qu’on reproche à ceux des autres
îles Moluques ou des terres de la Nouvelle-Guinée. Voilà ce
peuple dont nous n’avions fait qu’entrevoir quelques individu.»
dans notre premier voyage sur l’Uranie, lorsque nous étions
sur Vaigiou. Parmi tant de Malais et d’autres indigènes, nous
ne savions à fjuoi les rapporter, puisque nous dîmes qu’il était
possible que ces individus isolés fussent le produit du mélange
d’un Chinois avec une femme de ces contrées.
L e gouverneur et le résident M. Pietermat voulurent nous
faire connaître le lac et la ville de Tondano , situés sur une
montagne, à la hauteur de deux mille pieds et à huit
lieues de Manado. Ce voyage fut annoncé plusieurs jours
d’avance aux habitans, afin que sur la route ils reçussent le
gouverneur avec tous les honneurs qui lui sont dus. Ce fut
donc pour cette contrée de grands jours de fête annoncés avec
une gravité et une importance rendues toutes particulières par
un ancien usage introduit par un Hollandais. Lorsque le résident
donna ses ordres à deux chefs pour être communiqués
à ceux de l’inté rieu r, il tenait une grosse canne à pomme
d’a rg en t, comme sont celles des tambours-majors. C’était le
signe que la missive dont ils allaient être chargés était de la
plus grande importance, et que rien ne devait y mettre empêchement.
C ’est l’usage, parmi les chefs qui sont sous la dépendance
hollandaise, de porter une canne à pomme d ’argent
comme signe de leur pouvoir.
Nous partîmes du fort dans la matinée ; le gouverneur, le
résident et quelques personnes de l ’endroit étaient à cheval,
ainsi que M. d’Urville el deux personnes du bord. M. Gaimard
et moi, dont la santé n’était pas encore entièrement rétablie,
nous primes des palanquins aussi légers que commodes, portés
par des hommes; d’autres palanquins vides et des chevaux de
main suivaient pour ceux qui voudraient changer de manière
d’aller. Cent cinquante hommes , destinés à porter les palanquins
et les divers bagages, suivaient en chantant, courant et
poussant des cris; de sorte que, dans des chemins assez étroits,
nous étions assourdis par un cortège assez bruyant ; quelques
chefs de cette troupe joyeuse galopaient sur les côtés.
Nous marchions dans une route nouvellement faite, très