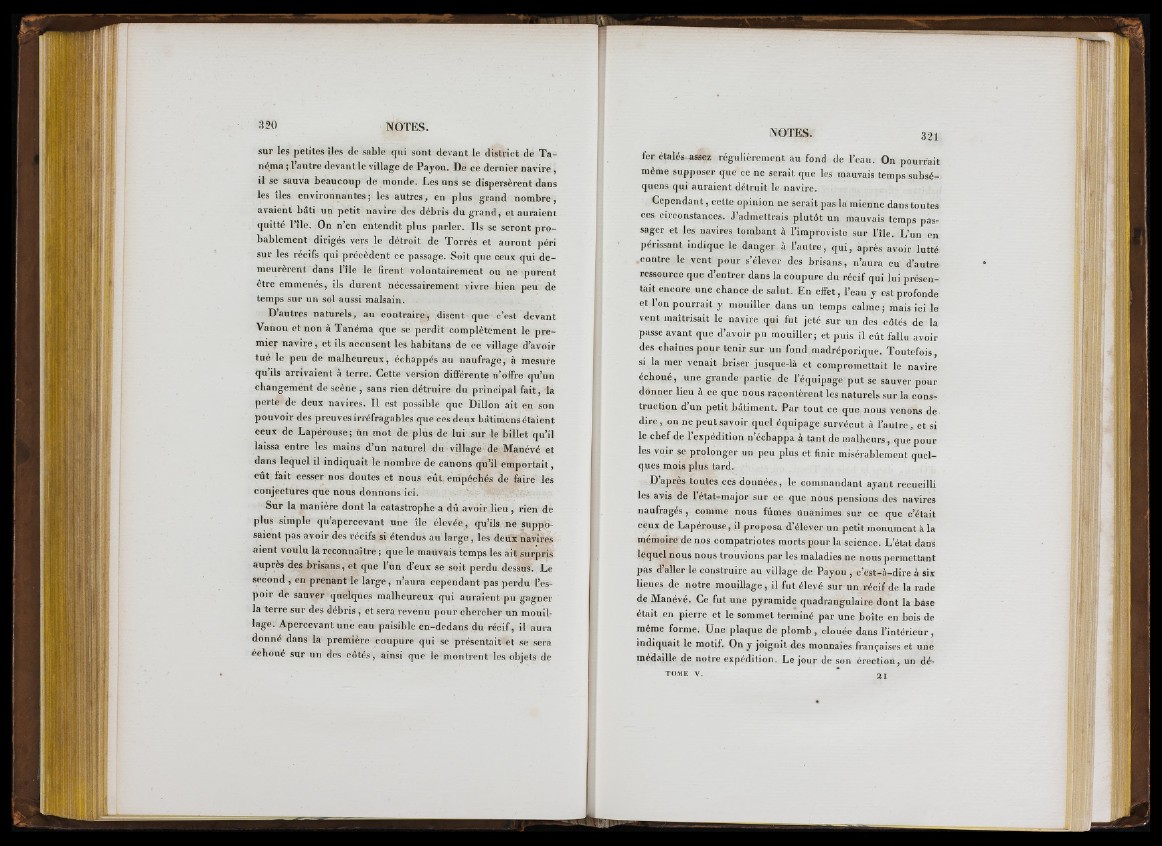
i
320 N O T E S .
sur les petites îles de sable (pii sont devant le district de T a -
néma ; l ’autre devant le village de Payou. De ce dernier n a v ire ,
il se sauva beaucoup de monde. Le.s uns se dispersèrent dans
les îles environnantes; les autres, en plus grand nombre,
avaient bâti un petit navire des débris du grand, et auraient
quitté l ’île. On n’en entendit plus parler. Ils se seront probablement
dirigés vers le détroit de Torrès et auront péri
sur les récifs qui précèdent ce passage. Soit que ceux qui demeurèrent
dans l’ile le firent volontairement ou ne purent
être emmenés, ils durent nécessairement vivre bien peu de
temps sur un sol au.ssi malsain.
D’autres naturels, au contraire, disent que c’est devant
Vanou et non à Tanéma que se perdit complètement le premier
navire, et ils accusent les habitans de ce village d’avoir
tué le peu de malheureux, échappés au naufrage, à mesure
qu’ils arrivaient à terre. Cette version différente n’ offre qu’un
changement de scène , sans rien détruire du principal fait, la
perte de deux navires. I l est possible que Dillon ait en son
pouvoir des preuves irréfragables que ces deux bâtimens étaient
ceux de Lapérouse; un mot de plus de lui sur le billet qu’il
laissa entre les mains d’un naturel du village de Manévé et
dans lequel il indiquait le nombre de canons qu’il emportait,
eût fait cesser nos doutes et nous eût empêchés de faire les
conjectures que nous donnons ici.
Sur la maniéré dont la catastrophe a dû avoir lieu , rien de
plus simple qii’apercevant une île élevée, qu’ils ne supposaient
pas avoir des récifs si étendus au la r g e , les deux navires
aient voulu la reconnaître ; que le mauvais temps les ait surpris
auprès des brisans, et que l ’un d’eux se soit perdu dessus. Le
second , en prenant le la rg e , n’aura cependant pas perdu l’espoir
de sauver quelques malheureux qui auraient pu gagner
la terre sur des débr is, et sera revenu pour chercher un mouillage.
Apercevant une eau paisible en-dcdans du ré c if, il aura
donné dans la première coupure qui .se présentait et .se .sera
échoué sur un des cotés, aln.si que le montrent le.s objets de
N OTES. 321
fer étalés-assez régulièrement au fond de l ’eau. On pourrait
même supposer que ce ne serait que les mauvais temps subsé-
quens qui auraient détruit le navire.
Cependant, celte opinion ne serait pas la mienne dans toutes
ces circonstances. J’admettrais plutôt un mauvais temps passager
et les navires tombant à l ’improvistc sur l’île. L ’un en
périssant indique le danger à l’autre, q u i, après avoir lutté
contre le vent pour s’élever des brisans, n’aura eu d’autre
ressource que d’entrer dans la coupure du récif qui lui présentait
encore une chance de salut. En effet, l ’eau y est profonde
et l’on pourrait y mouiller dans un temps calme; mais ici le
vent maîtrisait le navire qui fut jeté sur un des côtés de la
passe avant que d’avoir pu mouiller; et puis il eût fallu avoir
des chaînes pour tenir sur un fond madréporique. Toutefois,
si la mer venait briser jusque-là et compromettait le navire
échoué, une grande partie de l’équipage put se sauver pour
donner lieu à ce que nous racontèrent les naturels sur la construction
d un petit bâtiment. Par tout ce que nous venons de
dire , on ne peut savoir quel équipage survécut à l’autre , et si
le chef de l ’expédition n’échappa à tant de malheurs, que pour
les voir se prolonger un peu plus et finir mi.sérablement quelques
mois plus tard.
D’après toutes ces données, le commandant ayant recueilli
les avis de Iétat-major sur ce que nous pensions des navires
naufragés , comine nous fûmes Unanimes sur ce que c’était
ceux de Lapérouse, il proposa d’élever un petit monument à la
mémoire de nos compatriotes morts pour la science. L ’état dans
lequel nous nous trouvions par les maladies ne nous permettant
pas d’aller le construire au village de Payou , c’est-à-dire à six
lieues de notre mouillage, il fut élevé sur un récif de la rade
de Manévé. Ce fut une pyramide quadrangulaire dont la base
était en pierre et le sommet terminé par une boite en bois de
même forme. Une plaque de plomb, clouée dans l ’intérieur,
indiquait le motif. On y joignit des monnaies françaises et une
médaille de notre expédition. L e jo u r de son érection, un dé-
TOME v. ' 2 1