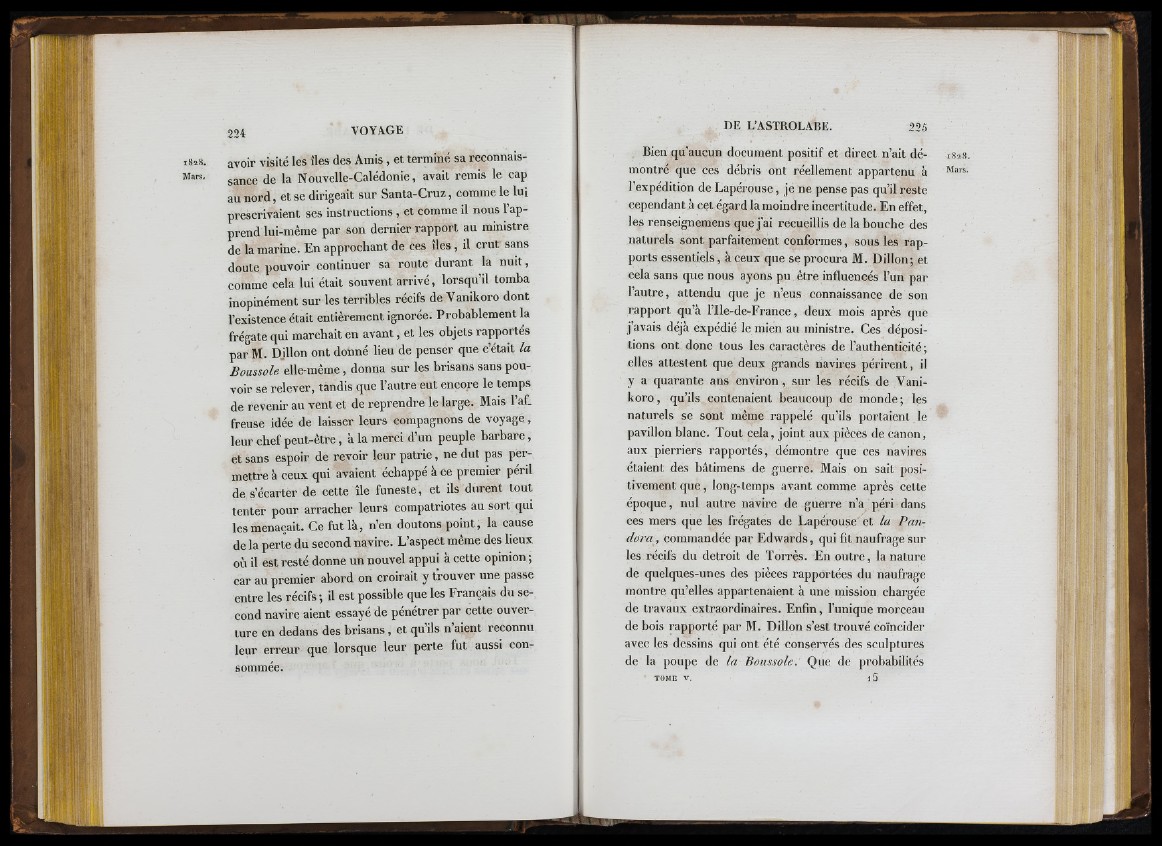
f
i
J:
U
1828.
Mars.
avoir visité les îles des Amis, et terminé sa reconnaissance
de la Nouvelle-Calédonie, avait remis le cap
au n o rd , et se dirigeait sur Santa-Cruz, comme le lui
prescrivaient ses instructions , et comme il nous l’apprend
lui-même par son dernier rapport au ministre
de la marine. En approchant de ces île s , il crut sans
doute pouvoir continuer sa route durant la n u it,
comme cela lui était souvent arrivé, lorsqu’il tomba
inopinément sur les terribles récifs de Vanikoro dont
l’existence était entièrement ignorée. Probablement la
frégate qui marchait en av a n t, et les objets rapportés
par M. Djllon ont donné lieu de penser que c’était la
Boussole elle-même, donna sur les brisans sans pouvoir
se relever, tandis que l’autre eut encore le temps
de revenir au vent et de reprendre le large. Mais l’af.
freuse idée de laisser leurs compagnons de voyage,
leur chef p eut-être, à la merci d’un peuple b arb a re ,
et sans espoir de revoir leur p a trie , ne dut pas permettre
à ceux qui avaient échappé à ce premier péril
de s’écarter de cette île funeste, et ils durent tout
tenter pour arracher leurs compatriotes au sort qui
les menaçait. Ce fut là , n’en doutons point, la cause
de la perte du second navire. L’aspect même des lieux
où il est resté donne un nouvel appui à cette opinion ;
car au premier abord on croirait y trouver une passe
entre les récifs ; il est possible que les Français du second
navire aient essayé de pénétrer par cette ouverture
en dedans des brisan s, et qu’ils n’aient reconnu
leur erreur que lorsque leur perte fut aussi consommée.
DE L’ASTROLABE.
Bien qu’aucun document positif et direct n’ait démontré
que ces débris ont réellement appartenu à
l’expédition de Lapérouse, je ne pense pas qu’il reste
cependant à cet égard la moindre incertitude. En effet,
les renseignemens que j’ai recueillis de la bouche des
naturels sont parfaitement conformes, sous les rapports
essentiels, à ceux que se procura M. Dillon ; et
cela sans que nous ayons pu être influencés l’un par
l’au tre , attendu que je n’eus connaissance de son
rapport qu’à l’Ile-de-France, deux mois après que
j’avais déjà expédié le mien au ministre. Ces dépositions
ont donc tous les caractères de l’authenticité;
elles attestent que deux grands navires p é rire n t, il
y a quarante ans environ , sur les récifs de Vaniko
ro , qu’ils contenaient beaucoup de monde; les
naturels se sont même rappelé qu’ils portaient le
pavillon blanc. Tout cela, joint aux pièces de canon,
aux pierriers rapportés, démontre que ces navires
étaient des bâtimens de guerre. Mais on sait positivement
q u e , long-temps avant comme après cette
époque, nul autre navire de guerre n’a péri dans
ces mers que les frégates de Lapérouse et la Pan-
dora, commandée par Edwards, qui fit naufrage sur
les récifs du détroit de Torrès. En o u tre, la nature
de quelques-unes des pièces rapportées du naufrage
montre qu’elles appartenaient à une mission chargée
de travaux extraordinaires. Enfin, l’unique morceau
de bois rapporté par M. Dillon s’est trouvé coïncider
avec les dessins qui ont été conservés des sculptures
de la poupe de la Boussole. Que de probabilités