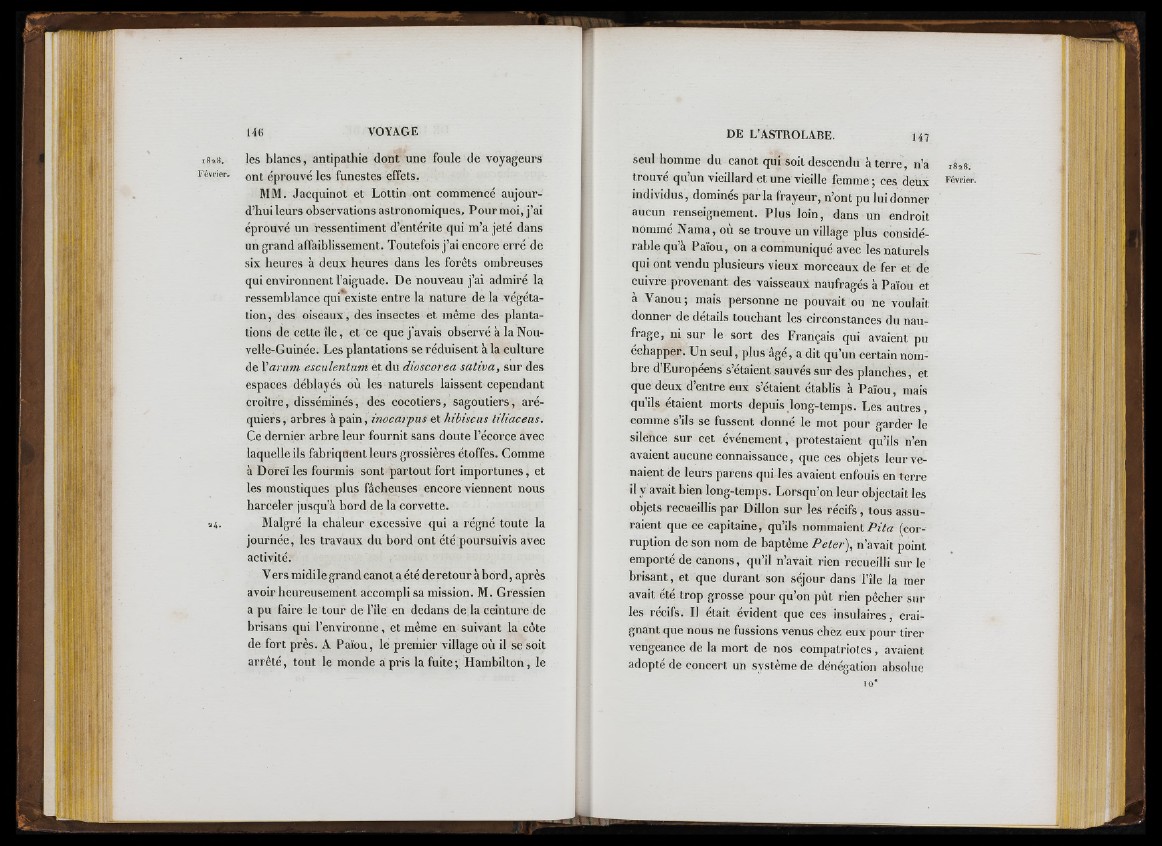
VOYAGE
P: :
i A
DE L’ASTROLABE.
r:l!
liii
^ • J
''•H i
i8-23.
révrieiv
24.
iii'
les blancs, antipathie dont une foule de voyageurs
ont éprouvé les funestes effets.
MM. Jacquinot et Lottin ont commencé aujourd’hui
leurs observations astronomiques. Pour moi, j’ai
éprouvé un ressentiment d’entérite qui m’a jeté dans
un grand affaiblissement. Toutefois j ’ai encore erré de
six heures à deux heures dans les forêts ombreuses
qui environnent l’aiguade. De nouveau j’ai admiré la
ressemblance qui existe entre la nature de la végétation
, des oiseaux, des insectes et même des plantations
de cette île , et ce que j'avais observé k la Nouvelle
Guinée. Les plantations se réduisent à la culture
de Varam esculenlum et du dioscorea saliva, sur des
espaces déblayés où les naturels laissent cependant
croître, disséminés, des cocotiers, sagoutiers, aréquiers,
arbres à pain, inocatpas et hibiscus tiliaceus.
Ce dernier arbre leur fournit sans doute l’écorce avec
laquelle ils fabriquent leurs grossières étoffes. Comme
à Doreï les fourmis sont partout fort importunes, et
les moustiques plus fâcheuses encore viennent nous
harceler jusqu’à bord de la corvette.
Malgré la chaleur excessive qui a régné toute la
journée, les travaux du bord ont été poursuivis avec
activité.
Vers midile grand canot a été de retour à b ord, après
avoir heureusement accompli sa mission. M. Gressien
a pu faire le tour de l’île en dedans de la ceinture de
brisans qui l’environne, et même en suivant la côte
de fort près. A Païou, le premier village où il se soit
a rrê té , tout le monde a pris la fuite ; Hambilton, le
seul homme du canot qui soit descendu à te rre, n ’a
trouvé qu’un vieillard et une vieille femme ; ces deux
individus, dominés p arla frayeur, n’ont pu luidonner
aucun renseignement. Plus loin, dans un endroit
nommé Nama, où se trouve un village plus considérable
qu’à Païou, on a communiqué avec les naturels
qui ont vendu plusieurs vieux morceaux de fer et de
cuivre provenant des vaisseaux naufragés à Païou et
à Vanou; mais personne ne pouvait ou ne voulait
donner de détails touchant les circonstances du naufrage,
ni sur le sort des Français qui avaient pu
échapper. Un seul, plus âgé, a dit qu’un certain nombre
d’Furopéens s’étaient sauvés sur des planches, et
que deux d’entre eux s’étaient établis à Païou, mais
qu’ils étaient morts depuis long-temps. Les autres,
comme s’ils se fussent donné le mot pour garder le
silence sur cet événement, protestaient qu’ils n’en
avaient aucune connaissance, que ces objets leur venaient
de leurs parens qui les avaient enfouis en terre
il y avait bien long-temps. Lorsqu’on leur objectait les
objets recueillis par Dillon sur les récifs, tous assuraient
que ce capitaine, qu’ils nommaient AYa (corruption
de son nom de baptême P eler), n ’avait point
emporté de canons, qu’il n ’avait rien recueilli sur le
brisant, et que durant son séjour dans l’île la mer
avait été trop grosse pour qu’on pût rien pêcher sur
les récifs. Il était évident que ces insulaires, craignant
que nous ne fussions venus chez eux pour tirer
vengeance de la mort de nos compatriotes, avaient
adopté de concert un système de dénégation absolue
10*
1828.
FÉvrier.
i ' A ‘
= i: î :'