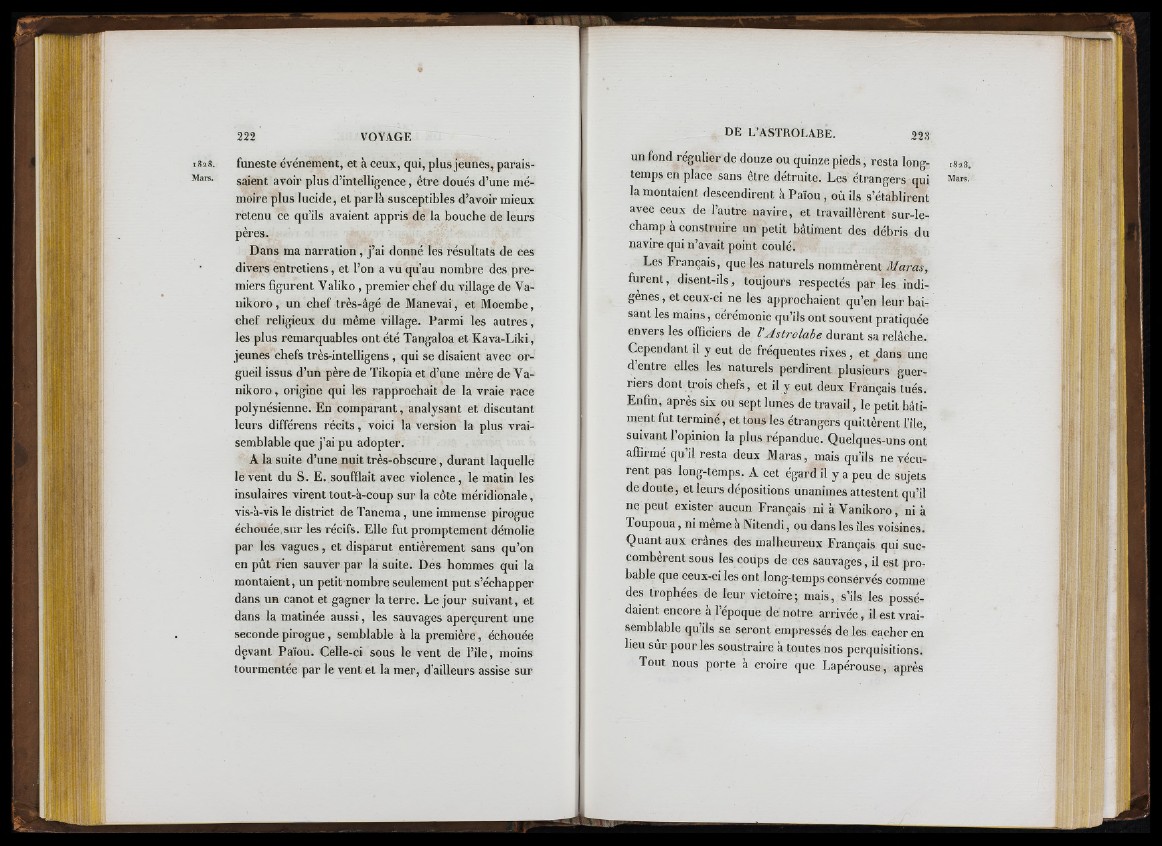
222 VOYAGE
1828.
Mars.
funeste événement, et à ceux, qui, plus jeunes, paraissaient
avoir plus d’intelligence, être doués d’une mémoire
plus lucide, et parla susceptibles d’avoir mieux
retenu ce qu’ils avaient appris de la bouche de leurs
pères.
Dans ma narratio n , j’ai donné les résultats de ces
divers entretiens, et l’on a vu qu’au nombre des premiers
figurent Valiko , premier chef du village de Vanikoro
, un chef très-âgé de Manevai, et Moembe,
chef religieux du même village. Parmi les autres,
les plus remarquables ont été Tangaloa et Kava-Liki,
jeunes chefs très-intelligens , qui se disaient avec orgueil
issus d’un père de Tikopia et d’une mère de Vanikoro
, origine qui les rapprochait de la vraie race
polynésienne. En comparant, analysant et discutant
leurs différens ré c its , voici la version la plus vraisemblable
que j ’ai pu adopter.
A la suite d’une nuit très-obscure, durant laquelle
le vent du S. E. soufflait avec violence, le matin les
insulaires virent tout-à-coup sur la côte méridionale,
vis-à-vis le district de Tanema, une immense pirogue
échouée.sur les récifs. Elle fut promptement démolie
par les vagues, et disparut entièrement sans q u ’on
en pût rien sauver par la suite. Des hommes qui la
montaient, un petit nombre seulement put s’échapper
dans un canot et gagner la terre. Le jo u r suivant, et
dans la matinée au s si, les sauvages aperçurent une
seconde pirogue, semblable à la première, échouée
devant Païou. Celle-ci sous le vent de l’ile, moins
tourmentée par le vent et la mer, d’ailleurs assise sur
un fond régulier de douze ou quinze pieds, resta longtemps
en place sans etre détruite. Les étrangers qui
la montaient descendirent à Païou , où ils s’établirent
avec ceux de l’autre navire, et travaillèrent sur-le-
champ à construire un petit bâtiment des débris du
navire qui n ’avait point coulé.
Les Français, que les naturels nommèrent Mar'as,
fu re n t, disent-ils, toujours respectés p a r le s indigènes
, et ceux-ci ne les approchaient qu’en leur baisant
les mains, cérémonie qu’ils ont souvent pratiquée
envers les officiers de l’A s ird a b e durant surelàche.
Cependant il y eut de fréquentes rixes , et dans une
d entre elles les naturels perdirent plusieurs guerriers
dont trois chefs, et il y eut deux Français tués.
Enfin, après six ou sept lunes de travail, le petit bâtiment
fut terminé, et tous les étrangers quittèrent file,
suivant l’opinion la plus répandue. Quelques-uns ont
affirmé qu’il resta deux Maras, mais qu’ils ne vécurent
pas long-temps. A cet égard il y a peu de sujets
de doute, et leurs dépositions unanimes attestent qu’il
ne peut exister aucun Français ni à Vanikoro, ni à
Toupoua, ni même à Nitendi, ou dans les îles voisines.
Quant aux crânes des malheureux Français qui succombèrent
sous les coups de ces sauvages, il est probable
que ceux-ci les ont long-temps conservés comme
des trophées de leur victoire; mais, s’ils les possédaient
encore à l’époque de notre arrivée, il est vraisemblable
qu’ils se seront empressés de les cacher en
heu sûr pour les soustraire à toutes nos perquisitions.
Tout nous porte à croire que Lapérouse, après
1828.
Mars.