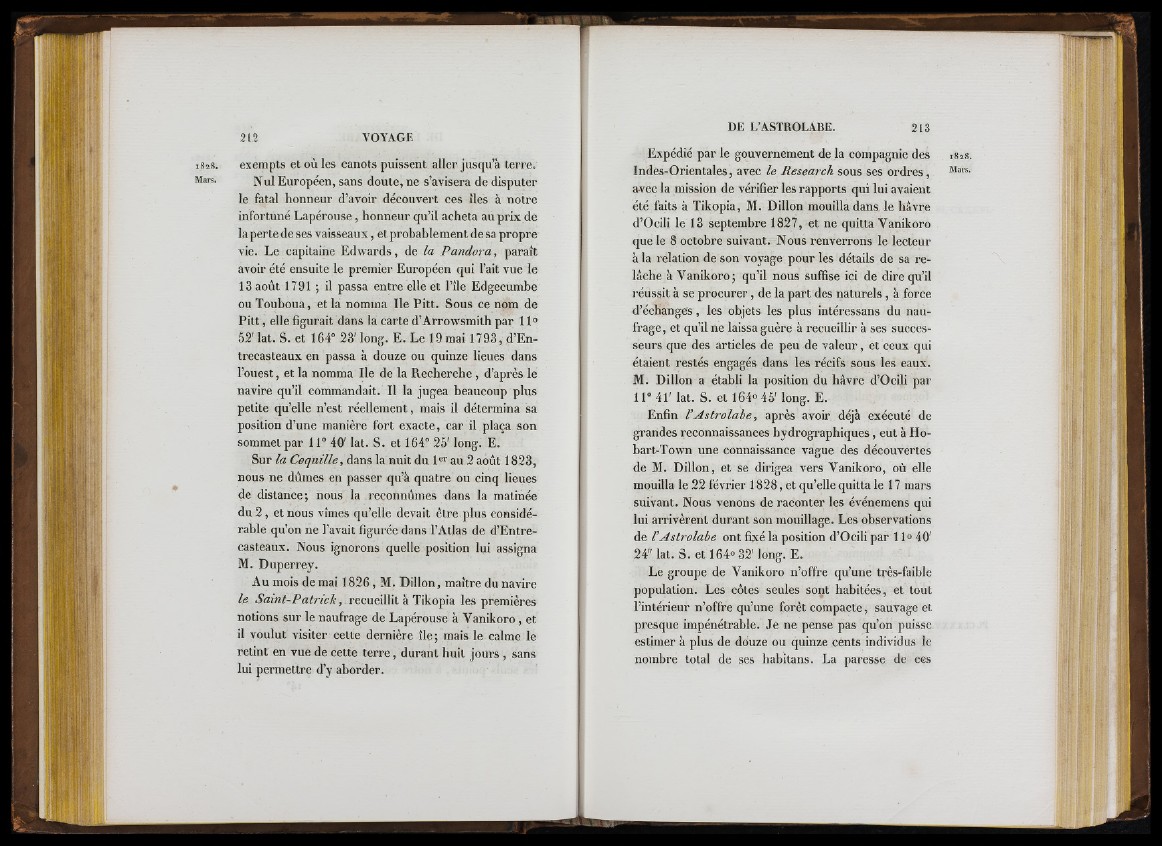
I?
y
:*;;S :
m i -A
ii f
exempts et où les canots puissent aller jusqu’à terre.
Nul Européen, sans doute, ne s’avisera de disputer
le fatal honneur d’avoir découvert ces îles à notre
infortuné Lapérouse, honneur qu’il acheta au prix de
la perte de ses vaisseaux, et probablement de sa propre
vie. Le capitaine Edwards, de la Pandora, paraît
avoir été ensuite le premier Européen qui l’ait vue le
13 août 1791 ; il passa entre elle et l’île Edgecumbe
ou Touboua, et la nomma Ile P itt. Sous ce nom de
P i l t , elle figurait dans la carte d’Arrowsmith par 11°
52' lat. S. et 164° 23' long. E. Le 19 mai 1793, d’Entrecasteaux
en passa à douze ou quinze lieues dans
l’o u est, et la nomma Ile de la Recherche , d’après le
navire qu’il commandait. Il la jugea beaucoup plus
petite qu’elle n ’est réellement, mais il détermina sa
position d’une manière fort exacte, car il plaça son
sommet par 11° 40' lat. S. et 164° 25' long. E.
Sur la Coquille, dans la nuit du 1°° au 2 août 1823,
nous ne dûmes en passer qu’à quatre ou cinq lieues
de distance; nous la reconnûmes dans la matinée
du 2 , et nous vîmes qu’elle devait être plus considérable
qu’on ne l’avait figurée dans l’Atlas de d’Entrecasteaux.
Nous ignorons quelle position lui assigna
M. Duperrey.
Au mois de mai 1826, M. Dillon, maître du navire
le Saint-P atrick, recueillit à Tikopia les premières
notions sur le naufrage de Lapérouse à Vanikoro , et
il voulut visiter celte dernière île; mais le calme le
retint en vue de celte te r r e , durant huit jours , sans
lui permettre d’y aborder.
Expédié par le gouvernement de la compagnie des
Indes-Orientales, avec le Research sous ses o rd re s ,
avec la mission de vérifier les rapports qui lui avaient
été faits à Tikopia, M. Dillon mouilla dans le havre
d’Ocili le 13 septembre 1827, et ne quitta Vanikoro
que le 8 octobre suivant. Nous renverrons le lecteur
à la relation de son voyage pour les détails de sa re lâche
à Vanikoro; qu’il nous suffise ici de dire qu’il
réussit à se p ro c u re r, de la part des naturels , à force
d’échanges, les objets les plus intéressans du naufrage,
et qu’il ne laissa guère à recueillir à ses successeurs
que des articles de peu de v a leu r, et ceux qui
étaient restés engagés dans les récifs sous les eaux.
M. Dillon a établi la position du hâvre d’Ocili par
11° 41' lat. S. el 164° 45' long. E.
Enfin l’A stro la b e , après avoir déjà exécuté de
grandes reconnaissances hydrographiques, eut à Hobart
Town une connaissance vague des découvertes
de M. Dillon, et se dirigea vers Vanikoro, où elle
mouilla le 22 février 1828, et qu’elle quitta le 17 mars
suivant. Nous venons de raconter les événemens qui
lui arrivèrent durant son mouillage. Les observations
de l’Astrolabe ont fixé la position d’Ocili par 11« 40'
24"lal. S. e tl6 4 ° 3 2 'lo n g . E.
Le groupe de Vanikoro n ’offre qu’une très-faible
population. Les côtes seules sont habitées, et tout
l’intérieur n’offre qu’une forêt compacte, sauvage et
presque impénétrable. Je ne pense pas qu’on puisse
estimer à plus de douze ou quinze cents individus le
nombre total de ses habitans. La paresse de ces
1828.
Mars.