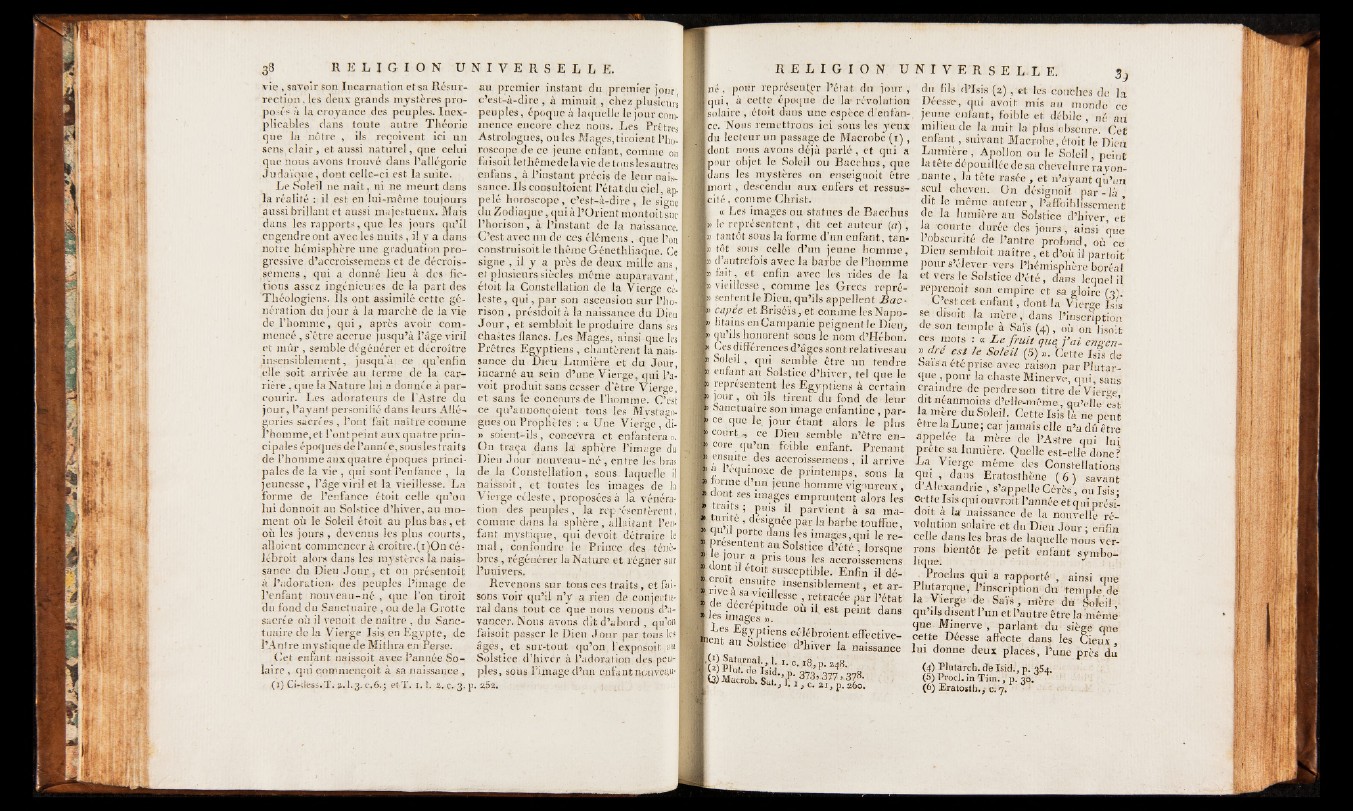
M IRM B
3» R E L I G I O N U N I V E R S E L L E . R E L I G I O N U N I V E R S E L L E .
gs 1 . I« l i i mR
vie , savoir son Incarnation et sa Résur rection
, les deux grands mystères proposés
à la croyance des peuples. Inexplicables
dans toute autre Théorie
que la nôtre , ils reçoivent ici un
sens clair, et aussi naturel, que celui
que nous avons trouvé dans l’allégorie
Judaïque, dont celle-ci est la suite.
Le Soleil ne naît, ni ne nreurt dans
la réalité : il est en lui-même toujours
aussi brillant et aussi majestueux. Mais
dans les rapports, que les jours qu’il
engendre ont avec les nuits , il y a dans
notre hémisphère une graduation progressive
d’accroissemens et de décrois-
semens , qui a donné lieu à des fictions
assez ingénieuses de la part des
Théologiens. Ils ont assimilé cette génération
du jour à la marche de la vie
d e l’homnre, qui, après avoir commencé,
s’être accrue jusqu’à l’âge viril
et mûr , semble dégénérer et décroître
insensiblement, jusqu'à ce qu’enfin
elle soit arrivée au terme de la carrière
, que la Nature lui a donnée à parcourir.
Les adorateurs de l'Astre du
jour, l’ayant personifié dans leurs Allégories
sacrées , l’ont fait naître comme
l’homme, et l’ont peint aux quatre principales
époques de l’année, sous les traits
de l’homme aux quatre époques principales
de la vie , qui sont l’enfance , la
jeunesse, l’âge viril et la vieillesse. La
forme de l’enfance étoit celle qu’ou
lui donnoit au Solstice d’hiver, au moment
où le Soleil étoit au plus bas , et
où les jours , devenus les plus courts,
alloient commencera croître.(i)Oncé-
lébroit alors dans les mystères la naissance
du Dieu Jour , et on présentoit
à l’adoration- des peuples l’image de
l’enfant nouveau-né-, que l’on tiroit
du fond du Sanctuaire , ou delà Grotte
sacrée où il venoit de naître , du Sanctuaire
de la Vierge Isis en Egypte, de
l’Antre mystique deMithra en Perse.
Cet enfant naissoit avec l’année Solaire
, qui çommençoit à sa naissance ,
(j) Ci-dess.ï. 2.I.3. c.6.; etT. j. t. 2. ç. 3
au premier instant du premier jour
c’est-à-dire , à minuit, chez plusieurs
peuples, époque à laquelle le jour commence
encore chez nous. Les Prêtres
Astrologues, on les Mages, tiroient l’horoscope
de ce jeune enfant, comme on
faisoitlethêmedelaviede tonslesautres
enfans , à l’instant précis de leur naissance.
Ils consultaient l’étatdu ciel, ap.
pelé horoscope, c’est-à-dire , le signe
du Zodiaque, (jui à l’Orient mon toit sur
l’horison, à l’instant de la naissance.
C’est avec un de ces élémens , que l’on
construisoit le thème Génethliaque. Ce
signe , il y a près de deux mille ans.
et plusieurs siècles même auparavant,
étoit la Constellation de la Vierge cé.
leste, qui, par son ascension sur l’horison
, présidoit à la naissance du Dieu
Jour, et sembloit le produire dans ses
chastes flancs. Les Mages, ainsi que les
Prêtres Egyptiens, chantèrent la naissance
du Dieu Lumière et du Jour,
incarné au sein d’une Vierge, qui l’a-1
voit produit sans cesser d’être Vierge,
et sans le concours de l ’homme. C’est j
ce qu’annonçoient tous les Mvstago-
gués ou Prophètes : « Une Vierge , di-
» soient-ils, concevra et enfantera s,3
On traça dans la' sphère l’image du
Dieu Jour nouveau-né , entre les bras
de la Constellation , sous laquelle il
naissoit, et toutes les images de la
Vierge céleste, proposées à la vénération
des peuples, la représentèrent,
comme dans, la sphère , allaitant l’eriJ
fant mystique, qui devûit détruire le
mal, confondre le Prince des ténèbres
, régénérer la Nature et régner sur
l’univers.
Revenons sur tous ces traits, et faisons
voir qu’il n’y a rien de conjectural
dans tout ce que nous venons d’a-
yan,cer. Nous avons dit d’abord , qu’on
faisoit passer le Dieu Jour par tous les
âges, et sur-tout qu’on l exposoil ,;.u
Solstice d’hiver à l’adoration des peuples,
sous l’image d’uç enfant nçuveiju-
p. 252.
, pour représenter l’état du jour,
■ qui, à cette époque de la- révolution
■ solaire , étoit dans une espèce d'enfan-
Ice. Nous remettrons ici sous les yeux
■ du lecteur un passage de Macrobe (1),
■ dont nous avons déjà parlé , et qui a
■ pour objet le Soleil ou Bacchus, que
■ dans les mystères on enseignoit être
■ mort, descendu aux enfers et ressusc
ité , comme Christ.
K « Les images ou statues de Bacchus
I» le représentent, dit cet auteur (a) ,
I» tantôt sous la forme d’un enfant, tan-
tôt sous celle d’un jeune homme,
I» d’autrefois avec la barbe de l’homme
I» fait, et enfin avec les rides de la
vieillesse, comme les Grecs repré-
I» sentent le Dieu, qu’ils appellent uBac-
^ capée et Briséïs, et comme lesNapo-
j litains en Campanie peignent Je Dieu,
_> qu’ils honorent sous le nom d’Hébon.
W 1 9es différences d’âges sont relativesau H boleil , qui semble être un tendre
W enfant, au Solstice d’hiver, tel que le
m‘ représentent lès Egyptiens à certain
§! jour, où ils tirent du fond de leur
Jr Sanctuaire son image enfantine, par-
if? ce que le. jour étant alors le plus
y coltrt. ., ce Dieu semble n’être en-
|) core qu’un feible enfant. Prenant
.|> ensuite^ des accroissemensq.' il arrive
f> a l’équinoxe de printemps, sous la
d’un jeune homme vigoureux ,
1 »es images empruntent alors les
»[ tiajts ; puis il parvient à sa ina-
»: tante, -désignée par la barbe touffue,
■ (lu/l porte dans les images,qui le re-
» Présentent au Solstice d’été, lorsque I [SEHy iü l0lïS les accroissemens
dont il était susceptible. Enfin il dé-
» .croît ensuite insensiblement, et ar-
: r sa i l leSse | r e t r a c é e p é t â t
A de décrépitude où il, est peint dans
* tes images. ». r
, Les Egyptiens célébraient effective-
I au Solstice d’hiver la naissance
■ (21 I H i l 1 r- r. 18., p. 248.
3 J
du fils rl’Isis (2), et les coufches de la
Déesse, qui avoit mis au monde ce
jeune enfant, foible et débile , né au
milieu de la nuit la plus obscure. Cet
enfant, suivant Macrobe, étoit le Dieu
Lumière, Apollon ou le Soleil, peint
la tête dépouillée de sa chevelure rayonnante
, Ja tête rasée, et n’aÿant qu’un
seul cheveu. On dé-signoit par-là
dit le même auteur , l’affoiblissement
de la lumière au Solstice d’hiver, et
la courte durée des jours , ainsi que
l’obscurité de l’antre profond, où ce
Dieu sembloit naître, et d’où il partait
pour s’élever-vers l’hémisphère boréal
et vers le Solstice d’été, dans lequel il
reprenoit son empire et sa gloire (3).
C’est cet enfant, dont la Vierge Isis"
se disoit la mère y dans l’inscription
de.son temple à Sais (4), où on lisoifc
ces mots : a L e fruit que j ’ai engeri-
l dré ü 1 So,eil (-5). ». 'Celle Isis de
Sais a été prise avec raison par Plutar-
que , pour la chaste Minerve, qui, sâris
craindre de perdreson titre de Vierge
dit néanmoins d’elle-même., qu’elle est
la mère du Soleil. Cette Isis là ne peut
etre la Lune ; car jamais elle n’a dû être
appelée la mère de l’Astre qui lui
prête sa lumière. Quelle est-elle donc?
La Vierge même des Constellations
Hns! ca!1ls Eratosthène (6 ) savant
d Alexandrie , s’appelle Cérès, ou Isis •
oet felsis qui ouvrait l’année et qui présidoit
à fa naissance de la nouvelle révolution
solaire et du Dieu Jour ; enfin
celle dans les bras de laquelle nous verrous
bientôt Je petit enfant symbolique.
i.. ■
_ Proclus qui a rapporté , ainsi que
Plutarque, l’inscription du temple de
la Viergis'de ■ Sais , nfèfé du Solèil,
<ju ils disent 1 un etPàutre être la même
que Minerve , parlant du siège que
cette Déesse affecte dans les Cieux,
lui donne deux placés, l’une près du
(4) Plutarch. de Isid., p. q54.
(5) Procl. in T ira ., p. ob.
(6) Eratôsth.y c. *j.
m
m m l
il' Éi
H
mi