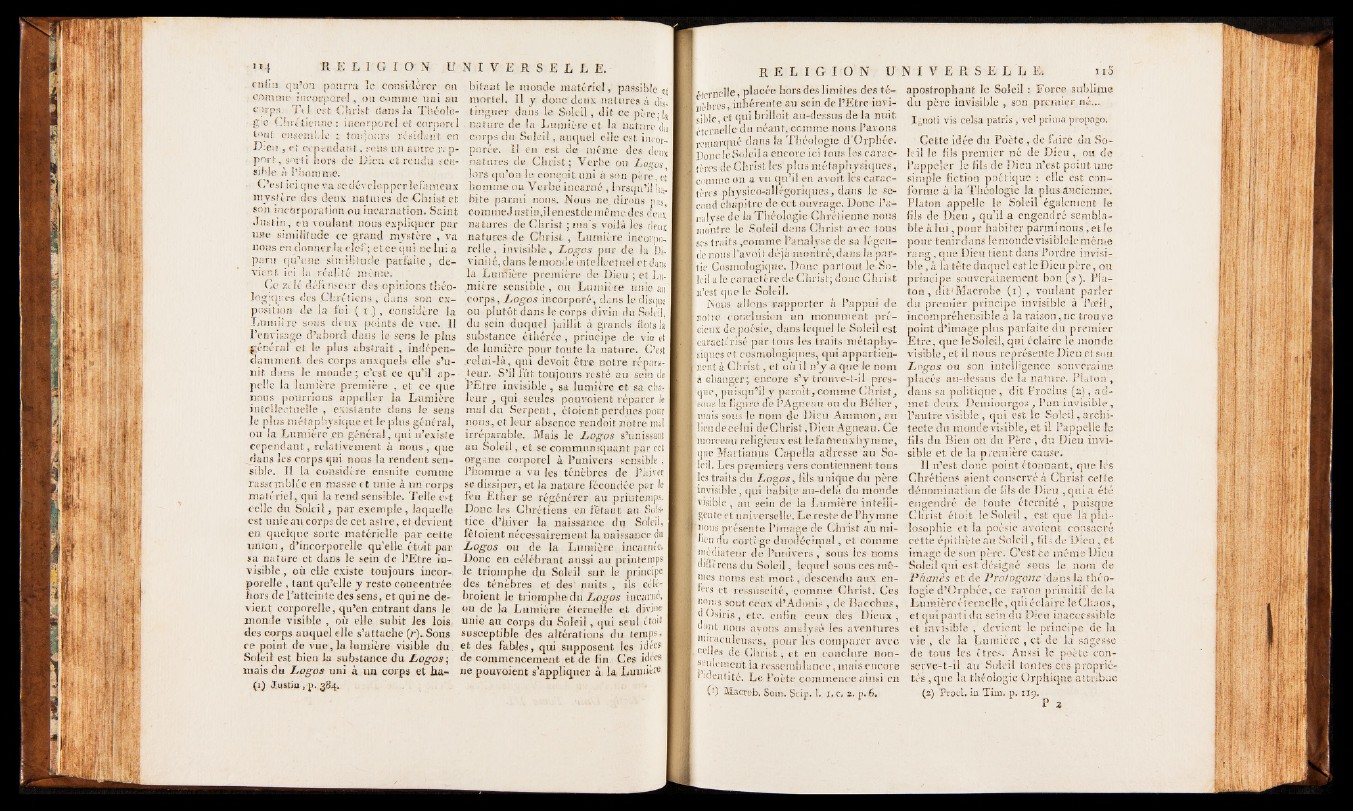
Y
enfin qu’on pourra le considérer ou
: connue incorporel , ou comme uni au
corps. Ttl est Christ dans la Théologie
Chrétienne : incorporel et coroort 1
'■■’ut ensemble ; toujours résidant en
Lien , et cependant, sons un autre rapport,
sir! i hors de Dieu et rendu sensible
à l’homme.
C’est ici que va se développer lefa meu x
mystère des deux natures de-Christet
son. incorporation ou incarnation. Saint
Justin, en voulant nous expliquer pax
une similitude ce grand mystère , va
nous en donner la clef; et ce qui ne lu: a
paru qu'une similitude parfaite, devient.
ici la réalité même.
Ce zélé défenseur des opinions théo-
Iogujues des Chrétiens, dans-son exposition
de la foi ( r .) , considère la
Lumière sous deux points de vue. Il
l’envisage d’abord dans le sens le plus
écéral et le. plus abstrait , indépen-
animent des corps auxquels elle s’unit
dans le monde ; c’est ce qu’il appelle
la lumière première , et ce que
nous pourrions appeller la Lumière
intellectuelle , existants clans le sens
le plus métaphysique_.et. le plus général,
ou la Lumière en général, qui n’existe
cependant, relativement à nous , que
dans les corps qui nous la rendent sensible.
Il la considère ensuite cumme
rassemblée en masse et unie à un corps
matériel, qui la rend sensible. Telle est
celle du Soleil, par exemple, laquelle
est unie au corps de cet astre, et devient
en quelque sorte matérielle par cette
union , d’incorporelle qu’elle étoit par
sa nature et dans le sein de l’Etre invisible
, où elle existe toujours incorporelle
, tant qu’elle y reste concentrée
hors de l’atteinte des sens, et qui ne devient
corporelle, qu’en entrant dans le
inonde visible , où elle subit les lois
des corps auquel elle s’attache (r). Sous
ce point de vue, la lumière visible du.
Soleil est bien la substance du Logos ;
mais du Logos uni à un corps et habitant
le monde matériel, passible e[
mortel. Il y doue deux natures.à dis.
tiiiguer dans le Soleil, dit ce pèrf la
nature de la Lumière et. la nature du
corps du Soleil, auquel elle est ineor-
porée. Il en est de meme des. deux
natures de Christ; Verbe ou Logos
lors qu’on le conçoit uni à son père, ef
homme ou Verbe incarné, lorsqu'il!habite
parmi nous. Nous ne. dirons pas
comme J ustin,il enestde même des deux
na tures de Christ ; ma's voilà les deux
natures de Christ , Lumière incorôoJ
relie, invisible, Logos pur de la Divinité,
dans le monde intellectuel et dans,
la Lumière première de Dieu ; et Lu-
.mière sensible , ou Lumière unie au
corps, Logos incorporé, dans Ip'disquéj
ou plutôt dans le corps dix-in du Soleil,
du sein duquel jaillit à grands flots la
substance étliérée , principe de vie et i
de lumière pour toute la nature. C’est
.celui-là, qui devoit être notre réparateur.
S’il fût/toujours resté au sein dç ;
l’Etre invisible, sa lumière et sa ch a-
leur , qui seules pouvaient réparer lu!
mal du Serpent, étoientperdues pour
nous, et leur absence rendait notre nul
irréparable. Mais le Logos s.’unïssant
au Soleil, et se communiquant par cM
organe corporel à l’univers sensible ,
l’homme a vu les. ténèbres de l’hiver :
se dissiper, et la nature fécondée par h
feu Ether se régénérer au printemps-
Donc les Chrétiens en fêtant au Solstice
d’hiver la naissance dij Soleil,
fêtoient nécessairement la naissance du
Logos ou de la Lumière -, incarnée.
Donc en célébrant aussi au printemps
le triomphe du Soleil sur le principe
des ténèbres et des' nuits., ils célé-
broient le triomphe-du Logos incarné,
ou de la Lumière éternelle et divine
unie au corps du Soleil r qui seul étoit j
susceptible des altérations du temps* j
et des fables, qui supposent les idées:,
de commencement et de fin. Ces idées
ne pouvoient s’appliquer à la Lumièï®
( i ) J u s t in , p. 3S4.
[éternelle, placée hors des limites des té-
I Libres, inhérente au sein de l’Etre invi-
I Lible et (pii brilloit au-dessus de la nuit
I [éternelle du néant, ccinme nous l’avons
| remarqué dans la Théologie d’Orphée.
| [DoncleSoleil a encore ici tous les carac-
| fèr.es deCbrist les1 plus métaphysiques,
I [connue on a vu qu’il en avoit lescarac-
I tères physico-allégoriques., dans le se-
Ijcond chapitre de cet ouvrage. Donc l’a-
| nalyse de la Théologie Chrétienne nous
| montre le Soleil dans Christ avec tous
| [ses traits,comme l’analyse de sa légeii-
| [de nous l’a voit déjà montré, dans la p.ar-
||tie Cosmologique. Donc partout le.So-
| leil a le caractère de Christ; donc Christ
I [11’est quële Soleil.
[ Nous, allons rapporter à l’appui de
I[notre conclusion un monument pré-
| [cieiix dépoésie, dans lequel le Soleil est
I [caractérisé par tous les traits -métaphy-
| isiques et cosmologiques, qui appartien-
| Puent à Christ, et où il n’y a que le nom
à changer; encore s’y trouve-t-il presque,
puisqu'il y paroit, comme Christ,
[sous la figure de l’Agneau ou du Bélier,
[ mais sous le nom de Dieu Ammon, au
[lieu de celui de Christ,Dieu Agneau. Ce
morceau religieux estlefafneuxhymne,
[que Martianus Capella adresse au So-
rleil. Les premiers vers contiennent tous
Iles traits du Logos, fils unique du père
[invisible , qui habite au-delà du monde
[visible , au sein de la Lumière inteîli-
[gente et universelle. Le reste de l’hymne
[noiis présente l’image de Christ au millieu
du cortège duodécimal, et comme
[médiateur de l’univers , sous les noms
[diiférens du Soleil, lequel sous ces mê-
| focs noms est mort, descendu aux en-
Ifers et ressuscité, comme Christ. Ces
[noms, sont ceux d’Adonis, de Bacchus,
| d Osirîs-, etc. enfin ceux des Dieux ,
[dont nous avons analysé les aventures
I miraculeuses, pour les comparer avec
[ celles de Christ et en conclure non-
| feulement la ressemblance, mais encore
[ 1 idéalité. Le Poète commence ainsi en
(i) Macrob. Som. h. j, c, ï . p. -6.
apostrophant le Soleil : Force sublime
du père invisible , son premier né...
Ignoti vis celsa patris, vel prima propago.
Cette idée du Poète , de faire du Soleil
le fils premier né de Dieu, ou de
l’appeler le fils de Dieu n’est point une
simple fiction poétique : elle est Conforme
à la Théologie la plus.ancienne.
Platon appelle le Soleil également le
fils de Dieu, qu’il a engendré semblable
à lu i, pour habiter parminous, etle
pour tenirdans le monde visible lemême
rang, que Dieu tient dans l’ordre invisible
, à la tête duquel est le Dieu père, ou
principe souverainement bon (s). Platon
, dit'Macrobe (1) , voulant parler
du premier principe invisible à l’oeil,
incompréhensible à la raison, ne trouve
point d’image plus parfaite du premier
Etre, que leSoleil, qui éclaire le monde
visible', et il nous représente Dieu et sou
Logos ou son intelligence souverainfe
placés au-dessus de la nature. Platon ,
dans,sa politique, dit Frocius (a), admet
deux Demiourgos, l’un invisible ,
l’autre visible , qui est te Soleil, architecte
du monde visible, et il l’appelle le.
fils du Bien ou du Père , du Dieu invisible
et de la première cause.
Il n’est donc point étonnant, que lés
Chrétiens aient conservé à Christ cette
dénomination de fils de Dieu , qui a été
engendré de toute éternité , puisque
Christ étoit le Soleil , est que'là philosophie
et la poésie avoient consacré
cette épithète au Soleil, fils de Dieu , et
image de son père. C’ëstbe même-Dieu
Soleil qui es t désigné sous le nom de
Pkanès et de Protogone 'dans la théologie
d’Orphée, ce rayon primitif de la
Lumière ét ernelle, qui éclaire le Clia os,
et qui parti du sein du Dieu inaccessible
et invisible , devient le principe de la
vie., de la Lumière , et de la sagesse
de fous les ftres. Aussi lé poète conserve
t-il au Soleil tontes ces proprié-
tés , que la théologie Orphique attribue
(2) Procl, in Tim. p. 110,
P 3