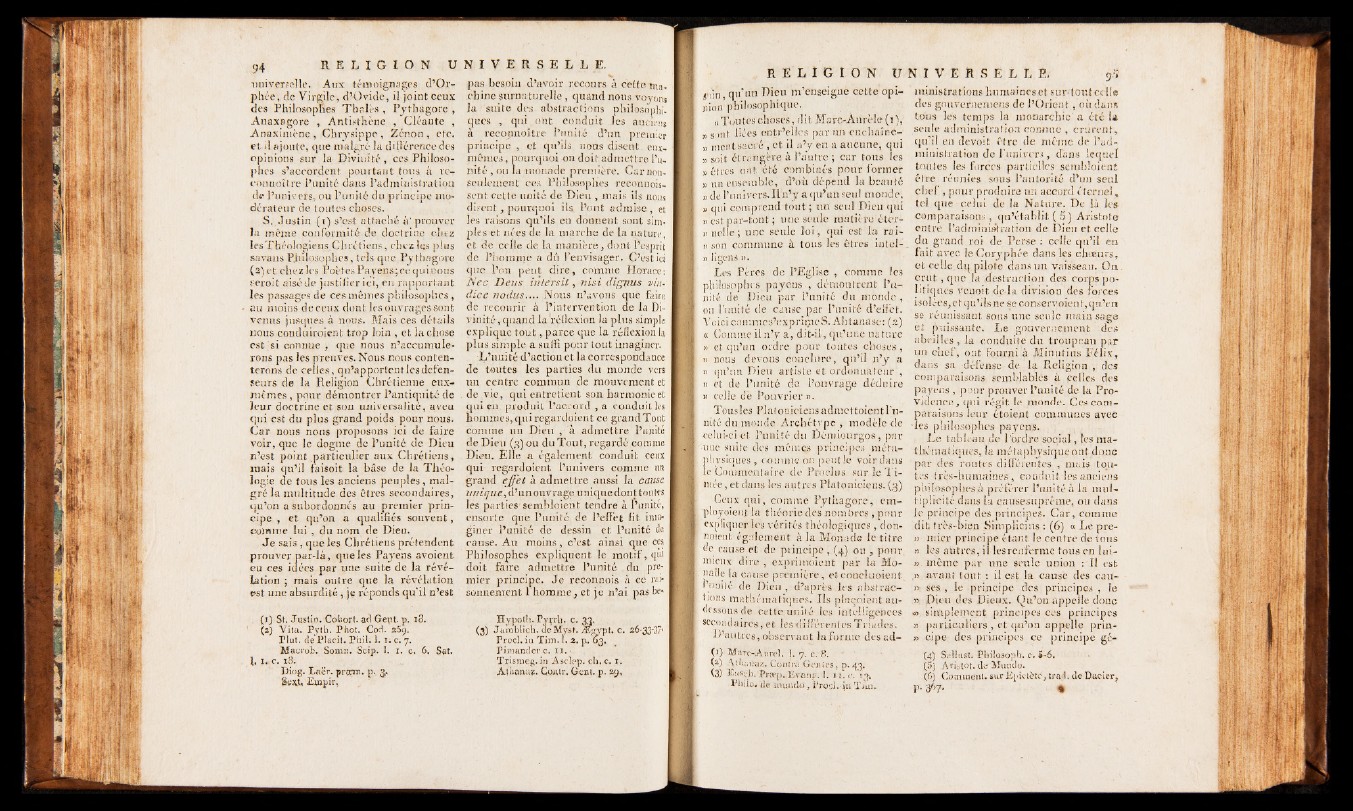
94 R E L I G I O N U
universelle. Aux témoignages d’Orphée,
de Virgile, d’Ovide, il joint ceux
des Philosophes Thaïes , Pytbagore ,
Anaxagore , Antisthène , Géante ,
Anaximène , Chrysippe , Zenon, etc.
et il ajoute, que malgré la différence des
opinions sur la Divinité, ces Philosophes
s’accordent pointant tous à vc-
counoître l’unité dans l’administration
de l’univeïs, ou l’unité du principe modérateur
de toutes choses.
S. Justin (i) s’est attaché à' prouver
la même conformité de doctrine chez
lesThéologiens.Chrétiens, chez les plus
savans Philosophes, tels que Pythagore
(2) et chez les Poètes Payensjee quipous
seroit aiséde justifierici, en rapportant
les passages de ces mêmes philosophes,
au moins deceux dont les ouvrages sont
venus jusques à nous. Mais ces détails
nous conduiroient trop loin , et la chose
est si connue, que nous n’accumulerons
pas les preuves. Nous nous contenterons
de celles, qu’apportent les défenseurs
de la Religion Chrétienne eux-
mêmes , pour démontrer l’antiquité de
leur doctrine et son universalité, aveu
qui est du plus grand poids pour nous.
Car nous nous proposons ici de faire
voir, que le dogme de l’unité de Dieu
n’est point particulier aux Chrétiens,
mais qu’il fàisoit la base de la Théologie
de tous les anciens peuples, malgré
la multitude des êtres secondaires,
qu’on a subordonnés au premier principe
, et qu’on a qualifiés souvent,
comme lui , du nom de Dieu.
Je sais, que les Chrétiens prétendent
prouver par-là, que les Payens avoient
eu ces idées par une suite de la révélation
; mais outre que la révélation
est une absurdité, je réponds qu'il n’est 1 2
(1) St. Justin. Cohort. ad Gept. p. i 3 .
(2) V ita . Pvlii. Phot. Cod. 25ÿ.
Plut, de Placit. Phil. 1. 11 c; y.
Macro b. Somn. Scip. 1. 1. c. 6. Sat.
fi j . c. 18.
Biog. Baër. prgjni. p , 3,
Sy.Vt, lùiaar.
N I V E R S E L L E .
pas besoin d’avoir recours à cette nia-
chine surnaturelle , quand nous voj'unj
la suite des abstractions philosophé
ques , qui. ont conduit les anciens
à reconnoître l’unité d’un premier
principe , et qu’ils lions disent eux-
mêmes , pourquoi on doit admettre l’unité
, ou la monade première. Car non-
seulement ces Philosophes reconnussent
cette unité de Dieu , mais ils nous
disent, pourquoi ils l’ont admise , et
les raisons qu’ils en donnent sont sim,
pies et nées de la marche de la nature,
et de celle de la manière, dont Pcsprit
de l’homme a dû l’envisager. C’est ici
que l’on peut dire, Comme Horace:
Nec Deus intersit, nisi digjius vin-
dice nodus.... Nous n’avons que faire
de recourir à l’ intervention de la Divinité
, quand la réflexion la plus simple
explique tout, parce que la réflexion la
plus simple a suffi pour tout imaginer.
L’imitéxl’action et la correspondance
de toutes les parties du monde vers
un centre commun de mouvement et
de vie, qui entretient son harmonie et
qui en produit l’accord , a conduit le$
hommes, q.ui regardoient ce grand T ont
comme un Dieu , à admettre l’unité
de Dieu (3) ou duTout, regardé comme
Dieu. Elle a également conduit ceux
qui regardoient. l’univers comme 11a
grand effet à admettre aussi la cause,
unique, d’un ouvrage unique dont.toutes
les parties sembloient tendre à l’unité,
ensorle que l’unité de l’effet fit imaginer
l’unité de dessin et l’unité de
cause. Au moins, c’est ainsi que ces
Philosophes expliquent le motif, lit'
doit faire admettre l’unité , du pre
mier principe. Je reconnois à ce raisonnement
1 homme, et je n’ai pas be-
Hypolh. Pyyrh. c. 33.
(3) Jamblicb. deMyst. Ægypt. c. 26-33'3?'
Procl. in Tim. 1. 2. p. 63,
Pimander c. i l .
Trismeg. in Ascîpp. cli, c. 1.
Allumas. Contr. Genl. p. 29,
R E L I G I O N U
S'iin, qu’un Dieu m’enseigne cette opinion
philosophique.
«Touteschoses, dit Marc-Ànrèle-(i),
» sont, liées entr’ellcs par un enchaîne-
» mentsacré , et il n’y en a aucune, qui
» soit étrangère à l’autre ; car tous les
» êtres ont été combinés pour former
» un ensemble, d’où dépend la beauté
» dé l’univers. Il n’y a qu’un seul monde,
» qui comprend tout ; un seul Dieu qui
» est par-tout ; une seule matière éter-
» nelle ; une seule loi -, qui est la rai-
» son commune à tous les êtres iutcl-
» ligens ».,
Les Pères de l’Eglise , comme les
philosophes, payons ., démontrent l’unité
de Dieu par l’unité du monde,
ou .l'unité de cause par l’unité d’eficr.
Voicicommes’exprimcS. Ahtanase: (2)
« Comme il n’y a, dit-il, qu’une nature
» et qu’un ordre pour toutes choses ,
» nous devons coucltire, qu’il n’y a
» (jii’im Dieu artiste et ordonnateur ,
» et. de l’unité de l’ouvrage déduire
» celle de l’ouvrier ».
Tousles Platoniciens admettaient l'unité
du monde Archétype , modèle de
ceilii-ci et l’unité du Démiourgos, par
unie suite des mêmes principes métaphysiques
, comme on peut le voir dans
de Commentaire de Proclus sur le l imée
, et dans les autres Platoniciens. (3)
Ceux qui, comme Pythagore, ern-
ployoient la théorie des nombres, pour
expliquer les véri tés t.béologiques , don-
'noient également à la Monade le titre
de,cause et de principe, (4) ou , pour,
mieux dire , exprimoieut par la Monade
la cause première, etconcluoient,
l’nnilé-de Dieu, d’après 1rs abstractions
mathématiques. Ils plaç.oient au-
dessous de cette unité les intelligences
secondaires , et les différentes Triades.
D’autres,observant Informe desad-
(1) Marc-Aurel. }. y. c. 8.
(2) Ai Imitas. Conlrà Genles, p. 4t.
(3) Ens-b. Præp.,Evans. I. 11. c. 13,
-voila, de muodo, Proul. in ïiui.
N I V E R S E L L E , 9 fi
ministrat.ions humaineset sur-tout ce lle
des gouvemeniens de l’Orient , où dans
tous les temps la monarchie' a été la
seule administration connue , crurent,
qu’il en devoit être de même de l’administration
de l'univers , dans lequel
toutes les forces partielles sembloient
être réunies sous l’autorité d’un seul
chef , pour produire un accord éternel,
tel que celui de la Nature. De là les
comparaisons, qu’établit ( 5 ) Aristote
entre l'administration de Dieu et celle
du grand roi de Perse : celle qu’il en
fait avec le Coryphée dans les choeurs,
et celle, dq pilote dans un vaisseau. On.
crut, que la destruction des corps politiques
venoit de-la divisiou des forces
isolées,et qu’ils ne se conserv oien t,qu’en
se réunissant sons une seule ruain sage
et puissante. Le gouvernement des
abeilles , la conduite du troupeau par
un chef, ont fourni à Minntius Félix,
dans sa défense de la Religion , des
comparaisons semblables à celles des
payées , pour prouver l’unité de la Providence,
qui régit le monde. Ces comparaisons
leur étaient communes avec
■ les philosophes payens.
Le tableau de l'ordre social, les mathématiques,
la métaphysique ont ,donc
par des routes différentes , mais toutes
très-humaines , conduit les anciens
philosophes à préférer l’unité à la multiplicité
dans la causesuprcme, ou dans
le principe des principes. Car, comme
dit très-bien Simplicius : (6) « Le pre-
» mier principe étant le centre de tous
» les autres, il les renferme tous en lni-
» même par une seule union : Il est
.» avant tout : il est la cause des cau-
»: ses , le principe des principes , le
» Dieu des Dieux. Qu’on appelle donc
•» simplement principes ces principes
■ji particuliers , et qu’on appelle pnn-
» cipe des principes ce principe gé-
‘ (4) Saliusl. Philosoph. c. î-6 .
(5 ) Arislot. de Mundo.
(6) Comment, sur Epie tète, trad. de Dacier,
P- IJ6?- *