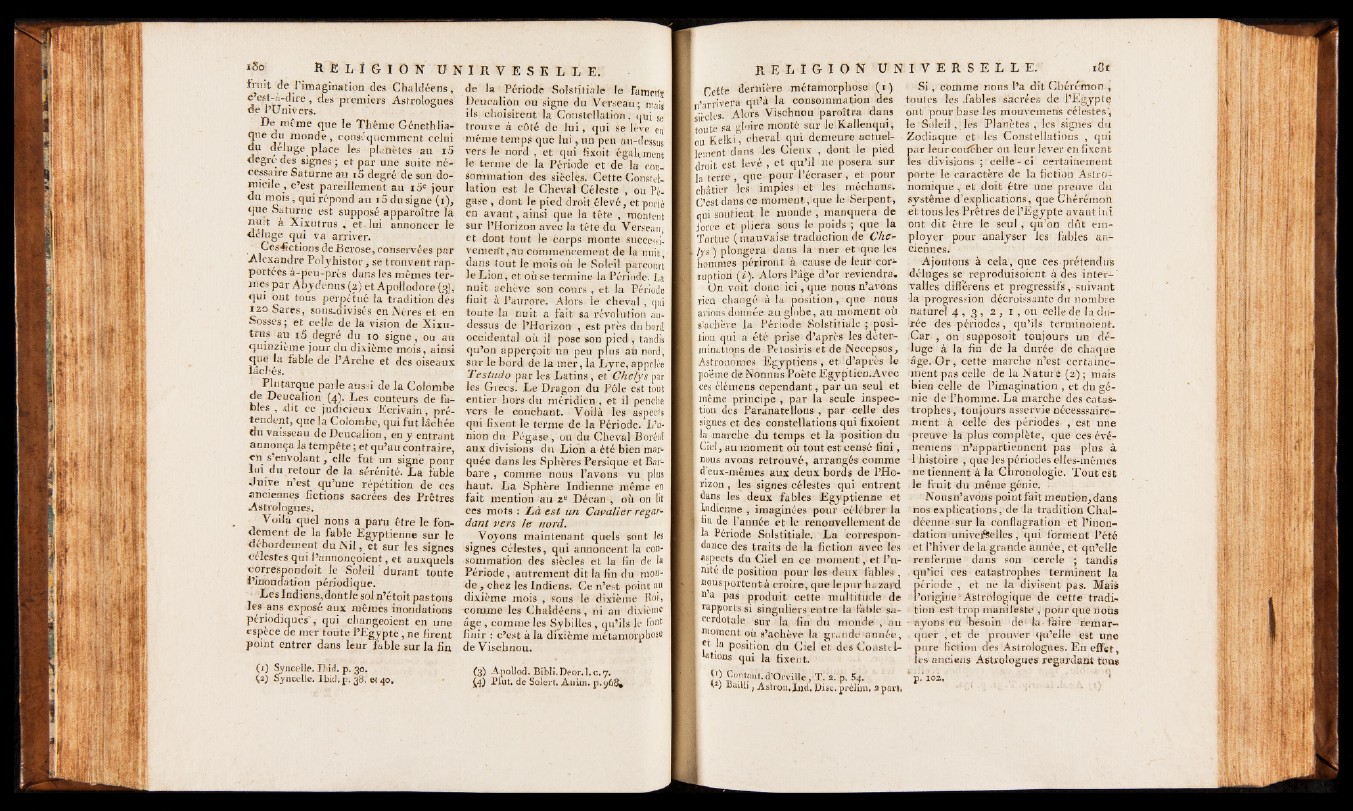
fruit de l’imagination des Chaldéens,
c’est-à-dire , des premiers Astrologues
de l’Univers.
De même que le Thème Génethlia-
que du monde, conséquemment celui
du déluge place les planètes au i 5
degre des signes ; et par une suite né-
cessaire Saturne au iS degré de son domicile
, c’est pareillement au i5e jour
du mois, qui répond au 15 du signe (i),
que Saturne est suppQsé apparoître la
nuit à Xixutrus , et. lui annoncer le
déluge qui va arriver.
CesserionsdeBerose, conservées par
Alexandre Polyhistor, se trouvent rapportées
à-peu-près dans les mêmes termes
par Abydenus (a) et Apollodore (3),
qui ont tous perpétué la tradition dés
120 Sares, sous-divisés entières et en
Sosses; et celle de la vision de Xixn-
trus au 15 degré du 10 signe, ou au
quinzième jour du dixième mois, ainsi
que la fable de l’Arche et des oiseaux
lâchés.
Plutarque parle aussi de la Colombe
de Deucalion (4). Les conteurs de fables
, .dit ce judicieux Ecrivain, prétendent,
que la Colombe, qui fut lâchée
du vaisseau de Deucalion, en y entrant
annonça la tempête ; et qu’au contraire,
en s’envolant, elle fut un signe pour
lui du retour de la sérénité. La table
Juive n’est qu’une répétition de ces
anciennes fictions sacrées des Prêtres
Astrologues.
Voilà quel nous a paru être le fondement
de la fable Egyptienne sur le
débordement du Ni l , et sur les signes
célestes qui l’annoneoient, et auxquels
correspondoit le Soleil durant toute
l’inondation périodique.
Les Indiens, dontle soi n’étoit pas tons
les ans exposé aux mêmes inondations
périodiques', qui cbangeoient en une
espèce de mer tonte l’Egypte, ne firent
point entrer dans leur fable sur la fin
( 1 ) S yn c e lle . Ib id . p . 36.
\z) S y n c e lle . lb id ,p . 38. et 40,
de la Période Solstitiale le fampitj
Deucalion ou signe du Verseau; mais
ils choisirent la Constellation, qui sff
troure à côté de lui , qui se lève en
même temps que lui, un peu an-dessus
vers le nord , et qui fixoit également
le ternie de la Période et de la consommation
des siècles. Cette Constellation
est le Cheval Céleste , ou Pé-
gase , dont le pied droit élevé, et porté
en avant, ainsi que la tête , montent
sur l’Horizon avec la tête du Verseau,
et dont tout le corps monte successivement,'
au commencement de la nuit,
dans tout le mois où le Soleil parcourt
le Lion, et où se termine la Période. La
nuit achève son cours , et la Période
finit à l’aurore. Alors- le cheval qui
toute la nuit a fait sa révolution au-
dessus de l’HorizOn , est près du bord
occidental où il pose son pied , tandis
qu’on apperçoit un peu plus ah nord,
sur le bord de la mer, la Lyre, appelée
Testudo par les Latins, et Chelys par
les Grecs. Le Dragon du Pôle est tout
entier hors du méridien, et il penche
vers le couchant. Voilà les aspecls
qui fixent le terme de la Période. L’union
du Pégase, ou du Cheval Boréal
aux divisions du Lion a été bien marquée
dans lés Sphères Persique et Barbare
, comme nous l’avons vu plus
haut. La Sphère Indienne même en
fait mention au 2e Déean -, où on lit
ces mots : Là est un Cavalier regardant
vers le nord.
Voyons maintenant quels sont les
signes célestes, qui annoncent la consommation
des siècles et la fin de la
Période, autrement dit la lin du monde
, chez les Indiens. Ce n’est point an
dixième mois , sous le dixième Rof,
comme les Chaldéens, ni au dixième
âge , comme les Sybilles , qu’ils le font
finir : c’est à la dixième métamorphosa
de Vischnou.
(3) Apollod. Bibli.Deor.l. c. 7.
£4) Plut, de Solert. Aiiiin. p.y6S,
Cette dernière métamorphose (1)
In’arrivera qu’à la consommation des
Isiècics. Alors Vischnou paroîtra dans
'toute sa gloire monté sur le Kalleuqni,
louKelki, cheval qui demeure actuel- • I leinent dans les Cieux , dont le pied
■ droit est levé , et qu’il ne posera sur
I la terre', que pour l’écraser , et pour
■ châtier les impies : et les méchansi
I C’est dans ce moment, que le Serpent,
I qui soutient le monde, manquera de
■ force et pliera sous le poids ; que la
1 Tortue (mauvaise traduction de Che-
1 lys ) plongera dans la mer et que les
I hommes périront à cause de leur cor-
I ruption (i). Alors l’âge d’or reviendra.
On voit donc ic i, que nous n’avOns
I rieq changera la position , ’ que nous
I avions donnée au globe, au moment où
■ s’achève la Période Solstitiale $ posi-
■ tion qui a été prise d’après les déter-
I minutions de Petosiris et de Necepsos,
■ Astronomes Egyptiens, et d’après le
■ poème de Nonnus Poète Egyptien.Avec
■ ces élémens cependant, par un seul et
■ même principe , par la seule inspec-
■ tion des Paranatellons , par celle des
1 signes et des' constellations qui fixoient
■ la marche du temps et la position du
I Ciel, au moment où tout est censé fini,
■ nous avons retrouvé, arrangés comme
■ d’eux-mêmes aux deux bords de l’Hô-
I rizon , les signes célestes qui entrent
B dans les deux fables Egyptienne et
I Indienne , imaginées pour célébrer la
■ fin de l’année et le renouvellement de
■ la Période Solstitiale. La correspon-
I dance des traits de la fiction avec les
B aspects du Ciel en ce moment, et l’u-
I nité de position pour les deux fables,
B nous portent à croire, que le pur hazard
I 11 pas produit cette multitude de
■ apports si singuliers entre la fable sa-
■ cerdotale sur la fin du monde , au
■ montent où s’achève la grunde‘année,
■ et la position du Ciel et des Cousttl-
■ tâtions qui la fixent.
W Contant. d’Orville, - T. a. 'p. 54.'
i K1) Bailli ; Astron.Xucl. Disc, préiim. 2 part.
S i, comme nous l’a dit Chërémon ,
toutes les fables Sacrées de l’Egypte
ont pour base les mouvemens célestes,
le Soleil, Tes Planètes, les signes du
Zodiaque et- les Constellations , qui
par leur couêber ou leur lever en fixent
les divisions celle -c i certainement
porte le caractère de la fiction Astronomique
, et doit être une preuve du
système d’explications , que Chérémon
et tous les Prêtres de l’Egypte avant lui
ont dit être le seul, qu’on dût employer
pour 'analyser les' fables anciennes.
Ajoutons à cela, que ces-prétendus
déluges se reproduisoient à des intervalles
différens et progressifs,- suivant
-la progression décroissante du nombre
naturel 4 , 3, 2, 1 , ou ceîle de la durée
des périodes, tju’ils terminoient.
Car , On supposoit toujours un déluge
à la fin de la durée de chaque
âge. O r , cette marche n’est certainement
pas celle de la Nature (2) ; mais
bien celle de l’imagination , et du génie
de l’homme. La marche des catastrophes,
toujours asservie nécesssaire-
nient à celle des périodes- , est une
preuve la plus complète, que ces évé-
nemerts n’appartiennent pas plus à
1 histoire , que les périodes elles-mêmes
ne tiennent à la Chronologie. Tout est
le fruit du même génie,
Nousn’avons point fait mention, dans
nos explications ; de là tradition Chal-
déenne sur là conflagration et l’inondation
universelles, qui forment l’été
et l’hiver de la grande année, et qu’elle
renferme dans son cercle ; tandis
qu’ioi ces catastrophes terminent la
période , et ne la divisent pas. Mais
l’origine Astrologique de Cette tradition
est trop manifeste , pour que nous
- ayons eu besoin de‘Ta-faire remarquer
, et de prouver qu’elle est une
pure fiction des Astrologues. En effet,
les anciens Astrologues regardant tous
jp. 102,