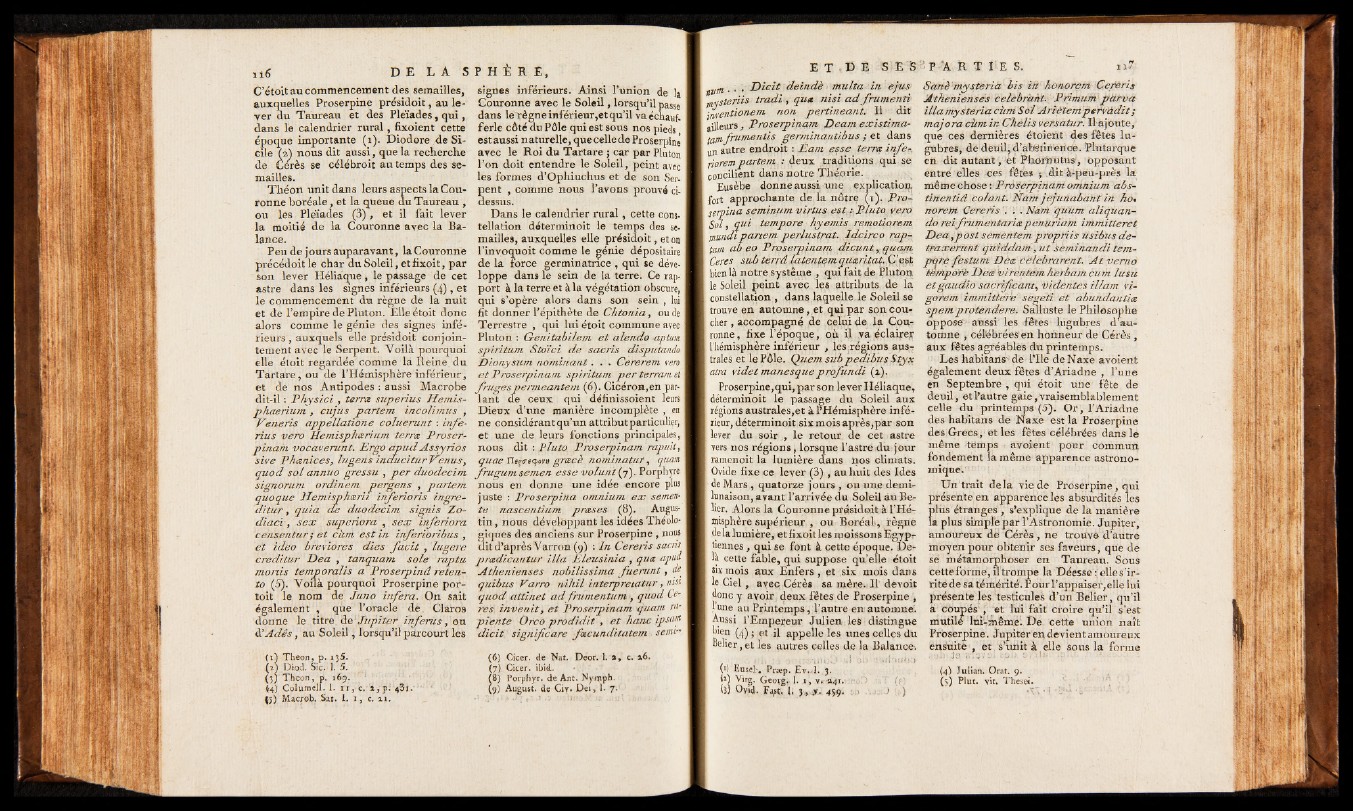
C’étoit au commencement des semailles,
auxquelles Proserpine présidoit, au lever
du Taureau et des Pleïades, qui,
dans le calendrier rural, fixoient cette
époque importante (1). Diodore de Sicile
(2) nous dit aussi, que la recherche
de Cérès se célébroit au temps des semailles.
Théon unit dans leurs aspects la Couronne
boréale, et la queue du Taureau,
ou les Pleïades (3) , et il fait lever
la moitié de la Couronne avec la Balance.
Peu de jours auparavant, laCouronne
précédoit le char du Soleil, etfixoit, par
son lever Héliaque, le passage de cet
astre dans les signes inférieurs (4) , et
le commencement du règne de la nuit
et de l’empire de Pluton. Elle étoit donc
alors comme le génie des signes inférieurs
, auxquels elle présidoit conjointement
avec le Serpent. Voilà pourquoi
elle éloit regardée comme la lleine. du
Tartare, ou de l’Hémisphère inférieur,
et de nos Antipodes : aussi Macrobe
dit-il : Physici , ternz superius Hemis-
phaerium , citjils partent incolimus ,
Veneris appellatione coluemnt : infe-
rius vero Hemispharium terra Proserpinam
vocaverunt. Ergo apud Assyrios
sive Phanices, lugens inaucitùr Venus,
quod sol annuo gressu , p e r duodecim
signùrum ordinem pergens , partent
quoque Hemispharii inferioris ingre-
ditur, quia de duodecim signis Zo-
diacï , se x superiora , s e x inferiora
censentur ; et chm est in inferibribus ,
et ideo breviores dies fa c it , lugere
creditur Dea , tanquam sole raptu
mords temporalis a Proserpind reten-
to (S). Voilà pourquoi Proserpine por-
toit le nom de Juno inféra. On sait
également , que l’oracle de. Claros
donne le titre, de! Jupiter inferus , ou
A’A d é s, au Soleil, lorsqu’il parcourt les 1 2 3
(1) Theon, p. .x35.
(2) I Sic. 1. 5 .
(3) Theon, p. 169.
44) Columell. 1. n, c . l ,p : 431.
*5) Macrob. Sat. 1. i , c. a i .
signes inférieurs. Ainsi l’union de la
Couronne avec le Soleil, lorsqu’il passe
dans le“règne inférieur,et qu’il vaéchauf-
ferle côté du Pôle qui est sous nos pieds
est aussi naturelle, que celle de Proserpine
avec le Roi du Tartare ; car par Pluton
l’on doit entendre le Soleil, peint avec
les formes d’Ophiuchus et de son Serpent
, comme nous l’avons prouvé ci-
dessus.
Dans le calendrier rural, cette constellation
détermirioit le temps des semailles,
auxquelles elle présidoit, et on
l’invoquoit comme le génie dépositaire
de la force germinatrice , qui se développe
dans le sein de la terre. Ce rap,
port à la terre et à la végétation obscure,
qui s’opère alors dans son sein , lui
fit donner l’épithète de Chtonia, ou de
Terrestre , qui lui étoit commune avec
Pluton : Genitabilem et alendo aptum
spiritum Stoïci de sacris dispictando
Dionysum nominant. Cererem vero
et Proserpinam spiritum p e r terram et
frugespermeantem (6). Cicéron,en parlant
de ceux qui définissoient leurs
Dieux d’une manière incomplète , en
ne considérant qu’un attributparticulier,
et une de leurs fonctions principales,
nous dit : Pluto Proserpinam rapuit,
quae Usçeetfovti gracè nominatut, quant
jrugumsemen esse volunt (7). Porphyre
nous en donne une idée encore plus
juste : Proserpina omnium e x semen-
te nascentium p rases (8). Augustin
, nous développant les idées Théologiques
des anciens sur Proserpine , nous
dit d’après Varron (9 ) : In Cereris sacris
pradicantur ilia Eleusinia , que apui
Athenienses nobilissima fuerunt, f
quibus Varro nihîl interpretatur, nisi
quôd attinet ad frumentum , quod Ce-
res invenit, et Proserpinam quant /**■
piente Orco prodidit , et hanc ipsam
dicit signijicare foecunditatem senti-
(6) Cicer. de Nat, Deor. 1. a , c. -6.
(7) Cicer. ibid.
8) Porphyr. de Ant. Nyinpb.
9) August. de Ciy. D e i, 1. 7.
gum . . . D ic it deindè multa in epus-
MSterus tradi,, qutt nisi ad frumenti
invendonem non pertineant. Il dit
a ille u r s , Proserpina-m Deamexistima-
ramfrumenlis germinantibus ; et dans
jiix autre endroit : Ëam esse terra infer.
dorent partent : deux traditions, qui se
concilient dans notre Théorie.
E u s è b e donne aussi une explication,
fort approchante de la nôtre (1). Pro-
; serpina seminum virtus est,: Pluto vero
Sol, qui tempore hyemis remotiorem
I jrtundipartem perlustrat. Idcirco rap-
I (ant ab eo Proserpinam, dicunt, quanti
Ceres sub terrâ latentem quæritat. Çj'eit
bien là notre système , qui fait de Pluton
le Soleil peint avec les attributs de la
constellation , dans laquelle, le Soleil se
trouve en automne, et qui par son coucher
, accompagné de celui de la Couronne
, fixe l’époque, où il va éclairer
l’hémisphère inférieur , lesrégions aus-:
traies et le Pôle. Quem sub pedibus Styx
atra videt manesque profundi ( 1 ) .
Proserpine,qui, par son lever Héliaque,
déterminoit le passage du Soleil aux
régions australes,et à l’Hémisphère inférieur,
déterminoit .six mois après,par son
lever du soir,, le retour de cet astre
vers nos régions, lorsque l’astre du jour
ramenoit la lumière dans nos climats.
Ovide fixe ce lever (3) g au huit des Ides
de Mars , quatorze jours , ou une demi-
lunaison, avant l’arrivée du Soleil àu Bélier.
Alors la Couronne présidoit à l’Hémisphère
supérieur , ou Boréal, règne
de la lumière, et fixoit les moissons Ègypr
tiennes, qui se font à cette époque. Delà
cette fable, qui suppose qu’elle étoit
six mois aux Enfers , et ,six mois dans
le Ciel, avec .Cérès sa mère. Il devoit
donc y avoir deux fêtes de Proserpine ',
1 une au Printemps, Vautre en automne;.
Aussi l’Empereur Julien les distingue
)flSU (4) î IÇt d appelle les unes celles dn
Belier, et les autres celles de la Balance.
(1) Euseh, Præp. Ev.,1. 3.
Ù) Virg. Georg,. 1. 1, .YihjQx.i ir:oÔ
(3) Oyid. 1, 3 ,.V . 439. C il > )
Sanè mysterià bis tri konorem Çerêris
Athenienses célébrant. Primum pdrva
ilia mysterià citni S ol AriétemperVàdit ;
majora cîim in Chélis vetsatur. Il ajoute,
que ces dernières étoient des fêtes lugubres,
dé deuil, d’âbëtintenoe. Plutarque
en dit autant, et Phomutus, Opposant
entré elles ces fêtés s dit à-péu-près la
même chose : Proserpinam omnium abs-
tirientiâ Cotant, ffàrn jejunabarit in ho•
noreln Cereris ; . Nam qmini aliqïtan-
do revfrumentaria penuriam immitteret
Dea ,pbsl senientem propriis itsibus de-
traxerïtht qüiddarrt , ut sèminahdi tem-
pôte festum Dèa cèlèbrarent. A t verno
tempéré Ded viren tem herbarh cuih lusu
etgaudio sacrhjvcant, ■ Videntes illam vi-
gorem immiûére' sègeti e t abundantia
spem protèndere, Salluste le Philosophe
opposé aiissi les fêtes lugubres d’automne
, célébrées? en honneur de Cérès ,
aux fêtes agréables du printemps.
Les habitans de l’Ile de Naxe avoient
également deux fêtes d’Ariadne , l’une
en Septembre , qui étoit une fête de
deuil , et l’autre gaie, vraisemblablement
celle du printemps (5). Or, l’Ariadne
des habitans de Naxe est la Proserpine
des Grecs, et les fêtes célébrées dans le
même temps avoient pour commun
fondement la même apparence astronomique.
Un’trait delà vie de PrOserpine , qui
présente en apparence les absurdités les
plus étranges , s’explique de la manière
la plus simple par l’Astronomie. Jupiter,
amoureux de Cérès, ne trouvé d’autre
moyen pour obtenir ses faveurs, que de
sé métamorphoser en Taureau. Sous
cette forme. Il trompe la Déesse :'elle s’irrité
de sa témérité. Pour l’appaiser,elle lui
présente }es testicules d’un Belier, qu’il
a céupés’ ; et lui fait croire qu’il s’est
mutile hii-mêmeL île cette union naît
Proserpine. Jupiter ery devient amoureux
ensùite , et s’unit à elle sous la forme
Ji) ow < - i v OU L' , : 1 1’ .t •
(4) Julian. Orat. 9.
(5) Plut. vit. Thesei.