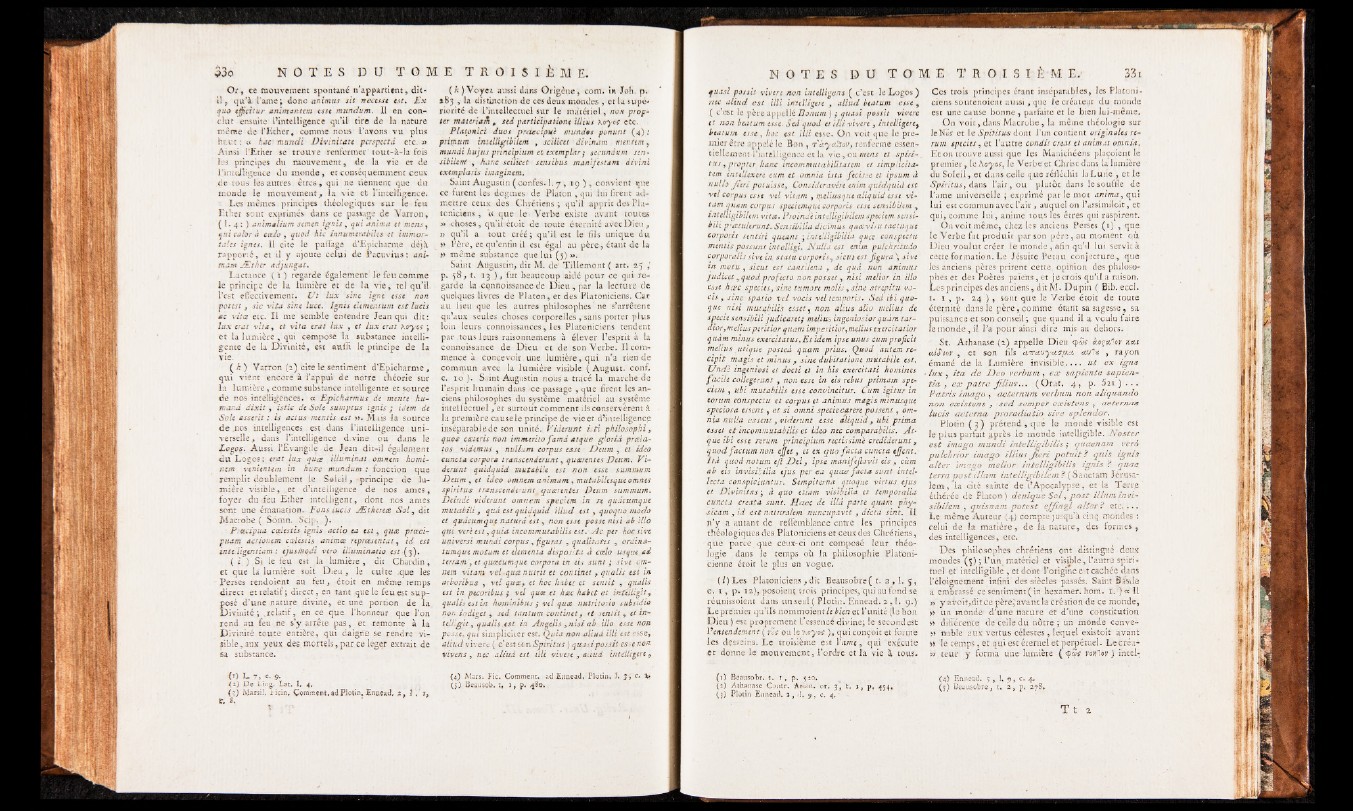
O r , ce mouvement spontané n’appartient, dit-
i l , qu’à Paine; donc animus quo ejficitur animantem esse musnitd unmec.tsst est. Ex II en conclut
ensuite l’intelligence qu’il tire de la nature
même de l’Ether, comme nous l ’ayons vu plus
ht.ut : « kac mundi Divinitate pcrspectâ etc. »
Ainsi l’Ether se trouve renfermer tout-à-la fois
les principes du mouvement, de la vie et de
l ’intelligence du monde, et conséquemment ceux
de tous les autres êtres, qui ne tiennent que du
monde le mouvement > la vie et l ’intelligence.
Les mêmes principes théologiques sur le feu
Ether sont exprimés dans ce passage de Varron,
(q u1.i 4ca:t o)r a àn icmcetlloium semen ignis, qui anima et mens, taies ignés. , quod hic innumtrabiles et immor~ 11 cite le partage d’Epicharme déjà
rmaapnpt oÆrttéh',e re ta idlj uyn gaajtoute celui de Pacuvius : ani.
Lactance ( '1 ) regarde également le feu comme
le principe de la lumière et de la v ie , tel qu’il,
pl’oetset ste ,f fescicti vveimtee nsitn. e lUucte . luIgxn issi néelé miegnntéu me seses t luncoins ac vitee etc. Il me semble entendre Jean qui dit: lux erat vit a, et vita erat lux , et lux erat hoyoç ;
et la lumière, qui compose la substance intelligente
de la Divinité, est auffi le principe de la
vie.
( h ) Varron (2) cite le sentiment d’Epicharme ,
qui vient encore à l’appui de notre théorie sur
la lumière , comme substance intelligente et source
mdea nndo sd iinxtietlligences. « Epicharmus de mente hu- Sole asserit r, isis taicc tudse Smoelen tsisu mespttus ignis ; idem de ». Mais la source
de .nos intelligences . est dans l ’intelligence universelle,
dans l’intelligence d.vine ou dans le Logos. Aussi l’Evangile de Jean dit-il également
du Logos: erat lux quee illuminât omnem homi- nem ventent em in hune mundum : fonction que
remplit doublement le Soleil, 'principe de lumière
visible, et d’intefiigènee de nos âmes,
foyer du feu Ether intelligenc, dont nos âmes
sont une émanation. F0ns lucis Ætherece Sol, dit
Jviacrobe ( Sômn. Scip. ). puaPmrc ecaicptuioxn ecmçd tcscteilse sitgisn isa naimcteizo rtaep reésste, nqtâuete prceci- inte.ïigtr.tiam: tjusmodi vtro illurninatio es,t ■i(d est 3).
( i ) Si le feu est la lumière , dit Chardin,
et que la lumière soit Dieu, le culte ,que les
Perses rendoient au feu, étoit en même temps
direct et relatif ; direct, en tant que le feu est supposé
d’une nature divine, et une portion de la
Divinité; _relatif, en ce que l’honneur que l’on
rend au feu ne s’y arrête pas, et remonte à la
Divinité toute entière, qui daigne se rendre visible
, aux yeux des mortels, par ce léger extrait de
sa substance.
( 1 ) L . 7 , c. 9.
(2 ) D e Ling. La t. 1. 4.
(?) Marsil, iricin, Ççranîent. ad Plotin. Ennead, 2, 1 . 1,
(k)\oyci aussi dans Origètie, com. in Joli. p.
183 , la distinction de ces deux mondes, et la supériorité
de l ’intellectuel sur le matériel, non prop- ter materiath 0 sed participatione illius Koyoç etc. P lato nid duos praecipuè miindos pouvait (4) : prijnum intelligibilem , scilictt divinam mentent, smibuunedni fhujus principium et exemplar; seçttndum sert- txempla r, ish iamnacg sincielmic.tt sensibus manifestant divine
Saint Augustin ( confes. 1. 7 , 19 ) , convient que
ce furent les dogmes de Platon , qui lui firent admettre
ceux des Chrétiens ; qu’il apprit des Platoniciens
, '« que le Verbe existe avant toutes
» choses, qu’il étoit de toute éternité avecDieu ,
» qu’il a tout créé; qu’il est le fils unique du
» Père, et qu’enfin il est égal au père, étant de la
» même substance que lui (5) ».
Saint Augustin, dit M. de' Tillemont ( art. 25 ,'
р. 58, t. 13 ) , fut beaucoup aidé pour ce qui regarde
la connoissance de Dieu , par la lecture de
quelques livres de Platon, et des Platoniciens. Car
au lieu que les autres philosophes ne s’arrêtent
qu’aux seules choses corporelles , sans porter plus
loin leurs connoissances, les Platoniciens tendent
par .tous leurs raisonnemens à élever l’esprit à la
connoissance de Dieu et de son Verbe. Il commence
à concevoir.une lumière, qui n’a rien de
commun avec la lumière visible ( August. conf.
с. 10 ). Saint Augustin nous a tracé la marche de
l’esprit humain dans ;ce passage , que firent les anciens
philosophes du système matériel au système
intellectuel, et surtout comment ils conservèrent à
la première causele principe de vie et d’intelligence
inséparable de son unité. Viderunt ùti philosophi, tqouso s vcitdzetemriuss non immtrito famd atque g'orià preela- cuncta corpor a, trnaunl lsuc emn dceorrupnuts esse Daim , et idto derunt quidquid mutabile es, t quneoerne nteesss eD esuumm.m Vumi
sDpeiurimtu ,s ettr aidnsecoe nodmenruemnt Aa qnuimeeraenntt,e sm uDte.iubmilt sqsuucmommnu.mes. Dmeuintadb'ei liv,i dqeruuân et sto qmunideqmu idsp eilcliuemd eisnt re quâcumqut et quâcumque naturâ est , quoquo modo qui vert est, quia incomm,u tnaobnil iess sees t.p aAssce pneirs i haobc siilvloe utunmivqtrusti m moutunmdi ecto erlpemuse,n ftiag udriasps o,s :q tua a làit âcoetelso ,u osqrudtin aad- nteermra mvi t, aemt q uvâeclu qmuqeeu ne uctorript oerta cionn teiins est u,n qtu ;a lsiisv ee sot min
aesrtb oirni bpuesc o,r ivbeuls q; uvsee,l eqtu hoeo ce th ahbxtct hext beste entt iti n,f eqlluiagliits,. qnuona liisn desitg ient , hsuemd intiabnutsu $m v ceol nqtuienee tn, uetrti tsoerniot itsubsidio tdligït , et in- pusse, q,u iqualis.est in Angelis , nisi ab illo esse non simpliciter est. Quia non aliud illi est esse, avilviuends v ,i vneercc (a cli’uesdt seosnt Siplliir ivtiuvse r) cquasipossit esse non , adud intdlïgere 9
(4) Mars. Fie . Commenr. ad Ennead, Plotin, 1, 3 , c. \>
(5) Beausob. t , 1 , p. 480.
quasi possit viverc non int eilige ns ( c’est le Logos ) nec aliud est illi Intel! igere , aliud beatum esse ,
((t cn eosnt lbee aptèurme aespspe.e Slleéd B qounoudm e t) i;l lqi uvaivsie rpeo, sisni tt eilviigveerr ect beatum esse, hoc est illi esse. On voit que le premier
être appelé le Bon , T'bjytâov, renferme essentiellement
l’intelligence et la v ie , ou mens et spiri- . tteums , ipnrtotlpletexre rhea ntucr ni necto mom mn ui ta a bis ï ltïa t af te ccmis seet est i mippsluicmit a à- vneull lcso rfipeursi e pssoet uvisesl ev, itCaomns i,d mcrealviucrscq uctr ûa nlii qquuiidd qesusitd veis-t tam quarn corpus speciemque corporis esse sensibilcm , ibnitlle lpli'gccibtuillecmru vnitt.e eS.e Pnrsoibinildia'e idnitceilmliguisb iqle nmec svpiescui etmac tsuaqiusie- cmoerpnotirsi sp osstsnutnirti inqtueelalingti .; iNnutclUlaig eibsti liaen iqtun eep uclochnnsptuccdtou ctnor pmoortauli s, ssiivceu tin .e sstt actuan ctoilrepnoar i,s , dsei cuqut âes t nfiognu raan \i msiuves jeussdei cheete,e qsupoedc ipesrofecto non posset,, nisi melior in illo ces , sine tumore molis, sine strepitu voque
, nsiinste mspuattqibo ilvise le vsosectis vel temporis. Sed ibi quo- specie sensibili judieartt; m, enloiuns ianlgiuensi oasliioor qmuealniut st adr-e qdutoarm, m meliinuussp eerxietriocrit qautuams.E imt ipdeemrit iiposre,m uenluiuss c tuxmer cpirtoaftiicoirt cmipeliitu sm uagtiiqsu ett mpoisntuesd quam prius. Quod dutem re- Unds ingeniosi et do c,t is eint e indu hbiist aetxiotrneti tmautit ahboilme inesets. fcaiecmile colltgtnint, non esse in eis rebus primam speeorum
, cuobni sprneucitua beilti sc oerspseu sc eotn avninimcituusr .m aCguims miginituusrq uine snpiaec inouslala e sessetnetn, te,t v siid eormunnti sepsescei e acalirqeurei dp ya susbein pt,r iomma
eqsusee ti beit eisnsceo mrermuurnta bpirliins ceitp iiudmeo rneeccti scsoimmpèa .crrae.bdUidise.r uAntt,
qltudo dq fuaocdt unmot unmon eefif fDete, le,t eipxs eq umoa fnaicfteafl acvuint cetias ejjcnt. ab eis invisibilia ejus per ea quae facta sunt , incùteml
ltet ctDa icvoinnistpaicsiuntur. Stmpiterna quoque vertus ejus cuncta creata ; sàu nqtu. oF laeteiacm d ev iislliâb ipliaar teet qtueammp oprahlyia
sic arn y id est naturalem nuncupavit , dicta sint. Il
n’y a autant de reflemblance entre les principes
théologiques des Platoniciens et ceux des Chrétiens,
que parce, que ceux-ci ont composé leur théologie
dans le temps oh la philosophie Platonicienne
étoit le plus en vogue.
( /) Les Platoniciens, dit Beausobre( t. 2 , 1. 5,
c. 1 , p. 12), posoienç trois principes, qui au fond se
réunissoient dans un seul ( Plotin. Ennead. 2 , 1. 9.)
Le premier qu’ils nommoient/« bien et l’unité (le bon
Dieu) est proprement l’essencé divine; le second est
l ’entendement ( vvt ou 1 e Koyoç ), qui conçoit et forme
les desseins. Le troisième est l'ame, qui exécute
Ct donne le mouvement, l’ordre et la yie à tous.
(1) Beausobr. t. 1, p. 510,
(2) Athanase Contr. Aïian. or. 3, t. j , p, 454,
(3) Plotin Ennead. 2 , A, 9, c. 4, ■
Ces trois principes étant inséparables, les Platoniciens
soutenoient aussi, que le créateur du monde
est une cause bonne , parfaite et le bien lui-même.
On voit,dans Macrobe, la même théologie sur
IreuNm« ?s peet cliets Spititus dont l ’un contient originales re- , et l ’autre condit créât et animal omnia.
Et on trouve aussi que les Manichéens plaçoient le
premier, le Koyoç, le Verbe et Christ dans la lumière
du Soleil, et dans celle que réfléchit la Luiie , et le Spiritus, dans l’air, ou plutôt dans le souffle de
l ’ame universelle ; exprimé par le mot anima, apxi
lui est commun avec l’air, auquel on l’assimiloit, et
qui, comme lui, anime tous les êtres qui respirent.
On voit même, chez les anciens Perses (1) , que
le Verbe fut produit par son père, au moment où
Dieu voulut créer le monde , afin qu’il lui servît à
cette formation. Le Jésuite Petau conjecture, que
les anciens pères prirent cette, opinion des philosophes
et des Poètes païens, et je crois qu’il a raison.
Les principes des anciens, ditM. Dupin ( Bib. eccl.
t. 1 , p. 24 ) , sont que le Verbe étoit de toute
éternité dans le père, comme étant sa sagesse, sa
puissance et son conseil ; que quand il a voulu faire
le monde, il l’a pour ainsi dire mis au dehors.
edSS'tto.v Athanase (2) appelle Dieu <paç dofoe/lov itat , et son fils aircivyajiJ.a, avis , rayon
• élumxané de la Lumière invisible. . . . ut ex igné tia y, eitxa pdâetr eD feiolm vse.r.b.um , ex sapiente sapien- (Orat. 4 , p. 5n ) . . . nPoant reisx iismteangos ,, asçetde rsneummp evre rebxuimst ennosn aliquando lucis aeterna proradiatio sive splen d, oar.eternae
Plotin (3 ) prétend , que le monde visible est
lees pt liums apgaorf amit uânpdrèi si nlete mlliognibdiel iisntelligible. Noster pulclirior imago illius fieri po t;u iqtu ?a eqnuaims igvënrios atelrtrear piomsat gilol amme liinotre lliingtieblilliegmib ?ilis ignis ? quae (Sanctam Jérusalem,
la cité sainte de l’Apocalypse, et la Ten\e'
séitbhiélreéme de Platon) denique Sot, post ilium invi- , quisnam potest effingi alter ? etc. >..
Le même Auteur (4) compte jusqu’à cinq mondes :
celui de la matière, de la nature, des formes ,
des intelligences, etc.
Des philosophes chrétiens ont distingué deux
mondes (5) ; l’un4matériel et visible, l’autre spirituel
et intelligible , et dont l’origine est cachée dans
l’éloignement infini des siècles passés. Saint Bisile
a embrassé ce sentiment (in hexamer. hom. 1. )« Il
» y avoit,dit ce père,'avant la création de ce monde,
» un monde d’une nature et d’une constitution
» différente de celle du nôtre ; un monde conve-
» nable aux vertus célestes , lequel existoit avant
» le temps, et qui est éternel et perpétuel. Lecréa-
» teur y forma une lumière ( vonlov ) intel-
(4) Ennead. ç , I. 9 , c. 4.
(5) Beausobre, t. 2, p. 278.
Tt 2