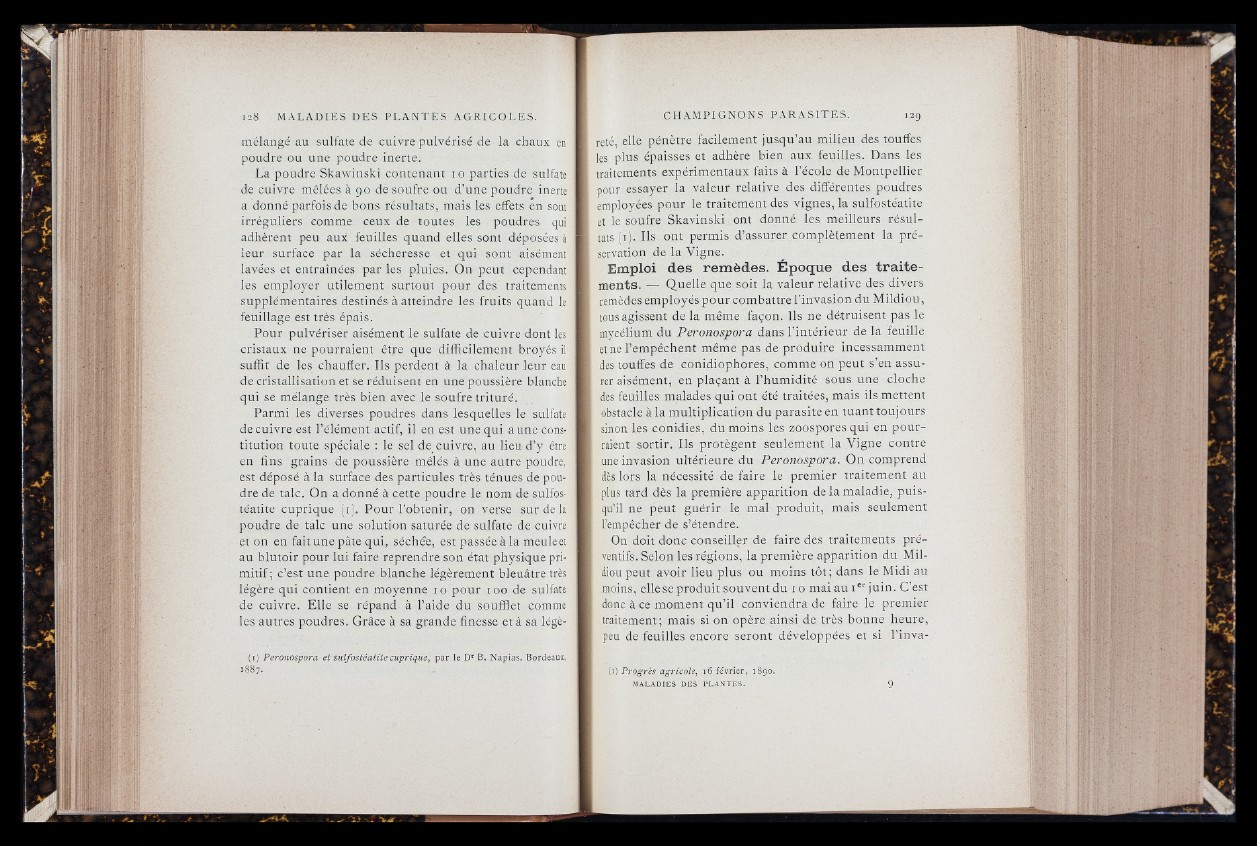
I "'fi.
mélangé au sulfate de cuivre pulvérisé de la chaux en
poudre ou une poudre inerte.
La poudre Skawinski contenant 10 parties de sulfate
de cuivre mêlées à 90 de soufre ou d’une poudre inerte
a donné parfois de bons résultats, mais les effets en sont
irréguliers comme ceux de toutes les poudres qui
adhèrent peu aux feuilles quand elles sont déposées à
leur surface par la sécheresse et qui sont aisément
lavées et entraînées par les pluies. On peut cependant
les employer utilement surtout pour des traitements
supplémentaires destinés à atteindre les fruits quand le
feuillage est très épais.
Pour pulvériser aisément le sulfate de cuivre dont les
cristaux ne pourraient être que difficilement broyés il
suffit de les chauffer. Ils perdent à la chaleur leur eau
de cristallisation et se réduisent en une poussière blanche
qui se mélange très bien avec le soufre trituré.
Parmi les diverses poudres dans lesquelles le sulfate
de cuivre est l’élément actif, il en est une qui aune constitution
toute spéciale : le sel de_ cuivre, au lieu d’y être
en fins grains de poussière mêlés à une autre poudre,
est déposé à la surface des particules très ténues de poudre
de talc. On a donné à cette poudre le nom de sulfos-
téatite cuprique (ik Pour l’obtenir, on verse sur de la
poudre de talc une solution saturée de sulfate de cuivre
et on en fait une pâte qui, séchée, est passée à la meuleet
au blutoir pour lui faire reprendre son état physique primitif
; c’est une poudre blanche légèrement bleuâtre très
légère qui contient en moyenne i o pour 1 00 de sulfate
de cuivre. Elle se répand à l’aide du soufflet comme
les autres poudres. Grâce à sa grande finesse et à sa légè-
(i) Peronospora et su lfo s téa lile cuprique, par le D' B. Napias. Bordeaux,
reté, elle pénètre facilement jusqu’au milieu des touffes
les plus épaisses et adhère bien aux feuilles. Dans les
traitements expérimentaux faits à l’école de Montpellier
pour essayer la valeur relative des différentes poudres
employées pour le traitement des vignes, la sulfostéatite
et le soufre Skavinski ont donné les meilleurs résultats
(i). Ils ont permis d’assurer complètement la préservation
de la Vigne.
Emploi des remèdes. Époque des t ra ite ments.
— Quelle que soit la valeur relative des divers
remèdes employés pour combattre l’invasion du Mildiou,
tous agissent de la même façon. Ils ne détruisent pas le
mycélium du Peronospora dans l’intérieur de la feuille
et ne l’empêchent même pas de produire incessamment
des touffes de conidiophores, comme on peut s’en assurer
aisément, en plaçant à l’humidité sous une cloche
des feuilles malades qui ont été traitées, mais ils mettent
obstacle à la multiplication du parasite en tuant toujours
sinon les conidies, du moins les zoospores qui en pourraient
sortir. Ils protègent seulement la Vigne contre
une invasion ultérieure du Peronospora. On comprend
dès lors la nécessité de faire le premier traitement au
plus tard dès la première apparition de la maladie, puisqu’il
ne peut guérir le mal produit, mais seulement
l’empêcher de s’étendre.
On doit donc conseiller de faire des traitements préventifs.
Selon les régions, la première apparition du Mildiou
peut avoir lieu plus ou moins tôt; dans le Midi au
moins, elle se produit souvent du 10 mai au i ' “ juin. C’est
donc à ce moment qu’il conviendra de faire le premier
traitement; mais si on opère ainsi de très bonne heure,
peu de feuilles encore seront développées et si l’inva(
i) P ro g r è s agricole , i6 février, 1890.
M A L A D I E S D E S P L A N T E S .
L