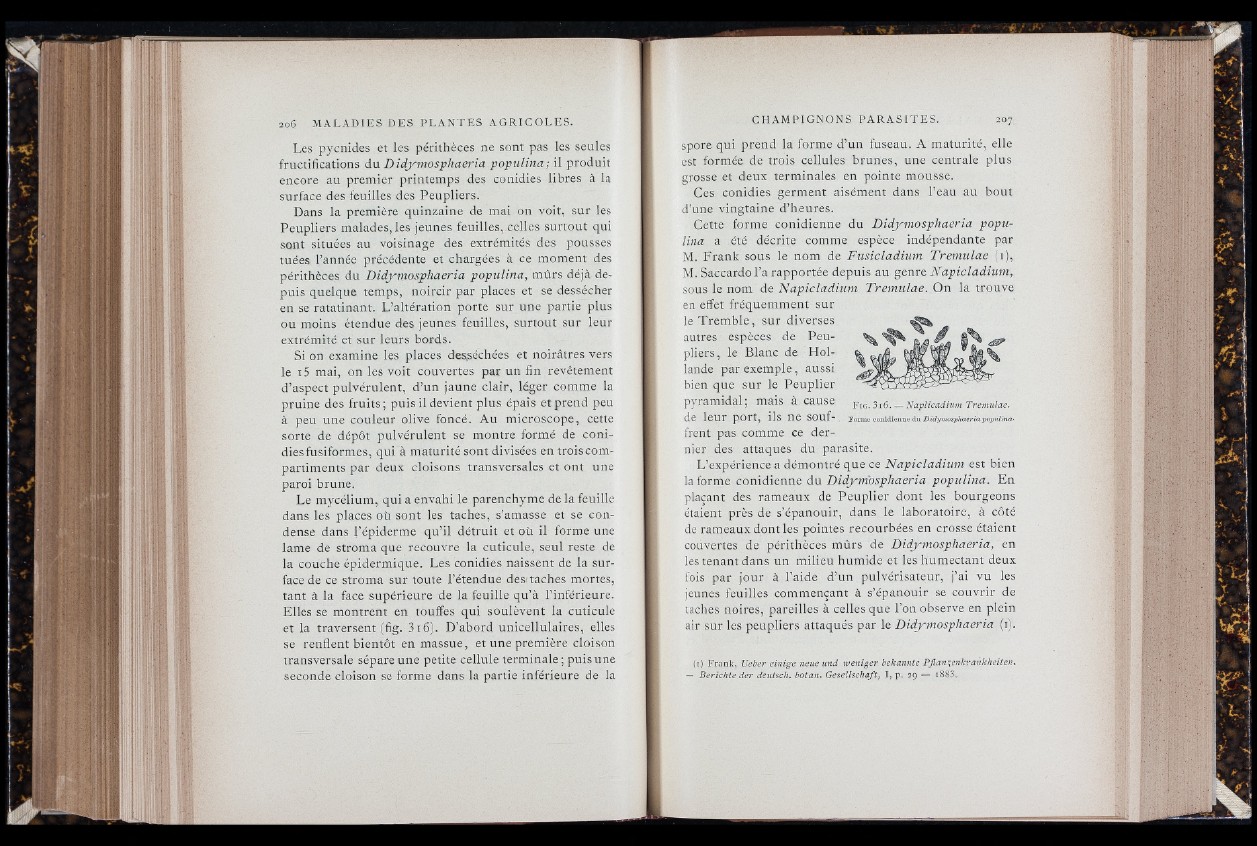
Les pycnides et les périthèces ne sont pas les seules
fructifications du. Didymosphaeria populina; il produit
encore au premier printemps des conidies libres à la
surface des feuilles des Peupliers.
Dans la première quinzaine de mai on voit, sur les
Peupliers malades, les jeunes feuilles, celles surtout qui
sont situées au voisinage des extrémités des pousses
tuées Tannée précédente et chargées à ce moment des
périthèces du Didymosphaeria populina, mûrs déjà depuis
quelque temps, noircir par places et se dessécher
en se ratatinant. L ’altération porte sur une partie plus
ou moins étendue des jeunes feuilles, surtout sur leur
extrémité et sur leurs bords.
Si on examine les places desséchées et noirâtres vers
le 1 5 mai, on les voit couvertes par un fin revêtement
d’aspect pulvérulent, d’un jaune clair, léger comme la
pruine des fruits; puis il devient plus épais et prend peu
à peu une couleur olive foncé. Au microscope, cette
sorte de dépôt pulvérulent se montre formé de conidies
fusiformes, qui à maturité sont divisées en trois compartiments
par deux cloisons transversales et ont une
paroi brune.
Le mycélium, qui a envahi le parenchyme de la feuille
dans les places où sont les taches, s’amasse et se condense
dans l’épiderme qu’il détruit et où il forme une
lame de stroma que recouvre la cuticule, seul reste de
la couche épidermique. Les conidies naissent de la surface
de ce stroma sur toute Tétendue des taches mortes,
tant à la face supérieure de la feuille qu’à l’inférieure.
Elles se montrent en touffes qui soulèvent la cuticule
et la traversent (fig. 3 i 6). D’abord unicellulaires, elles
se renflent bientôt en massue, et une première cloison
transversale sépare une petite cellule terminale; puis une
seconde cloison se forme dans la partie inférieure de la
spore qui prend la forme d’un fuseau. A maturité, elle
est formée de trois cellules brunes, une centrale plus
grosse et deux terminales en pointe mousse.
Ces conidies germent aisément dans Teau au bout
d’une vingtaine d’heures.
Cette forme conidienne du Didymosphaeria populina
a été décrite comme espèce indépendante par
M. Frank sous le nom de Fusicladium Tremulae (i),
M. Saccardo Ta rapportée depuis au gerne JSiapicladium,
sous le nom de Napicladium Tremulae. On la trouve
en effet fréquemment sur
le Tremble, sur diverses
autres espèces de Peupliers,
le Blanc de Hollande
par exemple, aussi
bien que sur le Peuplier
pyramidal; mais à cause
de leur port, ils ne souffrent
F i g . 3 i 6 . — N ap licadiiim Trcmiilae.
Forme coiiidicnnc du Diâymosÿhacriapopulina.’
pas comme ce dernier
des attaques du parasite.
L ’expérience a démontré que ce Napicladium est bien
la forme conidienne du Didymosphaeria populina. En
plaçant des rameaux de Peuplier dont les bourgeons
étaient près de s’épanouir, dans le laboratoire, à côté
de rameaux dont les pointes recourbées en crosse étaient
couvertes de périthèces mûrs de Didymosphaeria, en
les tenant dans un milieu humide et les humectant deux
fois par jour à Taide d’un pulvérisateur, j’ai vu les
jeunes feuilles commençant à s’épanouir se couvrir de
taches noires, pareilles à celles que Ton observe en plein
air sur les peupliers attaqués par le Didymosphaeria (i).
(1) Frank, Ueber einig e neue nnd w en ig e r bekannte Pßanzenkrankheiteu,
— B erichte der dentsch, botan. Gesellschaft, I, p. 29 — i 88 3 .