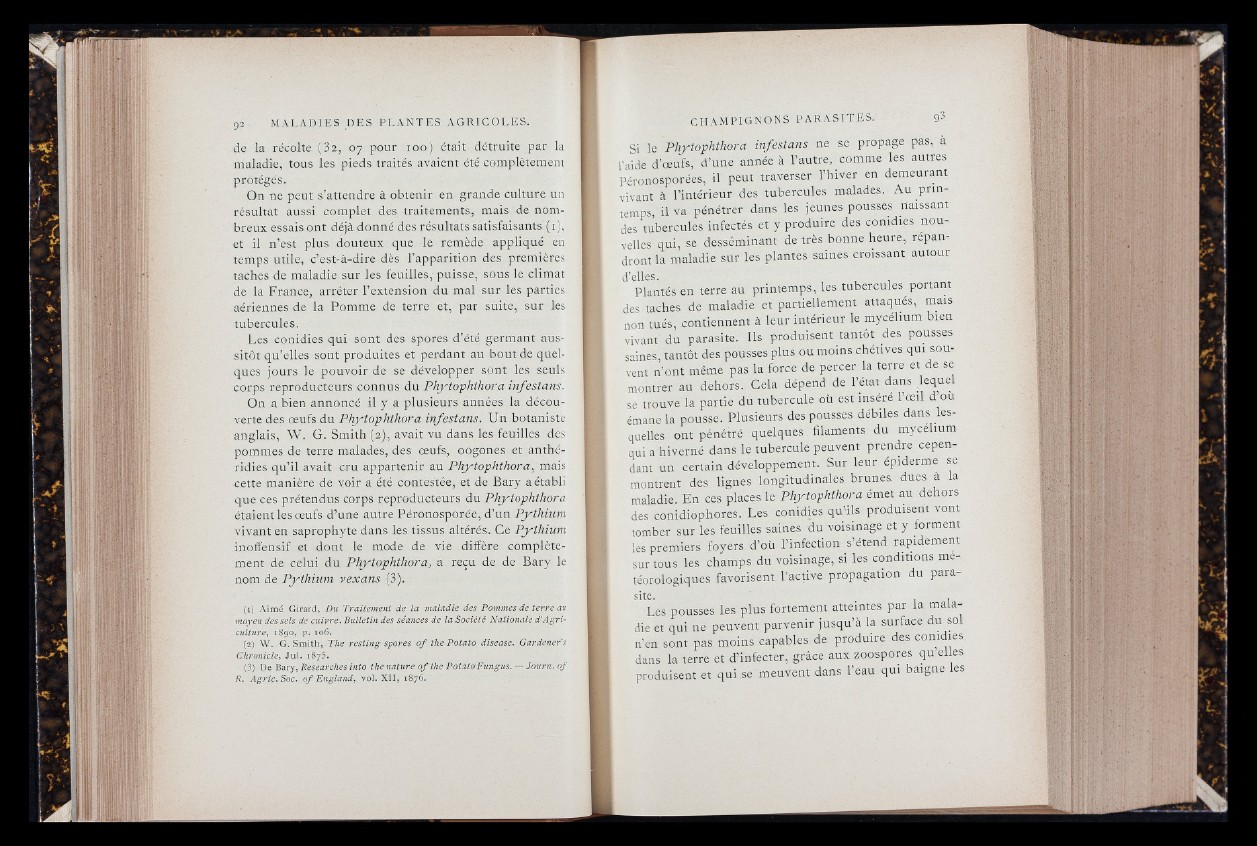
n\y
XX
îT'jl'M
■' F.
VF - fi fi.
"i"ïi -C'
■fi vV'Fi’
■fifi.'- -fil
.' 4YF... ■‘kK\l ■i• .r\
3 1
4R jJ:Y'
44' fi" ,
de la récolte (32, 07 pour 100) était détruite par la
maladie, tous les pieds traités avaient été complètement
protégés.
On ne peut s’attendre à obtenir en grande culture un
résultat aussi complet des traitements, mais de nombreux
essais ont déjà donné des résultats satisfaisants (i),
et il n’est plus douteux que le remède appliqué en
temps utile, c’est-à-dire dès l’apparition des premières
taches de maladie sur les feuilles, puisse, sous le climat
de la France, arrêter l’extension du mal sur les parties
aériennes de la Pomme de terre et, par suite, sur les
tubercules.
Les conidies qui sont des spores d’été germant aussitôt
qu’elles sont produites et perdant au bout de quelques
jours le pouvoir de se développer sont les seuls
corps reproducteurs connus du Phytophthora infestans.
On a bien annoncé il y a plusieurs années la découverte
des oeufs du Phytophthora infestans. Un botaniste
anglais, W. G. Smith (2), avait vu dans les feuilles des
pommes de terre malades, des oeufs, oogones et anthé-
ridies qu’il avait cru appartenir au Phytophthora, niais
cette manière de voir a été contestée, et de Bary a établi
que ces prétendus corps reproducteurs du Phytophthora
étaient les oeufs d’une autre Péronosporée, d’un Pythium
vivant en saprophyte dans les tissus altérés. Ce Pythium
inoffensif et dont le mode de vie diffère complètement
de celui du Phytophthora, a reçu de de Bary le
nom de Pythium vexans (3).
(1) Aimé Girard, Du Traitemeni de la maladie des Pommes de t e rr e au
moyen des sels de cu iv re . B ulletin des séances de la Société Nationale d 'A g r iculture,
1890, p. 106.
(2) W. G. Smi th, The re s tin g spores o f the Potato disease. Gardener's
Chronicle, Ju l . 1875.
(3 ) De Researches into the nature o f the PotaiO'Fungus. — Jo u rn . o f
R. A g ric . Soc. o f E n g lan d , vol. XI I , 1876.
Si le Phytophthora infestans ne se propage pas, a
l'aide d’oeufs, d’une année à l’autre, comme les autres
Péronosporées, il peut traverser l’hiver en demeurant
vivant à l’intérieur des tubercules malades. Au printemps
il va pénétrer dans les jeunes pousses naissant
des tubercules infectés et y produire des conidies nouvelles
qui, se desséniinant de très bonne heure, répandront
la maladie sur les plantes saines croissant autour
d’elles.
Plantés en terre au printemps, les tubercules portant
des taches de maladie et partiellement attaqués, mais
non tués, contiennent à leur intérieur le mycélium bien
vivant du parasite. Ils produisent tantôt des pousses
saines, tantôt des pousses plus ou moins chétives qui souvent
n’ont même pas la force de percer la terre et de se
montrer au dehors. Cela dépend de l’état dans lequel
se trouve la partie du tubercule où est insère l’oeil d ou
émane la pousse. Plusieurs des pousses débiles dans lesquelles
ont pénétré quelques filaments du mycélium
qui a hiverné dans le tubercule peuvent prendre cependant
un certain développement. Sur leur épiderme se
montrent des lignes longitudinales brune& dues a la
maladie. En ces places le Phytophthora émet au dehors
des conidiophores. Les conidies qu’ils produisent vont
tomber sur les feuilles saines du voisinage et y forment
les premiers foyers d’où l’infection s’étend rapidement
sur tous les champs du voisinage, si les conditions météorologiques
favorisent l’active propagation du parasite.
.
Les pousses les plus fortement atteintes par la mala--
die et qui ne peuvent parvenir jusqu’à la surface du sol
n’en sont pas moins capables de produire des conidies
dans la terre et d’infecter, grâce aux zoospores qu’el es
produisent et qui se meuvent dans l’eau qui baigne les