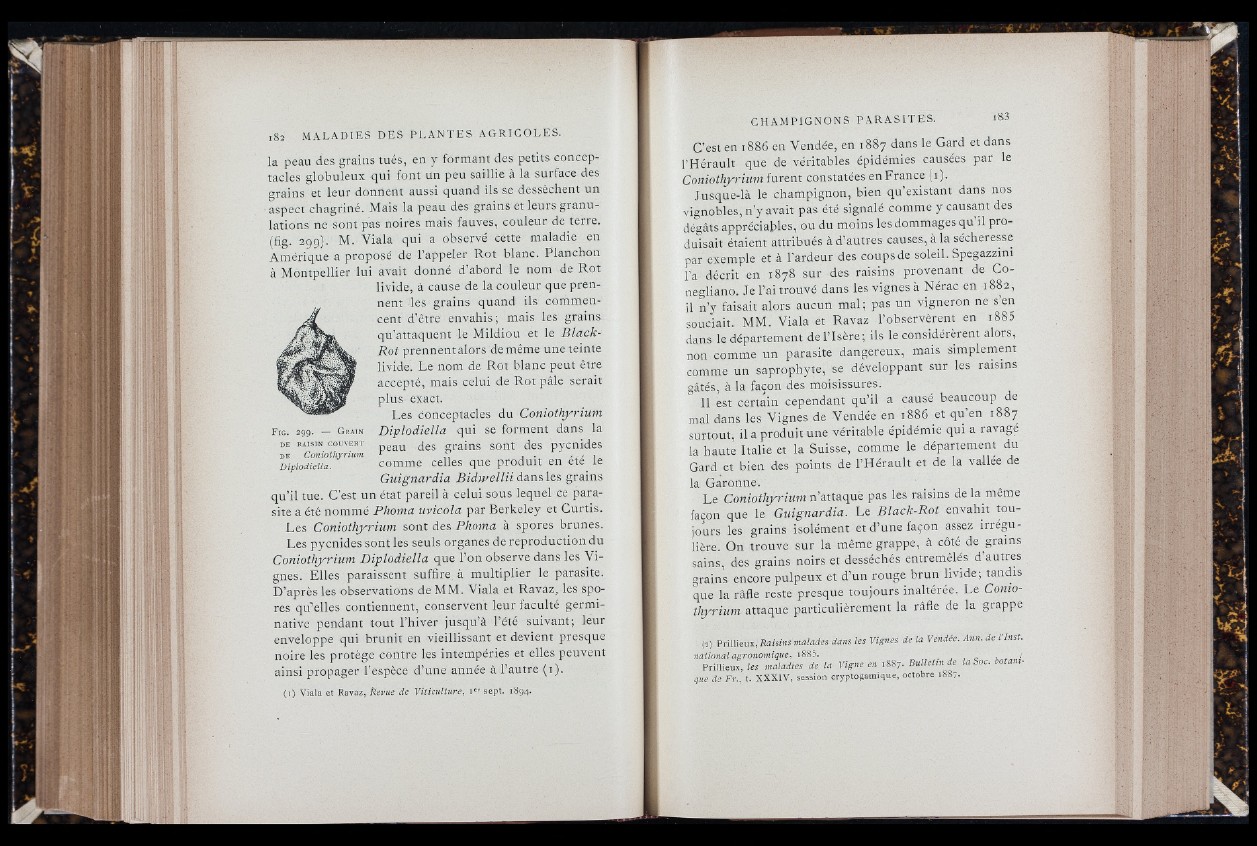
la peau des grains tués, en y formant des petits conceptacles
globuleux qui font un peu saillie à la surface des
grains et leur donnent aussi quand ils se dessèchent un
aspect chagriné. Mais la peau des grains et leurs granulations
ne sont pas noires mais fauves, couleur de terre,
(fig. 299). M. Viala qui a observé cette maladie en
Amérique a proposé de l’appeler Rot blanc. Planchón
à Montpellier lui avait donné d’abord le nom de Rot
livide, à cause de la couleur que prennent
les grains quand ils commencent
d’être envahis; mais les grains
qu’attaquent le Mildiou et le B la c k -
R o t prennentalors de même une teinte
livide. Le nom de Rot blanc peut être
accepté, mais celui de Rot pâle serait
plus exact.
Les conceptacles du Coniothyrium
D ip lo d ie lla qui se forment dans la
peau des grains sont des pycnides
comme celles que produit en été le
C u ig n a rd ia B id w e l li i àansles grains
F i g . 2 9 9 . — G r a in
DE R A IS IN COU VERT
DE Coniothyrium
Diplodiella.
qu’il tue. C’est un état pareil à celui sous lequel ce parasite
a été nommé Phoma uvicola par Berkeley et Gurtis.
Les Coniothyrium sont des Phoma à spores brunes.
Les pycnides sont les seuls organes de reproduction du
Coniothyrium D ip lo d ie lla que l’on observe dans les Vignes.
Elles paraissent suffire à multiplier le parasite.
D’après les observations de MM. Viala et Ravaz, les spores
qu’ elles contiennent, conservent leur faculté germinative
pendant tout l’hiver jusqu’à l’été suivant; leur
enveloppe qui brunit en vieillissant et devient presque
noire les protège contre les intempéries et elles peuvent
ainsi propager l’espèce d’une année à l’autre (i).
( i ) V ia la e t R a v a z , Revue de Viticulture, i " ' s e p t . 1894.
C’est en 1 886 en Vendée, en 1 887 dans le Gard et dans
l’Hérault que de véritables épidémies causées par le
Coniothyrium furent constatées en France (i).
Jusque-là le champignon, bien qu’ existant dans nos
vignobles, n’y avait pas été signalé comme y causant des
dégâts appréciables, ou du moins les dommages qu’il produisait
étaient attribués à d’autres causes, à la sécheresse
par exemple et à l’ardeur des coups de soleil. Spegazzini
l’a décrit en 1878 sur des raisins provenant de Co-
negliano. Je l’ai trouvé dans les vignes à Nérac en 1882,
il n’y faisait alors aucun mal; pas un vigneron ne s en
souciait. MM. Viala et Ravaz l’observèrent en i 885
dans le département de l’ Isère; ils le considérèrent alors,
non comme un parasite dangereux, mais simplement
comme un saprophyte, se développant sur les raisins
gâtés, à la façon des moisissures.
Il est certain cependant qu’il a causé beaucoup de
mal dans les Vignes de Vendée en 1886 et qu en 1887
surtout, il a produit une véritable épidémie qui a ravagé
la haute Italie et la Suisse, comme le département du
Gard et bien des points de l’Hérault et de la vallee de
la Garonne.
Le Co«zoi/y-rzMmn’attaque pas les raisins delà même
façon que le C u ig n a rd ia . Le B la c k -R o t envahit rou-
jours les grains isolément et d’une façon assez irrégulière.
On trouve sur la même grappe, à côté de grains
sains, des grains noirs et desséchés entremêlés d’autres
grains encore pulpeux et d’un rouge brun livide; tandis
que la râfle reste presque toujours inaltérée. Le Coniothyrium
attaque particulièrement la râfie de la grappe
(2) P r i l i i e u x , Raisins malades dans les Vignes de la Vendée. Ann. de l'bist.
national agronomique, i 885. . . , , c t.
P r i l i i e u x , les maladies de la Vigne en 1 8 8 7 . Bulletin de la Soc. botanique
de Fr., t . X X X IV , s e s s io n c r y p to g a m iq u e , o c to b r e 1 8 8 7 .