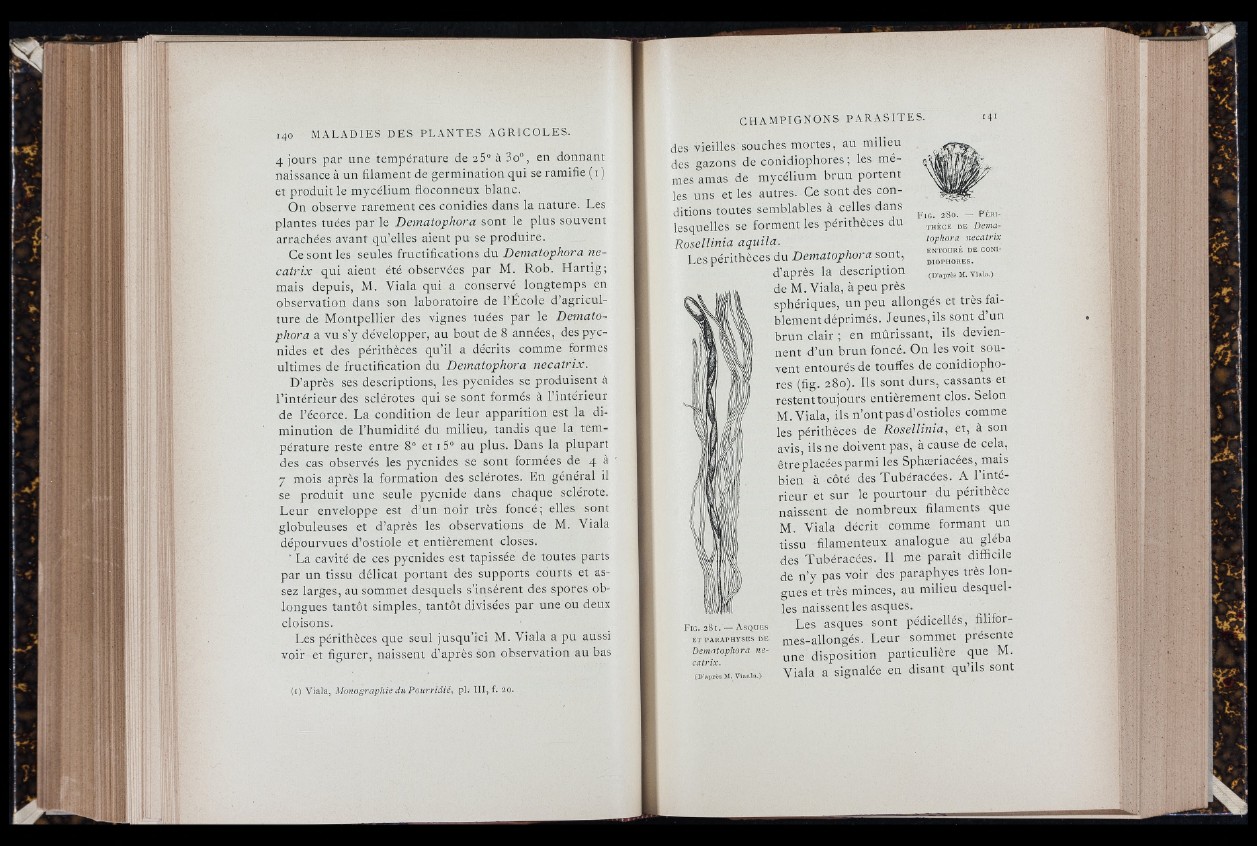
te
4 jours par une température de 35° à 3o°, en donnant
naissance à un filament de germination qui se ramifie (i )
et produit le mycélium floconneux blanc.
On observe rarement ces conidies dans la nature. Les
plantes tuées par le Dematophora sont le plus souvent
arrachées avant qu’elles aient pu se produire.
Ce sont les seules fructifications du Dematophora necatrix
qui aient été observées par M. Rob. Hartig;
mais depuis, M. Viala qui a conservé^ longtemps en
observation dans son laboratoire de l’École d’agriculture
de Montpellier des vignes tuées par le Dematophora
a vu s’y développer, au bout de 8 années, des pycnides
et des périthèces qu’il a décrits comme formes
ultimes de fructification du Dematophora necatrix.
D’après ses descriptions, les pycnides se produisent à
l ’intérieur des sclérotes qui se sont formés à l’intérieur
de l’écorce. La condition de leur apparition est la diminution
de l ’humidité du milieu, tandis que la température
reste entre 8° et i 5° au plus. Dans la plupart
des cas observés les pycnides se sont formées de 4 à '
7 mois après la formation des sclérotes. En général il
se produit une seule pycnide dans chaque sclérote.
Leur enveloppe est d'un noir très foncé; elles sont
globuleuses et d’après les observations de M. Viala
dépourvues d’ostiole et entièrement closes.
■ La cavité de ces pycnides est tapissée de toutes parts
par un tissu délicat portant des supports courts et assez
larges, au sommet desquels s’insèrent des spores oblongues
tantôt simples, tantôt divisées par une ou deux
cloisons.
Les périthèces que seul jusqu’ici M. Viala a pu aussi
voir et figurer, naissent d’après son observation au bas
(i) Viala, Monographie du P o u rr id ié , pL I I I , f. 20.
F ig . 2 8 0 . — P É R IT
H È C E DE Dematophora
necatrix
EN TO U R É DE CONID
IO PH O RE S .
(D’après M. Viala.)
des vieilles souches mortes, au milieu
des gazons de conidiophores ; les mêmes
amas de mycélium brun portent
les uns et les autres. Ce sont des conditions
toutes semblables à celles dans
lesquelles se forment les périthèces du
Rosellinia aquila.
Les périthèces du Dematophora sont,
d’après la description
de M. Viala, à peu près
sphériques, un peu allongés et très faiblement
déprimés. Jeunes, ils sont d un
brun clair ; en mûrissant, ils deviennent
d’un brun foncé. On les voit souvent
entourés de touffes de conidiophores
(fig. 280). Ils sont durs, cassants et
restenttoujours entièrement clos. Selon
M. Viala, ils n’ont pas d’ostioles comme
les périthèces de Rosellinia, et, à son
avis, ils ne doivent pas, à cause de cela,
être placées parmi les Sphæriacées, mais
bien à côté des Tubéracées. A l’intérieur
et sur le pourtour du périthèce
naissent de nombreux filaments que
M. Viala décrit comme formant un
tissu filamenteux analogue au gfoba
des Tubéracées. Il me paraît difficile
de n’y pas voir des paraphyes très longues
et très minces, au milieu desquel-
WPII les naissent les asques.
F , c, . 2 8 . . - xVs q u e s Les asques sont pédicellés, fiüfor-
ET PARAPHÏSES DE mcs-allongés. Leur sommet présente
Dematophora ne- disposition particulière que M.
T#M.yre.ia.) Viala a signalée en disant qu’ils sont
R i'® '!'