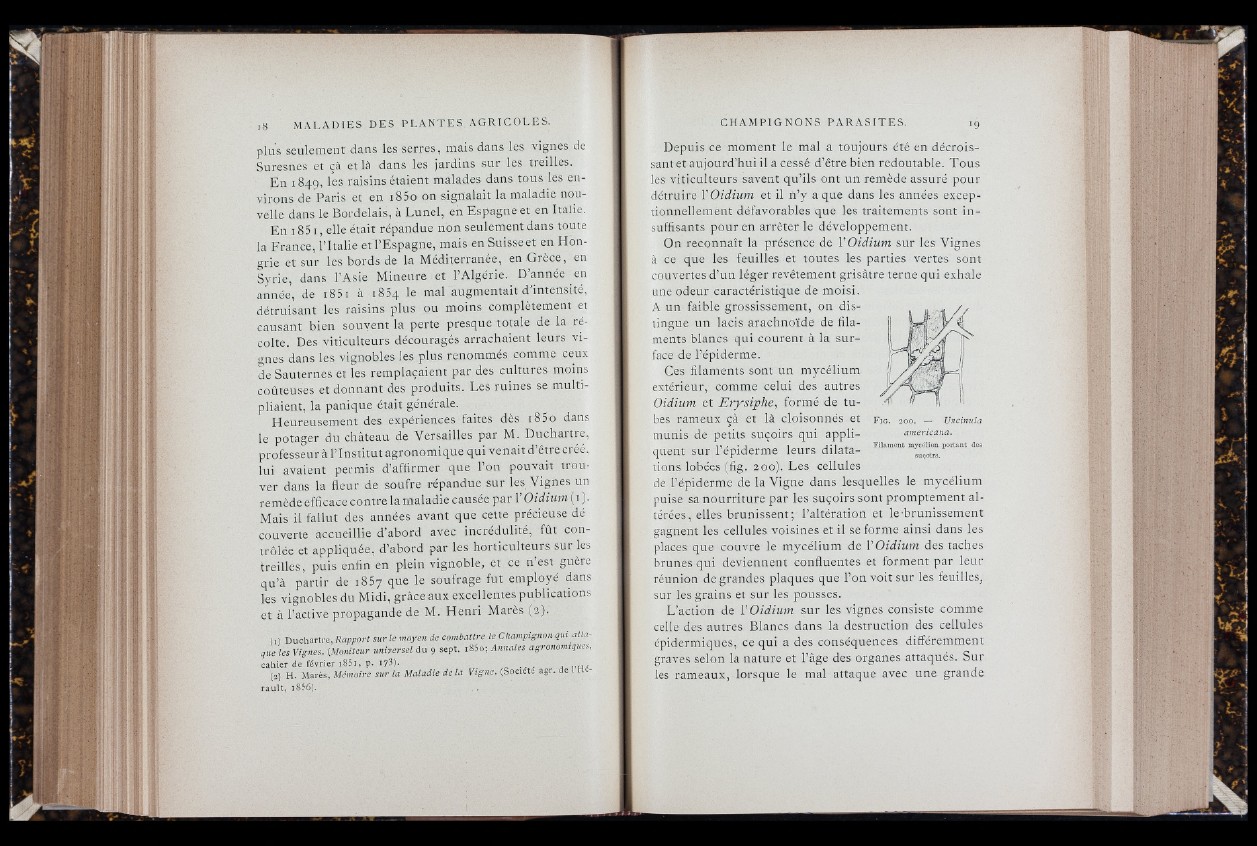
plus seulement dans les serres, mais dans les vignes de
Suresnes et çà et là dans les jardins sur les treilles.
En 1849, les raisins étaient malades dans tous les environs
de Paris et en i 85o on signalait la maladie nouvelle
dans le Bordelais, à Lunel, en Espagne et en Italie.
En 1 85 I , elle était répandue non seulement dans toute
la France, ITtalie et l’Espagne, mais en Suisse et en Hongrie
et sur les bords de la Méditerranée, en Grèce, en
Syrie, dans l’Asie Mineure et l’Algérie. D’année en
année, de i 8 5 i à 1854 le mal augmentait d'intensité,
détruisant les raisins plus ou moins complètement et
causant bien souvent la perte presque totale de la récolte.
Des viticulteurs découragés arrachaient leurs v ignes
dans les vignobles les plus renommés comme ceux
"de Sauternes et "les remplaçaient par des cultures moins
coûteuses et donnant des produits. Les ruines se multipliaient,
la panique était générale.
Heureusement des expériences faites dès i 8 5 o dans
le potager du château de Versailles par M. Duchartre,
professeur à l’ Institut agronomique qui venait d’ên-e créé,
lui avaient permis d’affirmer que l’on pouvait trouver
dans la fleur de soufre répandue sur les Vignes un
remède efficace contre la maladie causée par l’Oidium ( i ).
Mais il fallut des années avant que cette précieuse dé
couverte accueillie d’abord avec incrédulité, fût contrôlée
et appliquée, d’abord par les horticulteuis sur les
treilles, puis enfin en plein vignoble, et ce n’est guere
qu’à partir de iSSy que le soufrage fut employé dans
les vignobles du Midi, grâce aux excellentes publications
et à l’active propagande de M. Henri Marès (3).
(1) Duch a r t r e , Rapport sur le moyen de combattre le Champignon qui attaque
les Vignes. [Moniteur univ ersel du 9 sept. i 85o; Annales agronomiques,
cahier de février i 8 5 i , p. 17 3 ). .
(2) H. Marès, Mémoire sur la Ma la die d e là Vigne . (Société agr. de 1 Hérau
lt, i 856).
Depuis ce moment le mal a toujours été en décroissant
et aujourd’hui il a cessé d’être bien redoutable. Tous
les viticulteurs savent qu’ils ont un remède assuré pour
détruire Y Oidium et il n’y a que dans les années exceptionnellement
défavorables que les traitements sont insuffisants
pour en arrêter le développement.
On reconnaît la présence de V Oidium sur les Vignes
à ce que les feuilles et toutes les parties vertes sont
couvertes d’un léger revêtement grisâtre terne qui exhale
une odeur caractéristique de moisi.
A un faible grossissement, on distingue
un lacis arachnoïde de filaments
blancs qui courent à la surface
de l’épiderme.
Ces filaments sont un mycélium
extérieur, comme celui des autres
Oidium et Ery siphe , formé de tubes
rameux çà et là cloisonnés et
munis de petits suçoirs qui appliquent
sur l’épiderme leurs dilatations
lobées (fig. 200). Les cellules
F ig . 200. — Uncinula
amei'icana.
Filament mycélien portant des
suçoirs.
de l’épiderme de la Vigne dans lesquelles le mycélium
puise sa nourriture par les suçoirs sont promptement altérées,
elles brunissent; l’altération et le'brunissement
gagnent les cellules voisines et il se forme ainsi dans les
places que couvre le mycélium de VOidium des taches
brunes qui deviennent confluentes et forment par leur
réunion de grandes plaques que l’on voit sur les feuilles,
sur les grains et sur les pousses.
L ’action de ï Oidium sur les vignes consiste comme
celle des autres Blancs dans la destruction des cellules
épidermiques, ce qui a des conséquences différemment
graves selon la nature et l’âge des organes attaqués. Sur
les rameaux, lorsque le mal attaque avec une grande