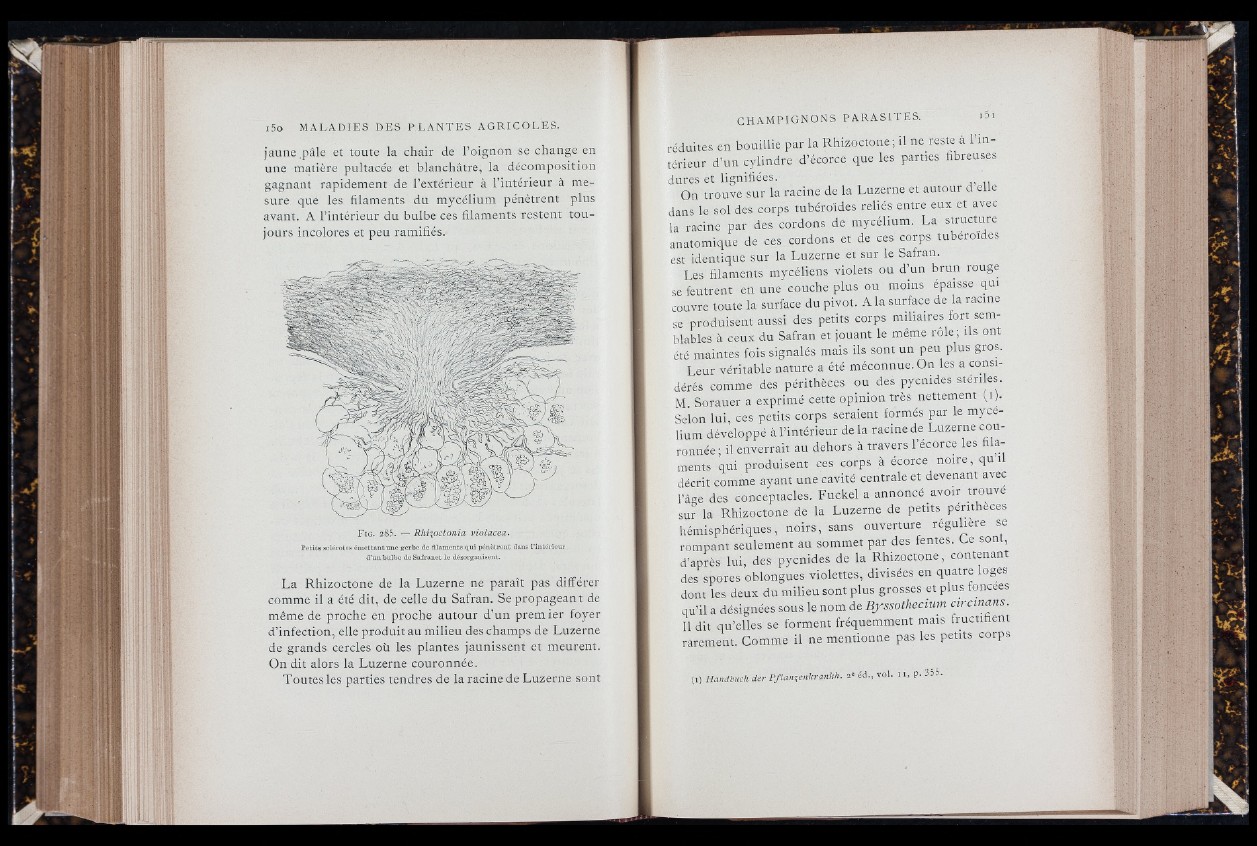
jaune ,pâle et toute la chair de l’oignon se change en
une matière pultacée et blanchâtre, la décomposition
gagnant rapidement de l’extérieur à l’intérieur à mesure
que les filaments du mycélium pénètrent plus
avant. A l’intérieur du bulbe ces filaments restent toujours
incolores et peu ramifiés.
F ig . 2 8 5 . — Rhizoctonia violacea.
Petits sclérotes émettant une gerbe de filaments qui pénètrent dans l ’intérieur
d'un bulbe deSafranct le désorganisent.
La Rhizoctone de la Luzerne ne paraît pas différer
comme il a été dit, de celle du Safran. Se propageant de
même de proche en proche autour d’un premier foyer
d’infection, elle produit au milieu des champs de Luzerne
de grands cercles où les plantes jaunissent et meurent.
On dit alors la Luzerne couronnée.
Toutesles parties tendres de la racine de Luzerne sont
ü
réduites en bouillie par la Rhizoctone ; il ne reste a 1 intérieur
d’un cylindre d’écorce que les parties fibreuses
dures et lignifiées.
On trouve sur la racine de la Luzerne et autour d elle
dans le sol des corps tubéroïdes reliés entre eux et avec
la racine par des cordons de mycélium. La structure
anatomique de ces cordons et de ces corps tubéroïdes
est identique sur la Luzerne et sur le Safran.
Les filaments mycéliens violets ou d’un brun rouge
se feutrent en une couche plus ou moins epaisse qui
couvre toute la surface du pivot. A la surface de la racine
se produisent aussi des petits corps miliaires fort semblables
à ceux du Safran et jouant le mêpae rôle; ils ont
été maintes fois signalés mais ils sont un peu plus gros.
Leur véritable nature a été méconnue. On les a considérés
comme des périthèces ou des pycnides stériles
M. Sorauer a exprimé cette opinion très nettement (i).
Selon lui, ces petits corps seraient formés par le mycélium
développé à l’intérieur de la racine de Luzerne couronnée;
il enverrait au dehors à travers l’écorce les hla-
ments qui produisent ces corps à écorce noire, qu il
décrit comme ayant une cavité centrale et devenant avec
l’âge des conceptacles. Fuckel a annoncé avoir trouve
sur la Rhizoctone de la Luzerne de petits péritheces
hémisphériques, noirs, sans ouverture réguhere se
rompant seulement au sommet par des fentes. Ce sont,
d’après lui, des pycnides de la Rhizoctone, contenant
des spores oblongues violettes, divisées en quatre loges
dont les deux du milieu sont plus grosses et plus foncées
qu’il a désignées sous le nom de Byssothecium circinans.
Il dit qu’elles se forment fréquemment mais fructihent
rarement. Comme il ne mentionne pas les petits corps
(I) Handbuch der Pßaiizenkrankh. 2' é d . , v o l . 11, p . 3 d 2.