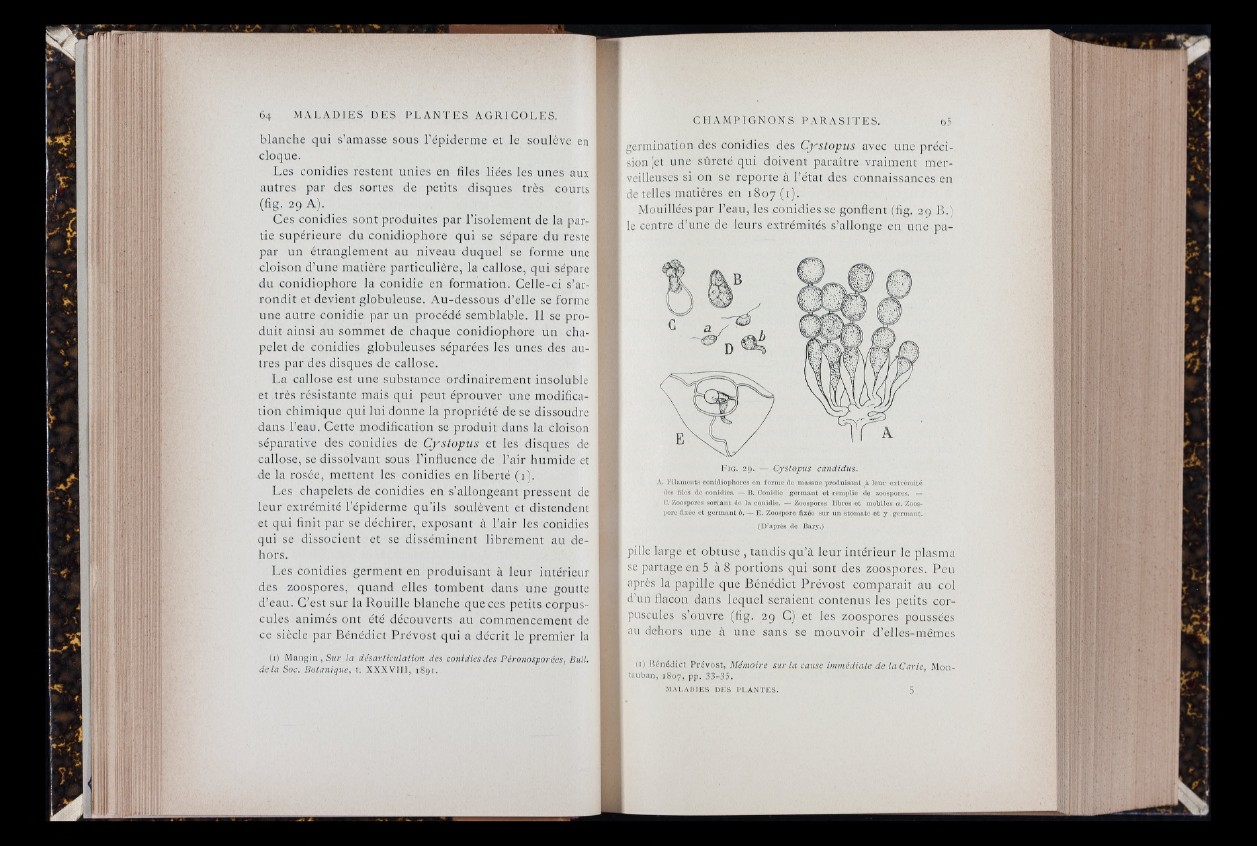
' : y |
i! i3,| ;
i G Y '
blanche qui s’amasse sous l’épidcrme et le soulève en
cloque.
Les conidies restent unies en lilcs liées les unes aux
autres par des sortes de petits disques très couris
(flg. 29 A).
Ces conidies sont produites par l’isolement de la partie
supérieure du conidiophore qui sc sépare du reste
par un étranglement au niveau duquel sc forme une
cloison d’une matière particulière, la callose, qui sépare
du conidiophore la conidie en formation. Celle-ci s’arrondit
et devient globuleuse. Au-dessous d’elle se forme
une autre conidie |)ar un procédé semblable. 11 sc produit
ainsi au sommet de chaque conidiophore un chapelet
de conidies globuleuses séparées les unes des autres
par des disques de callose.
La callose est une substance ordinairement insoluble
et très résistante mais qui peut éprouver une modilica-
lion chimique qui lui donne la propriété de sc dissoudre
dans l’eau. Cette modification se produit dans la cloison
séparativc des conidies de Cystopus et les disques de
callose, se dissolvant sous l’inllucnce de l’air humide et
de la rosée, mettent les conidies en liberté (i).
Les chapelets de conidies en s’allongeant pressent de
leur extrémité l’épidcrme qu'ils soulèvent et distendent
Cl qui finit par se déchirer, exposant à l’air les conidies
qui sc dissocient et se disséminent librement au dehors.
Les conidies germent en produisant à leur intérieur
des zoospores, quand elles tombent dans une goutte
d’eau. C ’est sur la Rouille blanche que ces petits corpuscules
animés ont été découverts au commencement de
ce siècle par Béncdicl l^’rcvost qui a décrit le premier la
(1) Manf-iii, Siii* /a ciésartiailaLUm des conidies des Péronosporées, Bull,
d e là Soc. Botanique, t. X X X V 11.1, i8 y i .
germination des conidies des Cystopus avec une précision
(cl une sûreté qui doivent paraître vraiment merveilleuses
si on sc reporte à l ’état des connaissances en
de telles matières en 1807 (i).
Mouillées par l’eau, les conidies sc gonflent (flg. 29 B.)
le centre d’une de leurs extrémités s’allonge eu une pal'’
iG. 2(j. -• Cystopus candidus.
A. cuukli()|)lior<!H nu l'ovino do iuivksuo p r o d u lH iu iy it lo u f o x lr n n iit è
doH liluH du c.onidioH. .IL l.’o iiiilio g o rm iii it u t vn n iiillo tlo /.oos])oroH. —
C. /-oowpovuH HorfauL du ]a uoiiidlc. — ZixmpovoK libros ot mobiloH a . Z008-
poi'ü lixuu ut K<!fmiint b. — (lî. Zoot-inn-o ilx6o 8ur un sLouintu oL y gnriiiaiit.
I l ) ’apvù8 do (Bary.)
pille large et obtuse , tandis qu’à leur intérieur le plasma
se partage en 5 à 8 portions qui sont des zoospores. Peu
après la papille que Béncdicl Prévost comparait au col
d’un llacon dans lequel seraient contenus les petits corpuscules
s’ouvrc (iig. 29 C) et les zoospores poussées
au dehors une à une sans sc mouvoir d’ellcs-mémcs
(1) Bcnédic t P r é v o s t , Mémoire sur la cause immédiate de la C a r ic , M o n -
liuibiin, pp. 3 3 -3 5 .
M. îL A O L E S D K S 1‘L A N T K S . 5