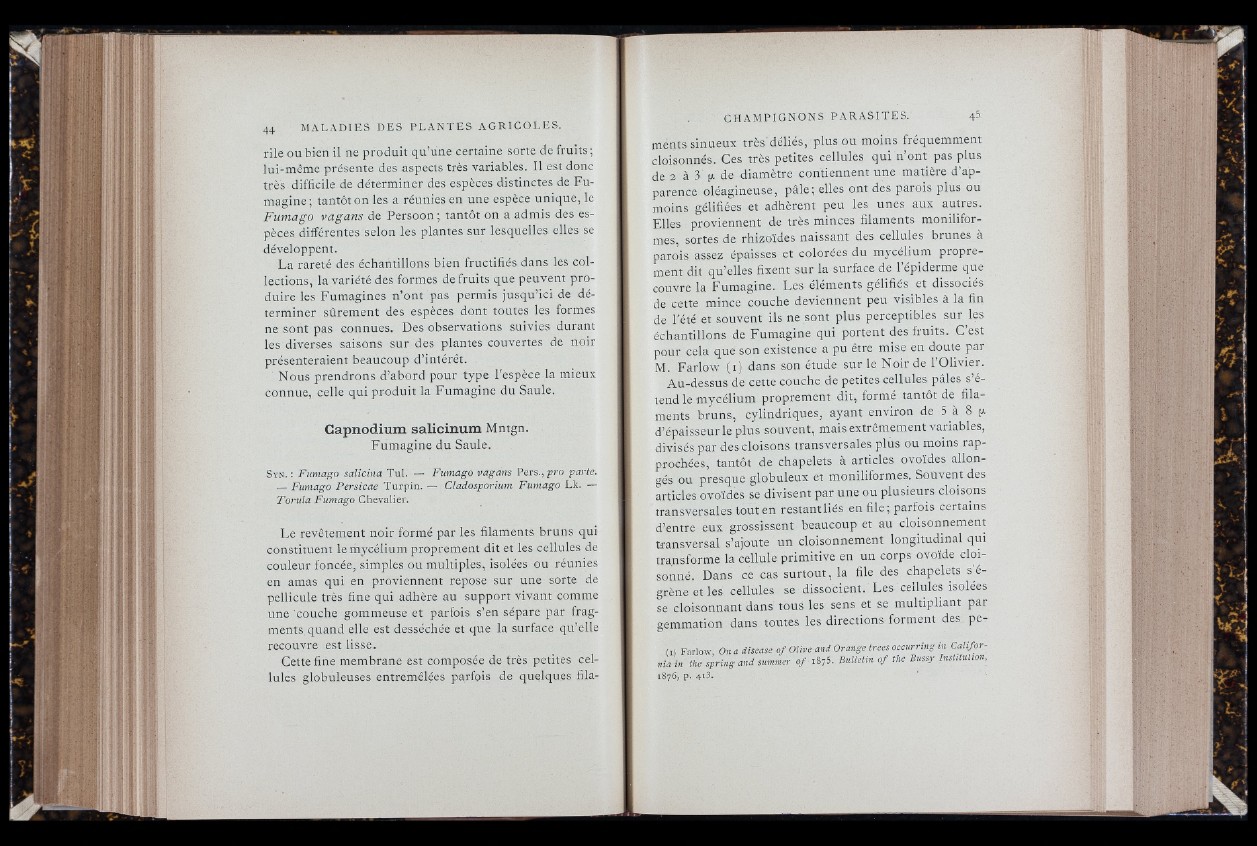
rile ou bien il ne produit qu’une certaine sorte de fruits;
lui-même présente des aspects très variables. 11 est donc
très difficile de déterminer des espèces distinctes de Fumagine
; tantôt on les a réunies en une espèce unique, le
Fumago vagans de Persoon ; tantôt on a admis des espèces
différentes selon les plantes sur lesquelles elles se
développent.
La rareté des échantillons bien fructifiés dans les collections,
la variété des formes de fruits que peuvent produire
les Fumagines n’ont pas permis jusqu’ici de déterminer
sûrement des espèces dont toutes les formes
ne sont pas connues. Des observations suivies durant
les diverses saisons sur des plantes couvertes de noir
présenteraient beaucoup d’intérêt.
Nous prendrons d’abord pour type l'espèce la mieux
connue, celle qui produit la Fumagine du Saule.
C a p n o d ium s a lic in um Mntgn.
Fumagine du Saule.
Syn.; Fumago salicina Tul. — Fumago vagans Pers., pro parte.
— Fumago Persicae Turpin. — Cladosporium Fumago Lk. —
Tortda Fumago Chevalier.
Le revêtement noir formé par les filaments bruns qui
constituent le mycélium proprement dit et les cellules de
couleur foncée, simples ou multiples, isolées ou réunies
en amas qui en proviennent repose sur une sorte de
pellicule très fine qui adhère au support vivant comme
une couche gommeuse et parfois s’en sépare par fragments
quand elle est desséchée et que la surface qu’elle
recouvre est lisse.
Cette fine membrane est composée de très petites cellules
globuleuses entremêlées parfois de quelques filaments
sinueux très déliés, plus ou moins fréquemment
cloisonnés. Ces très petites cellules qui n’ont pas plus
de 2 à 3 [X de diamètre contiennent une matière d’apparence
oléagineuse, pâle; elles ont des parois plus ou
moins gélifiées et adhèrent peu les unes aux autres.
Elles proviennent de très minces filaments monilifor-
mes, sortes de rhizoïdes naissant des cellules brunes à
parois assez épaisses et colorées du mycélium proprement
dit qu’elles fixent sur la surface de l’épiderme que
couvre la Fumagine. Les éléments gélifiés et dissociés
de cette mince couche deviennent peu visibles à la fin
de l’été et souvent ils ne sont plus perceptibles sur les
échantillons de Fumagine qui portent des fruits. C’est
pour cela que son existence a pu être mise en doute par
M. Farlow (i) dans son étude sur le Noir de l’Olivier.
Au-dessus de cette couche de petites cellules pâles s’étend
le mycélium proprement dit, formé tantôt de filaments
bruns, cylindriques, ayant environ de 5 à 8 jx
d’épaisseur le plus souvent, mais extrêmement variables,
divisés par des cloisons transversales plus ou moins rapprochées,
tantôt de chapelets à articles ovoïdes allongés
ou presque globuleux et moniliformes. Souvent des
articles ovoïdes se divisent par une ou plusieurs cloisons
transversales tout en restant liés en file; parfois certains
d’entre eux grossissent beaucoup et au cloisonnement
transversal s’ajoute un cloisonnement longitudinal qui
transforme la cellule primitive en un corps ovoïde cloisonné.
Dans ce cas surtout, la file des chapelets s'égrène
et les cellules se dissocient. Les cellules isolées
se cloisonnant dans tous les sens et se multipliant par
gemmation dans toutes les directions forment des pe-
(I) F a r lo w , On a disease o f Olive and Orange trees occurring in C alifo rnia
in the spring and summer o f 1 8 7 5 . Bulletin o f the Bussy InsUtuUon,
1876; p . 4 i 3.
| | i | l
i f
a T 0 \