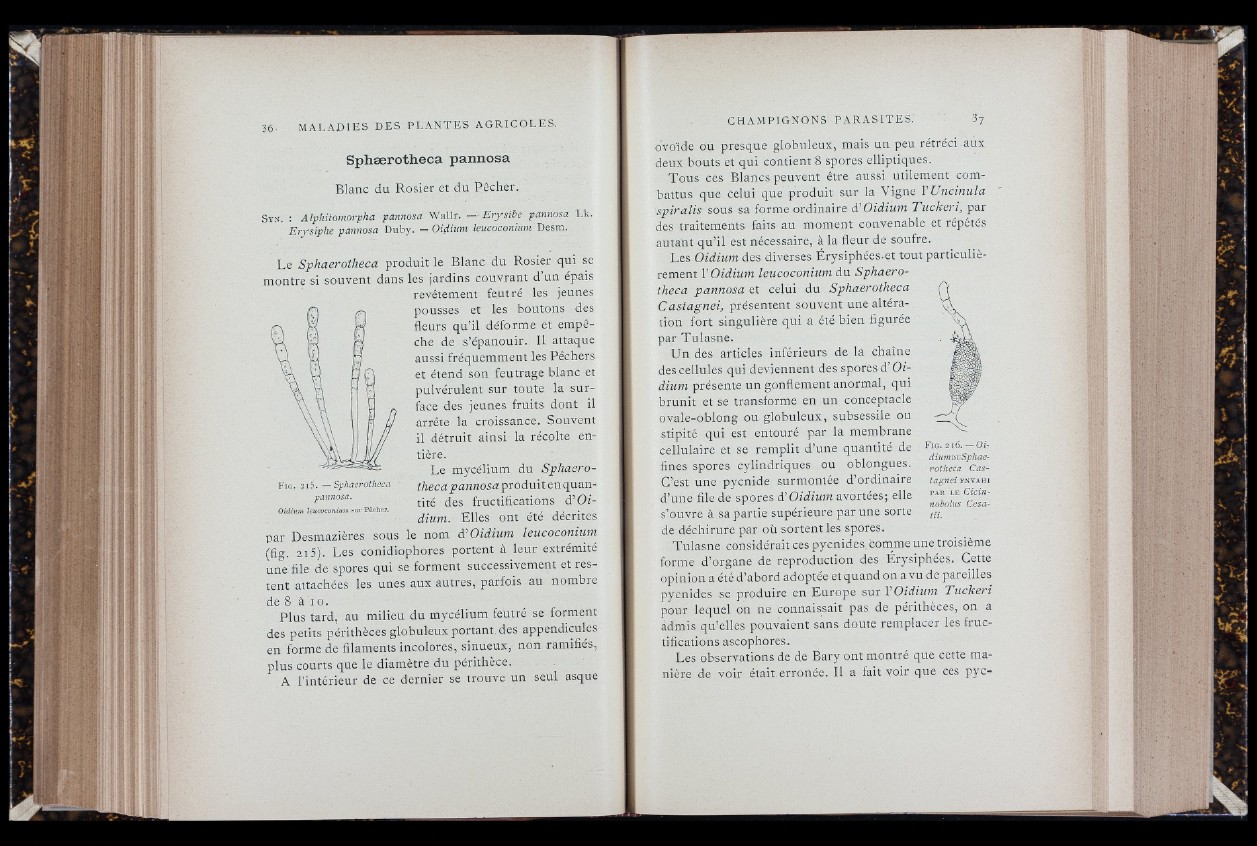
lì - te l I;
A m
K " tei
pM /ri i ì
isri- , : r ;
IJSphærotheca
pannosa
Blanc du Rosier et du Pêcher.
Syn. : Alphitomorpha pannosa Wallr. — E ry s ib e pannosa Lk.
E ry s ip h e pannosa Duby. - Oidium leucoconium Desm.
Le Sphaerotheca produit le Blanc du Rosier qui re
montre si souvent dans les jardins couvrant d’un épais
revêtement feutré les jeunes
pousses et les boutons des
fleurs qu’il déforme et empêche
de s’épanouir. Il attaque
aussi fréquemment les Pêchers
et étend son feutrage blanc et
pulvérulent sur toute la surface
des jeunes fruits dont il
arrête la croissance. Souvent
il détruit ainsi la récolte entière.
Le mycélium du Sphaerotheca
pannosa produit en quantité
des fructifications d’Of-
dium. Elles ont été décrites
Fiu. 2 1 5. — Sphaerotheca
pannosa.
Oidium leucoconium s u r P ê c h e r .
par Desmazières sous le nom à'Oidium ieucoconium
(fig. 2 1 5). Les conidiophores portent à leur extrémité
une file de spores qui se forment successivement et restent
attachées les unes aux autres, parfois au nombre
de 8 à Io .
Plus tard, au milieu du mycélium feutré se forment
des petits périthèces globuleux portant des appendicules
en forme de filaments incolores, sinueux, non ramifiés,
plus courts que le diamètre du périthèce.
A l’intérieur de ce dernier se trouve un seul asque
ovo'ide ou presque globuleux, mais un peu rétréci aux
deux bouts et qui contient 8 spores elliptiques.
Tous ces Blancs peuvent être aussi utilement combattus
que celui que produit sur la Vigne l'Uncinuia
spiraiis sous sa forme ordinaire à'Oidium Tuckeri, par
des traitements faits au moment convenable et répétés
autant qu’il est nécessaire, à la fleur de soufre.
Les Oidium des diverses Érysiphées-et tout particulièrement
y Oidium ieucoconium à u Sphaerotheca
pannosa et celui du Sphaerotheca
Castagnei, présentent souvent une altération
fort singulière qui a été bien figurée
par Tulasne.
Un des articles inférieurs de la chaîne
des cellules qui deviennent des spores d’ 01-
dium présente un gonflement anormal, qui
brunit et se transforme en un conceptacle
ovale-oblong ou globuleux, subsessile ou
stipité qui est entouré par la membrane
cellulaire et se remplit d’une quantité de
fines spores cylindriques ou oblongues.
C’est une pycnide surmontée d’ordinaire
d’une file de spores à'Oidium avortées; elle
s’ouvre à sa partie supérieure par une sorte
de déchirure par où sortent les spores.
Tulasne considérait ces pycnides comme une troisième
forme d’organe de reproduction des Érysiphées. Cette
opinion a été d’abord adoptée et quand on a vu de pareilles
pycnides se produire en Europe sur V Oidium Tuckeri
pour lequel on ne connaissait pas de périthèces, on a
admis qu’elles pouvaient sans doute remplacer les fructifications
ascophores.
F i g . 2 1 6 . — Oi-
diiuuYiV,Sphae'
rothcca Castagne
i E'.NV.AHl
P A R L E Cicin-
nobolus Cesata.
Les observations de de Bary ont montré que cette manière
de voir était.erronée. Il a fait voir que ces pyc-
A'ùr r0i t3e. /ri"'
0 . 0 0
À-'L- /T
k ; ® : - ;
,, f
l ï t e k
.tei
'•É !
¡0 0 0 ! rivi
:B ; | : i t e . ï
tefeikl-terei
0M:00.i
ri te
ite.