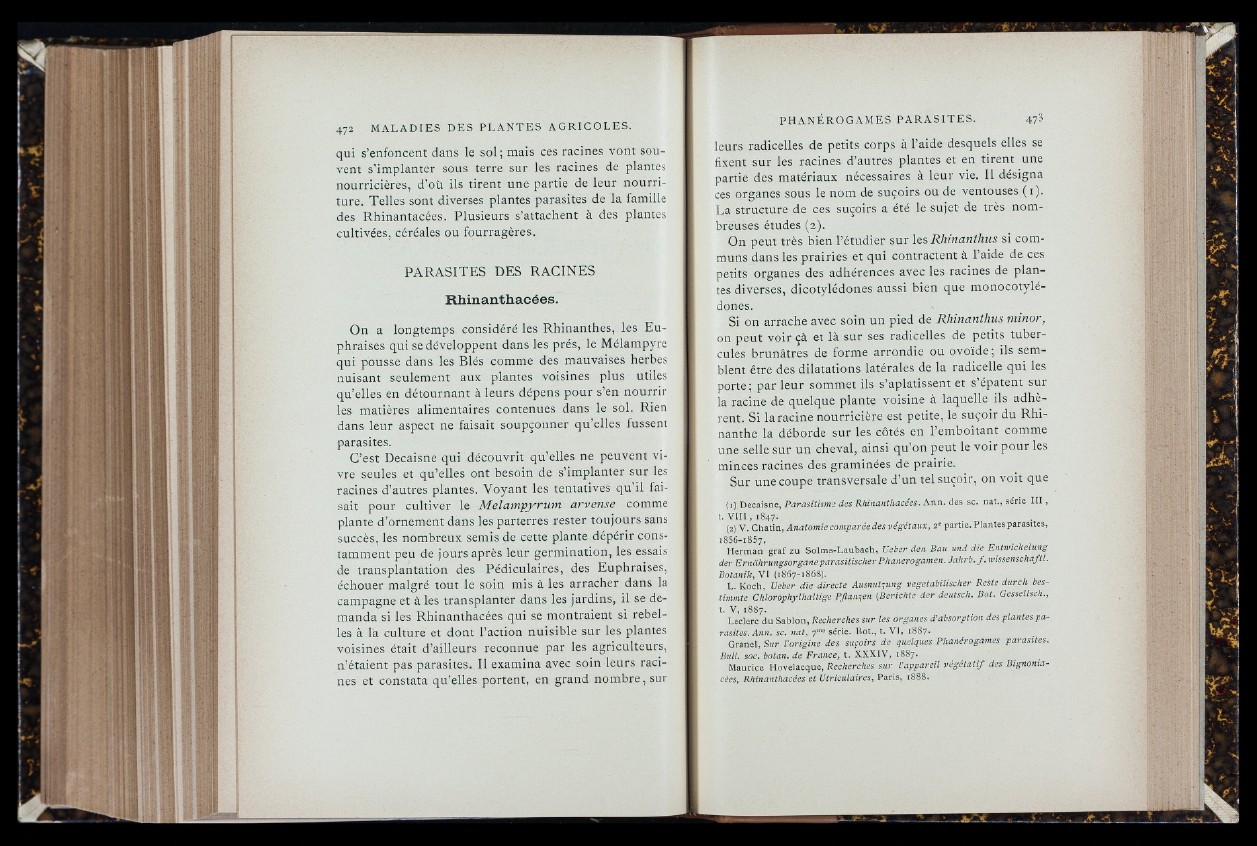
qui s’enfoncent dans le so l; mais ces racines vont souvent
s’ implanter sous terre sur les racines de plantes
nourricières, d’où ils tirent une partie de leur nourriture.
T e lle s sont diverses plantes parasites de la famille
des Rhinantacées. Plusieurs s’attachent à des plantes
cultivées, céréales ou fourragères.
P A R A S IT E S D E S R A C IN E S
Rhinanthacées.
On a longtemps considéré les Rhinanthes, les Eu-
phraises qui se développent dans les prés, le Mélampyre
qui pousse dans les Blés comme des mauvaises herbes
nuisant seulement aux plantes voisines plus utiles
qu’elles en détournant à leurs dépens pour s’en nourrir
les matières alimentaires contenues dans le sol. Rien
dans leur aspect ne faisait soupçonner q u ’elles fussent
parasites.
C’est Decaisne qui découvrit qu’elles ne peuvent v ivre
seules et qu’elles ont besoin de s’ implanter sur les
racines d’autres plantes. V oyant les tentatives qu’il faisait
pour cultiver le M e lam p y rum arvense comme
plante d’ornement dans les parterres rester toujours sans
succès, les nombreux semis de cette plante dépérir constamment
peu de jours après leur germination, les essais
de transplantation des Pédiculaires, des Euphraises,
échouer malgré tout le soin mis à les arracher dans la
campagne et à les transplanter dans les jardins, il se demanda
si les Rhinanthacées qui se montraient si rebelles
à la culture et dont l ’action nuisible sur les plantes
voisines était d’ailleurs reconnue par les agriculteurs,
n’étaient pas parasites. Il examina avec soin leurs racines
et constata qu’elles portent, en grand nombre, sur
leurs radicelles de petits corps à l’aide desquels elles se
fixent sur les racines d’autres plantes et en tirent une
partie des matériaux nécessaires à leur vie. Il désigna
ces organes sous le nom de suçoirs ou de ventouses ( i ) .
La structure de ces suçoirs a été le sujet de très nombreuses
études (2).
On peut très bien l’étudier sur \ss Rhinanthus si communs
dans les p rairies et qui contractent à l’aide de ces
petits organes des adhérences avec les racines de plantes
diverses, dicotylédones aussi bien que monocotylé-
dones.
Si on arrache avec soin un pied de Rhinanthus minor,
on peut vo ir çà et là sur ses radicelles de petits tubercules
brunâtres de forme arrondie ou ovoïde; ils semblent
être des dilatations latérales de la radicelle qui les
porte; p a r leu r sommet ils s’aplatissent et s’épatent sur
la racine de quelque plante voisine à laquelle ils adhèrent.
Si la racine nourricière est petite, le suçoir du Rhi-
naiithe la déborde sur les côtés en l’emboîtant comme
une selle sur un cheval, ainsi qu’on peut le vo ir pour les
minces racines des graminées de prairie.
Sur une coupe transversale d’un tel suçoir, 011 voit que
(1) Decaisne, Parasitisme des Rliinanthace'es. A n n . des sc. nat., série l i t ,
t. ¥ 1 1 1 , 1 8 4 7 .
(2) V . Chatin, Anatomie comparée des ve'gétaux, 2 ' partie. Plantes parasites,
t856- i 8 5 7 ,
Hermán g ra f zu So lm s-L aub ach , Ueber den Ban und die E ntmickelung
der Ern ührung sorgan epa ra sitiseh er Phanerogamen. Ja h rb . f.tv is s en sch a ftl.
Botanik, V I (1867-1868).
L . Koch, Ueber d ie directe Ausnutzung vegetabilischer Reste durch bes-
timmte Chlo ro phylhaltige PJlanzen {Berichte d e r deutsch. Bot. Gessellsch.,
t. V, 18 8 7 .
Leclerc du Sablón, Recherches sur les organes d'absorption des plantes p a rasites.
Ann. sc. nat, 7™" série. Bot., t. V I , 1887.
Granel, S u r l'o rig in e des suçoirs de quelques Phanérogames p a ra s ite s .
Bull. soc. botan. de F ran c e , t. X X X IV , 1887.
Maurice Hovelacque, Recherches sur l'a p p are il v é g é ta t if des Bign on ia-
cées, Rhinanthacées et Utriculaires, Paris, 1888.