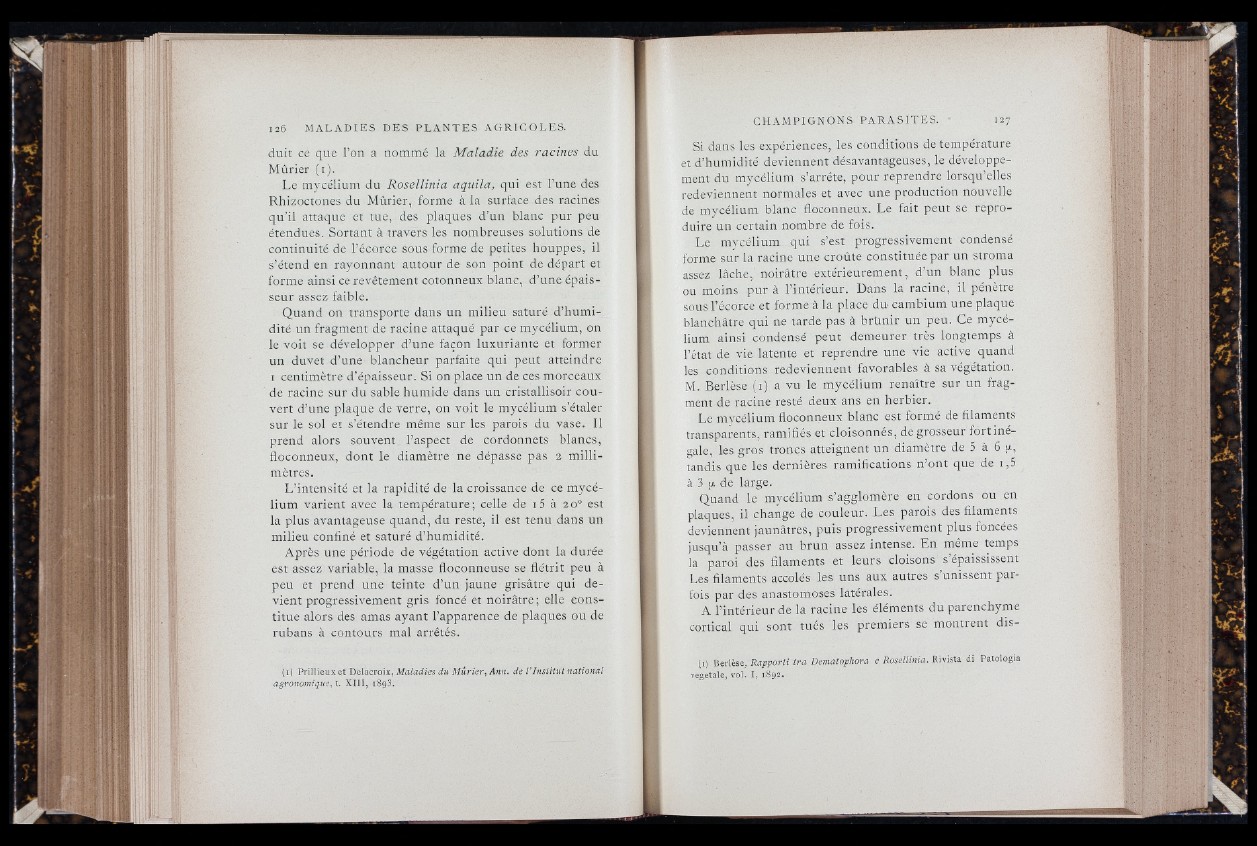
i f ®
w
11
i
i•( ri' ii’ •I, * '••■
duit ce que l ’on a nommé la Maladie des racines du
Mûrier (i).
Le mycélium du Rosellinia aquila, qui est l’une des
Rhizoctones du Mûrier, forme à la surface des racines
qu’il attaque et tue, des plaques d’un blanc pur peu
étendues. Sortant à travers les nombreuses solutions de
continuité de l’écorce sous forme de petites houppes, il
s’étend en rayonnant autour de son point de départ et
forme ainsi ce revêtement cotonneux blanc, d’une épaisseur
assez faible.
Quand on transporte dans un milieu saturé d’humidité
un fragment de racine attaqué par ce mycélium, on
le voit se développer d’une façon luxuriante et former
un duvet d’une blancheur parfaite qui peut atteindre
I centimètre d’épaisseur. Si on place un de ces morceaux
de racine sur du sable humide dans un cristallisoir couvert
d’une plaque de verre, on voit le mycélium s’étaler
sur le sol et s’étendre même sur les parois du vase. Il
prend alors souvent l’aspect de cordonnets blancs,
floconneux, dont le diamètre ne dépasse pas 2 millimètres.
L ’intensité et la rapidité de la croissance de ce mycélium
varient avec la température; celle de i 5 à 20“ est
la plus avantageuse quand, du reste, il est tenu dans un
milieu confiné et saturé d’humidité.
Après une période de végétation active dont la durée
est assez variable, la masse floconneuse se flétrit peu à
peu et prend une teinte d’un jaune grisâtre qui devient
progressivement gris foncé et noirâtre ; elle constitue
alors des amas ayant l’apparence de plaques ou de
rubans à contours mal arrêtés.
(i) Priliieu x et Delacroix, Maladies du M û r ie r , Ann. de l ’ins iitu t national
a g ronom ique ,!. X I I Î , 1893.
Si dans les expériences, les conditions de température
et d’humidité deviennent désavantageuses, le développement
du mycélium s’arrête, pour reprendre lorsqu’elles
redeviennent normales et avec une production nouvelle
de mycélium blanc floconneux. Le fait peut se reproduire
un certain nombre de fois.
Le mvcélium qui s’est progressivement condensé
forme sur la racine une croûte constituée par un stroma
assez lâche, noirâtre extérieurement, d’un blanc plus
ou moins pur à l’intérieur. Dans la racine, il pénètre
sous l’écorce et forme à la place du cambium une plaque
blanchâtre qui ne tarde pas à brünir un peu. Ce mycélium
ainsi condensé peut demeurer très longtemps à
l’état de vie latente et reprendre une vie active quand
les conditions redeviennent favorables à sa végétation.
M. Berlèse (i) a vu le mycélium renaître sur un fragment
de racine resté deux ans en herbier.
Le mycélium floconneux blanc est formé de filaments
transparents, ramifiés et cloisonnés, de grosseur fort inégale,
les gros troncs atteignent un diamètre de 5 à 6 ¡x,
tandis que les dernières ramifications n’ont que de i ,5
à 3 (X de large.
Quand le mycélium s’agglomère en cordons ou en
plaques, il change de couleur. Les parois des filaments
deviennent jaunâtres, puis progressivement plus foncées
jusqu’à passer au brun assez intense. En même temps
la paroi des filaments et leurs cloisons s’épaississent
Les filaments accolés les uns aux autres s’unissent parfois
par des anastomoses latérales.
A l’intérieur de la racine les éléments du parenchyme
cortical qui sont tués les premiers se montrent dis-
(I) Berlèse, R ap po rti ir a Dematopliora e Rosellinia. Rivista di Patologia
vegetale, vol. I, 1892.
rnm m
.0:'.
A i f t i à.i".'-’
TV;:® .v : ■<
k
0 Vi te '^..'.1
,
Y. te®'
X-4 il
- k Y : ■■'■■l Ql; - i 7•. ,.. > 7 M m