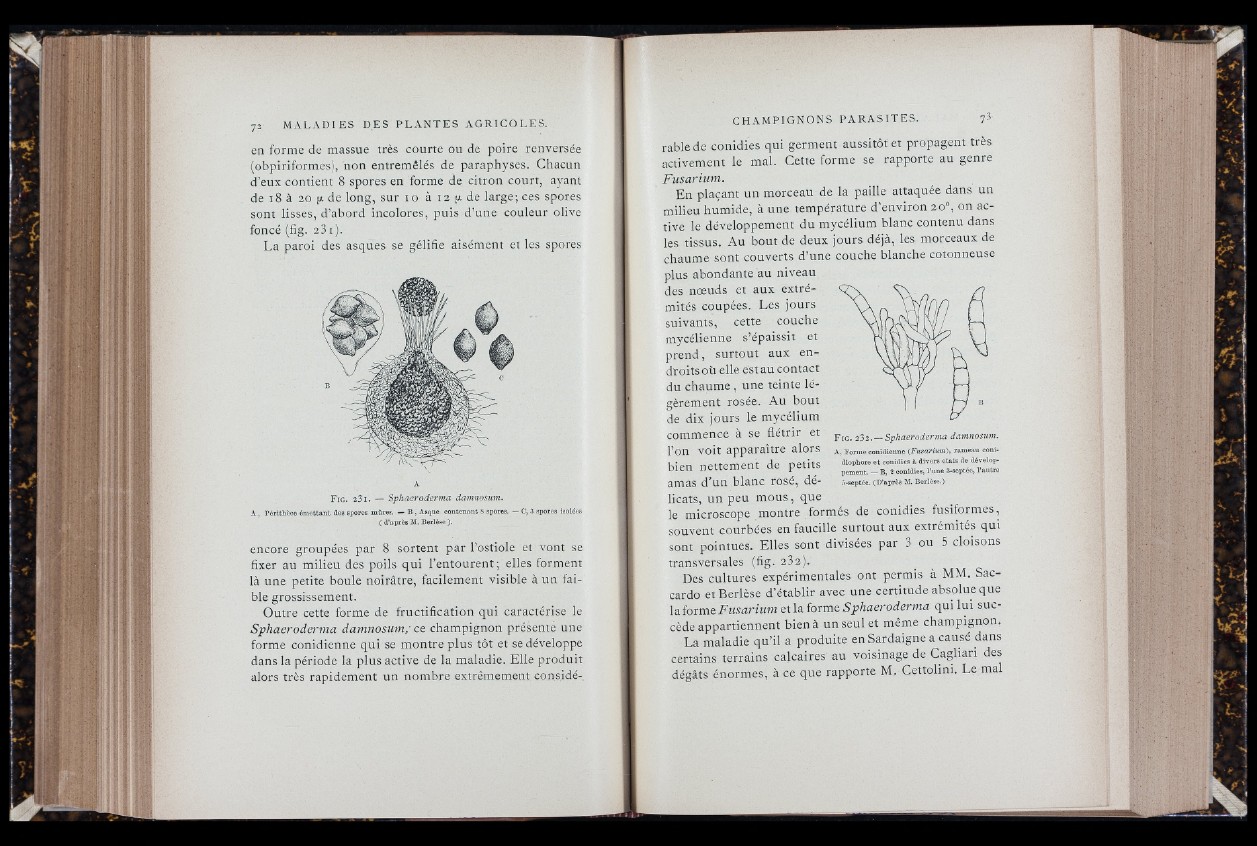
en forme de massue très courte ou de poire renversée
(obpiriformes), non entremêlés de paraphyses. Chacun
d’eux contient 8 spores en forme de citron court, ayant
de i8 à 20 ¡X de long, sur lo à 12 ¡x de large; ces spores
sont lisses, d’abord incolores, puis d’une couleur olive
foncé (fig. 2 3 1).
La paroi des asques se gélifie aisément et les spores
F ig . 2 3 i . — Sphaci'oderma damnosum.
Périthèce émettant des spores mûres. — B , Asque contenant 8 spores. — C, 3 spores
( d’après M. Berlèse ).
encore groupées par 8 sortent par l ’ostiole et vont se
fixer au milieu des poils qui l ’entourent; elles forment
là une petite boule noirâtre, facilement visible à un faible
grossissement.
Outre cette forme de fructification qui caractérise le
Sphaeroderma damnosum/ ce champignon présente une
forme conidienne qui se montre plus tôt et se développe
dans la période la plus active de la maladie. Elle produit
alors très rapidement un nombre extrêmement considérablede
conidies qui germent aussitôt et propagent très
activement le mal. Cette forme se rapporte au genre
Fitsarium.
En plaçant un morceau de la paille attaquée dans un
milieu humide, à une température d'environ 20“, on active
le développement du mycélium blanc contenu dans
les tissus. Au bout de deux jours déjà, les morceaux de
chaume sont couverts d’une couche blanche cotonneuse
plus abondante au niveau
des noeuds et aux extrémités
coupées. Les jours
suivants, cette couche
mycélienne s’épaissit et
prend, surtout aux endroits
où elle est au contact
du chaume , une teinte légèrement
rosée. Au bout
de dix jours le mycélium
commence à se flétrir et
l’on voit apparaître alors
bien nettement de petits
amas d’un blanc rosé, délicats,
un peu mous, que
F i g . 2 32. — Sphaei'oderma damnosum.
A, Forme conidieune rameau conidiophore
e t conidies à divers états de développement.
— B,2 conidies, l ’une 3-septée, l’autre
(D’après M. Berlèse.)
le microscope montre formés de conidies fusiformes,
souvent courbées en faucille surtout aux extrémités qui
sont pointues. Elles sont divisées par 3 ou 5 cloisons
transversales (fig. 232).
Des cultures expérimentales ont permis à MM. Sac-
cardo et Berlèse d’établir avec une certitude absolue que
la îo Tm e F u sa r ium e t la fo rm tS p h a e ro d e rm a qui lui succède
appartiennent bien à un seul et même champignon.
La maladie qu’il a produite en Sardaigne a causé dans
certains terrains calcaires au voisinage de Cagliari des
dégâts énormes, à ce que rapporte M. Cettolini. Le mal
" I r i l
.' Y
K 'Y ' Y r i
Yi,'tekY