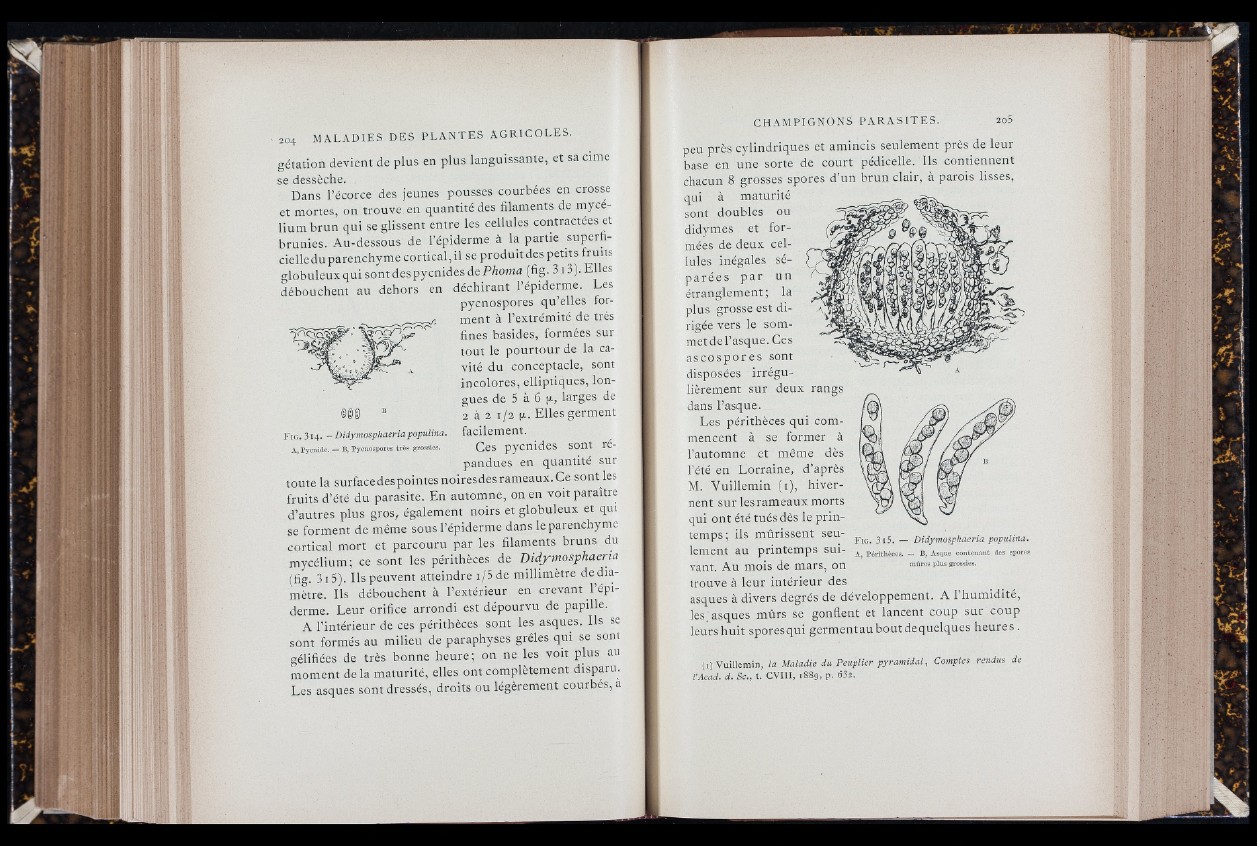
1 i-
i i1:
[V
n
i}
A
gétation devient de plus en plus languissante, et sa cime
se dessèche.
Dans l’écorce des jeunes pousses courbées en crosse
et mortes, on trouve en quantité des filaments de mycélium
brun qui se glissent entre les cellules contractées et
brunies. Au-dessous de l’épiderme à la partie superfa-
cielle du parenchyme cortical, il se produitdes petits fruits
globuleux qui sont des pycnides de Phoma (fig. 3 1 3 ). Elles
débouchent au dehors en
déchirant l’épiderme. Les
pycnospores qu’elles forment
à l’extrémité de très
fines basides, formées sur
tout le pourtour de la cavité
du conceptacle, sont
incolores, elliptiques, longues
de 5 à 6 |A, larges de
2 à 2 1 / 2 (A. Elles germent
facilement.
Ces pycnides sont répandues
en quantité sur
F i g . 3 1 4 . -D id ym o s p h a e r ia p o p u l in a .
A, Pyenidc. — B, Pycnosiioi'cs très grossies.
toute la surfacedespointesnoiresdesrameaux.ee sont les
fruits d’été du parasite. En automne, on en voit paraître
d’autres plus gros, également noirs et globuleux et qui
se forment de même sous l’épiderme d a n s le parenchyme
cortical mort et parcouru par les filaments bruns du
mycélium; ce sont les périthèces de Didymosphaeria
(fig. 3 i 5). Ils peuvent atteindre i/5 de millimètre deffia-
mètre. Ils débouchent à l ’extérieur en crevant l’épi-
derme. Leur orifice arrondi est dépourvu de papille.
A l’intérieur de ces périthèces sont les asques. Ils se
sont formés au milieu de paraphyses grêles qui se sont
gélifiées de très bonne heure; on ne les voit plus au
moment de la maturité, elles ont complètement disparu.
Les asques sont dressés, droits ou légèrement courbes, a
peu près cylindriques et amincis seulement près de leur
base en une sorte de court pédicelle. Ils contiennent
chacun 8 grosses spores d’un brun clair, à parois lisses,
qui à maturité
sont doubles ou
didymes et formées
de deux cellules
inégales sép
a ré e s p a r un
étranglement; la
plus grosse est dirigée
vers le som-
metdel’asque. Ces
a s c o sp o r e s sont
disposées irrégulièrement
sur deux rangs
dans l ’asque.
Les périthèces qui commencent
à se former à
l’automne et même dès
l’été en Lorraine, d’après
M. Vuillemin (i), hivernent
sur les rameaux morts
qui ont été tués dès le printemps;
ils mûrissent seulement
au printemps suivant.
Au mois de mars, on
, Périthèces. — B, Asque contenant des spores
mûres plus grossies.
trouve à leur intérieur des
asques à divers degrés de développement. A l’humidité,
les. asques mûrs se gonfient et lancent coup sur coup
leurshuit sporesqui germentauboutdequelques heures .
(I) Vui l lemin, la M a la d ie d u P e u p l ie r p y r a m id a l , Compte s r en d u s d e
l ’A cad . d . S c ., t. C V I I I , 1889, p. 632.
p i
i t
i l #
■•Iil
V) :
k k ';® ':
Èk fete
■j;te