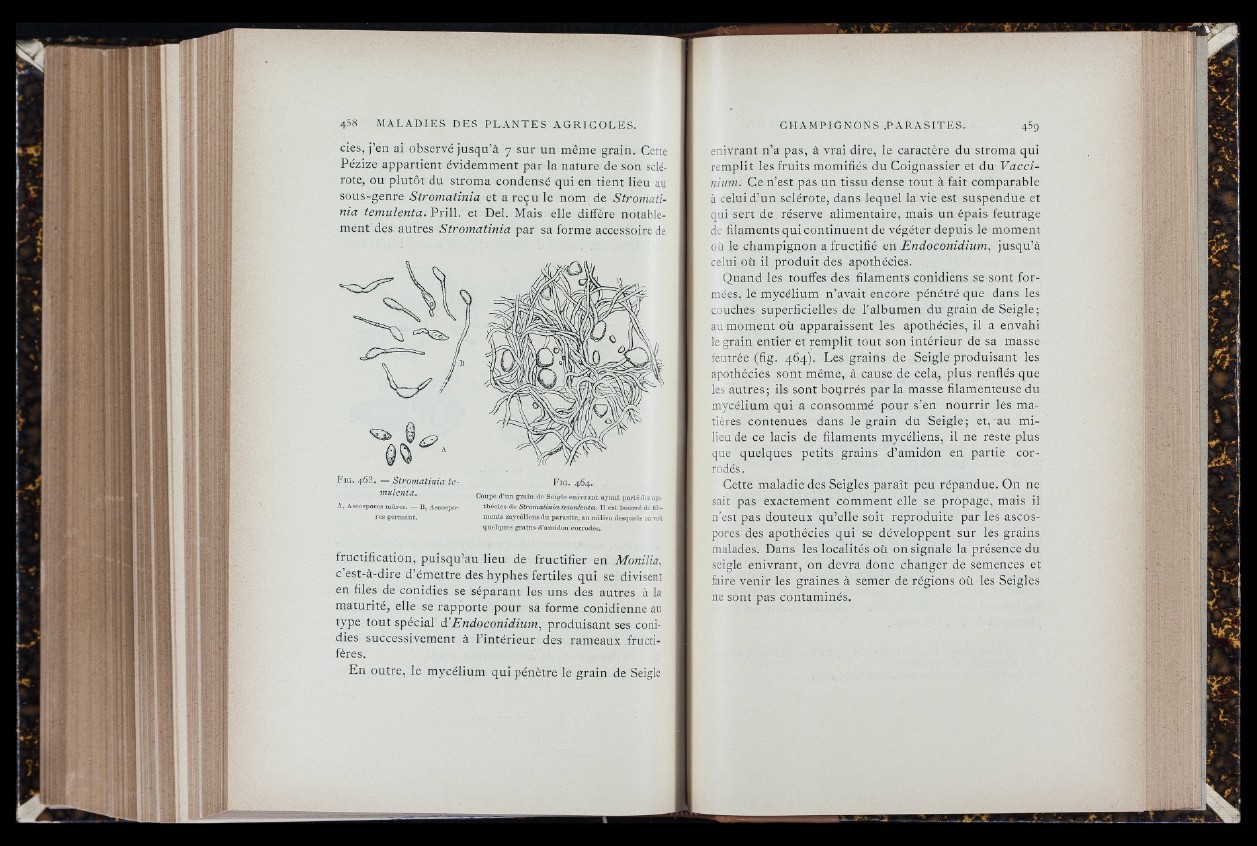
Il
cies, j’en ai observe' jusqu’à 7 sur un même grain. Cette
Pézize appartient évidemment par la nature de son sclérote,
ou plutôt du stroma condensé qui en tient lieu au
sous-genre Stromatinia et a reçu le nom de Stromatinia
temulenta. P r ill. et Del. Mais elle diffère notablement
des autres S tromatinia par sa forme accessoire de
F i g . 4 6 3 . — Stromatinia te-
millenia.
A, Aseositorea mûres. — B, Ascospores
g e rmant.
F ig . 4 6 4 .
Coupe (Viin g r a in de Seigle en iv ra n t a y a n t porté des apothécies
de Stromatinia temuUnta. I l est hourré de fila-
ments mycéliens du pa ra site , au m ilieu desquels on voit
quelques g ra in s d’amidon corrodés.
fructification, puisqu’au lieu de fructifier en Monilia.
c’est-à-dire d’émettre des hyphes fertiles qui se divisent
en files de conidies se séparant les uns des autres à la
maturité, elle se rapporte pour sa forme conidienne au
type tout spécial à ’Endoconidium, produisant ses conidies
successivement à l ’intérieur des rameaux fructifères.
E n outre, le mycélium qui pénètre le grain de Seigle
enivrant n’a pas, à vrai dire, le caractère du stroma qui
remplit les fruits momifiés du Coignassier et du V a c c inium.
Ce n’est pas un tissu dense tout à fait comparable
à celui d’ un sclérote, dans lequel la vie est suspendue et
qui sert de réserve alimentaire, mais un épais feutrage
de filaments qui continuent de végéter depuis le moment
où le champignon a fructifié en Endocotiidium, jusqu’à
celui où il produit des apothécies.
Quand les touffes des filaments conidiens se sont fo rmées,
le mycélium n’avait encore pénétré que dans les
couches superficielles de l’albumen du grain de Seigle;
au moment où apparaissent les apothécies, il a envahi
le grain entier et remplit tout son intérieur de sa masse
feutrée (fig. 464). Les grains de Seigle produisant les
apothécies sont même, à cause de cela, plus renflés que
les autres; ils sont boijrrés p a r la masse filamenteuse du
mycélium qui a consommé pour s ’en nourrir les matières
contenues dans le grain du Se igle ; et, au milieu
de ce lacis de filaments mycéliens, il ne reste plus
que quelques petits grains d’amidon en partie corrodés.
Cette maladie des Seigles paraît peu répandue. On ne
sait pas exactement comment elle se propage, mais il
n’est pas douteux qu’elle soit reproduite par les ascospores
des apothécies qui se développent sur les grains
malades. Dans les localités où on signale la présence du
seigle enivrant, on devra donc changer de semences et
faire venir les graines à semer de régions où les Seigles
ne sont pas contaminés.
■q;.. y ".. .