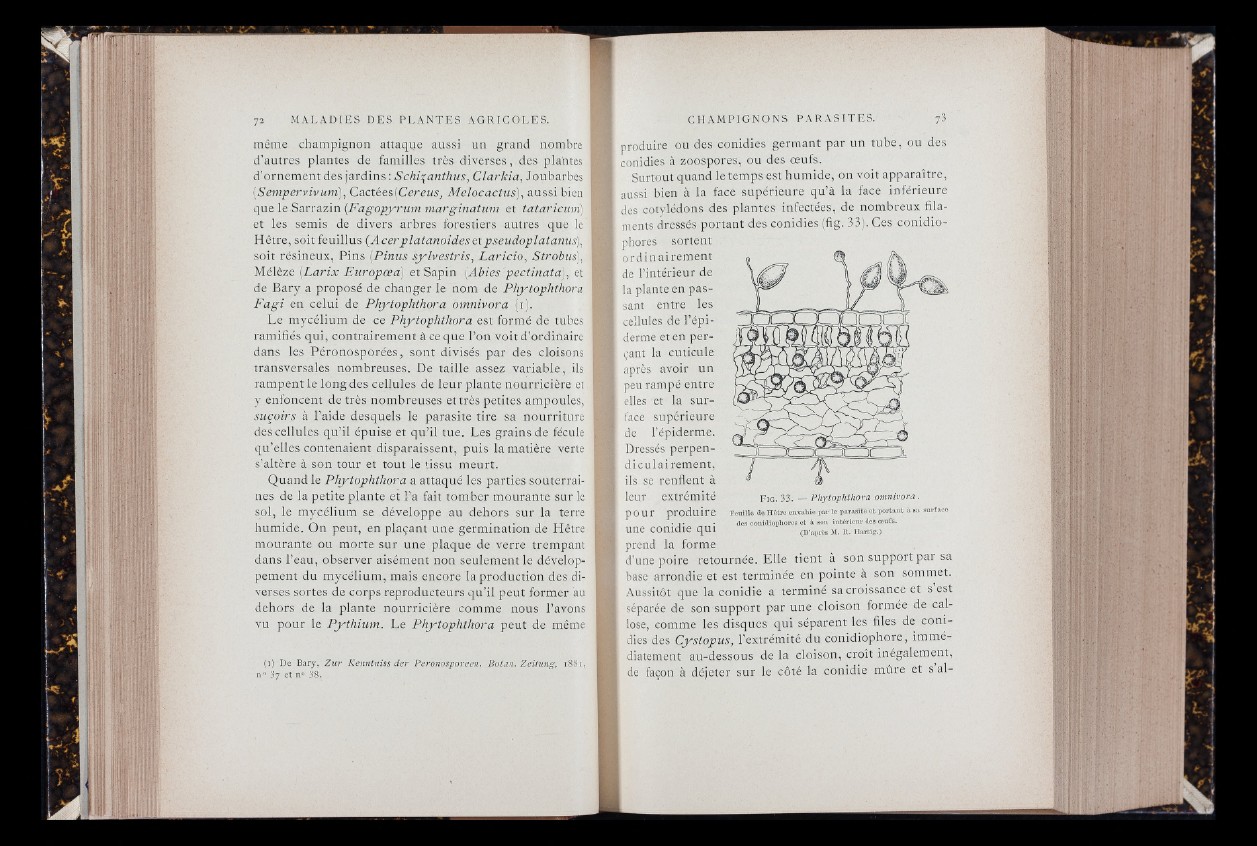
même champignon attaque aussi un grand nombre
d'autres plantes de familles très diverses, des plantes
d’ornement des jardins : Schii^anthus, Clarkia, Joubarbes
iSempervivLwi), CactéesICereus, Melocactiis), aussi bien
que le Sarrazin {Fagopyrum marginatum et tataricum]
et les semis de divers arbres forestiers autres que le
Hêtre, soit feuillus {Acerplatanoidesetpseudoplatanus),
soit résineux, Pins (Pinus sylvestris, Laricio, Strobus ,
Mélèze [L a rix Furopoea] et Sapin \Abies pectinata], et
de Bary a proposé de changer le nom de Phytophthora
F a g i en celui de Phytophthora omnivora (ih
Le mycélium de ce Phytophthora est formé de tubes
ramifiés qui, contrairement à ce que l’on voit d’ordinaire
dans les Péronosporées, sont divisés par des cloisons
transversales nombreuses. De taille assez variable, ils
rampent le long des cellules de leur plante nourricière et
y enfoncent de très nombreuses et très petites ampoules,
suçoirs à l’aide desquels le parasite tire sa nourriture
des cellules qu’il épuise et qu’il tue. Les grains de fécule
qu’elles contenaient disparaissent, puis la matière verte
s'altère à son tour et tout le tissu meurt.
Quand le Phytophthora a attaqué les parties souterraines
de la petite plante et l’a fait tomber mourante sur le
sol, le mycélium se développe au dehors sur la terre
humide. On peut, en plaçant une germination de Hêtre
mourante ou morte sur une plaque de verre trempant
dans l’eau, observer aisément non seulement le développement
du mycélium, mais encore la production des diverses
sortes de corps reproducteurs qu’il peut former au
dehors de la plante nourricière comme nous l’avons
vu pour le Pythium. Le Phytophthora peut de même
(i) De Bary, Z u r Kenntniss d e r Peronosporecn. Botan. Ze ifu n g , i8
1 ® 3 y et n® 3 8 .
produire ou des conidies germant par un tube, ou des
conidies à zoospores, ou des oeufs.
Surtout quand le temps est humide, on voit apparaître,
aussi bien à la face supérieure qu’à la face inférieure
des cotylédons des plantes infectées, de nombreux filaments
dressés portant des conidies (fig. 33). Ces conidiophores
sortent
ordinairement
de l’intérieur de
la plante en passant
entre les
cellules de l’épi-
derme et en perçant
la cuticule
après avoir un
peu rampé entre
elles et la surface
supérieure
de l’épiderme.
Dressés perpendiculairement,
ils se renflent à
leur extrémité
33. — P h y to p h th o ra om n iv o ra .
pour produire
Ifctiillc (lo TTôtrci enviiMo par le parasite et portant ii sa surCacc
une conidie qui
(les conidiophores et h son intérieur des oeufs.
(D'après M. 31. Hartig.)
prend la forme
d’une poire retournée. Elle tient à son support par sa
base arrondie et est terminée en pointe à son sommet.
Aussitôt que la conidie a terminé s a croissance et s est
séparée de son support par une cloison formée de callose,
comme les disques cqui séparent les files de conidies
des Cystopus, l’extrémité du conidiophore, immédiatement
au-dessous de la cloison, croît inégalement,
de façon à déjeter sur le côté la conidie mûre et s alFig.
. T f i ■ fi fi Si. C1 • Mr
Üf-ir
' L ii.
I l l :
îji f i , ' ,
,r:,Y f:
' Y
i '3