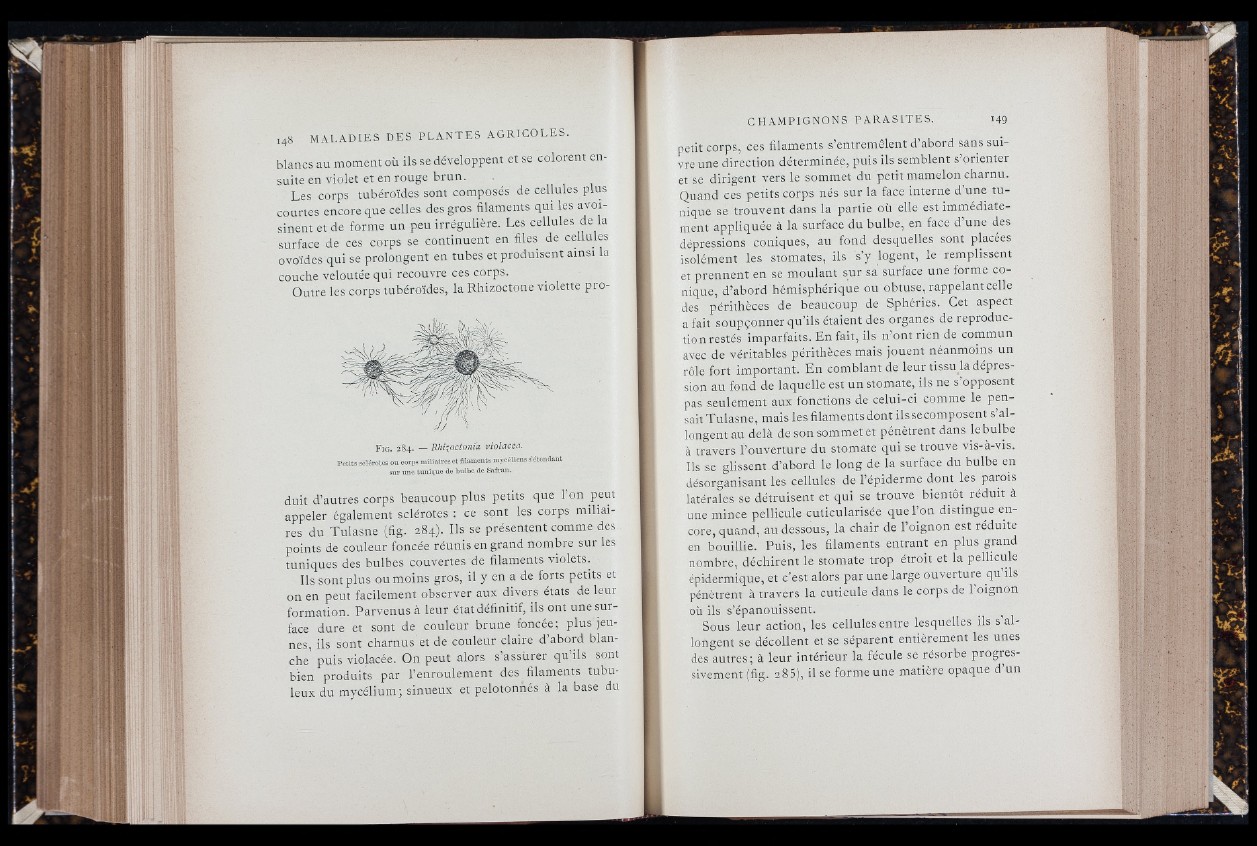
■il
î y"'*
î- i:
fi.
I
1/
blancs au moment où ils se développent et se colorent ensuite
en violet et en rouge brun.
Les corps tubéroïdes sont composés de cellules plus
courtes encore que celles des gros filaments qui les avoi-
sinent et de forme un peu irrégulière. Les cellules de la
surface de ces corps se continuent en files de cellules
ovoïdes qui se prolongent en tubes et produisent ainsi la
couche veloutée qui recouvre ces corps.
Outre les corps tubéroïdes, la Rhizoctone violette pro-
F ig . 284. — Rhizoctonia violacea.
Petits seléi-otes ou corits miliaires et filaments mycéliens s’étendant
sur une tunique de bulbe de Safran.
duit d’autres corps beaucoup plus petits que 1 on peut
appeler également sclérotes : ce sont les corps miliaires
du Tulasne (fig. 284). Ils se présentent comme des
points de couleur foncée réunis en grand nombre sur les
tuniques des bulbes couvertes de filaments violets.
Ils sont plus oumoins gros, il y en a de forts petits et
on en peut facilement observer aux divers états de leur
formation. Parvenus à leur état définitif, ils ont une surface
dure et sont de couleur brune foncée; plus jeunes,
ils sont charnus et de couleur claire d’abord blanche
puis violacée. On peut alors s’assurer qu’ils sont
bien produits par l’enroulement des filaments tubuleux
du mycélium; sinueux et pelotonnés à la base du
petit corps, ces filaments s’entremêlent d’abord sans suivre
une direction déterminée, puis ils semblent s’orienter
et se dirigent vers le sommet du petit mamelon charnu.
Quand ces petits corps nés sur la face interne d’une tunique
se trouvent dans la partie où elle est immédiatement
appliquée à la surface du bulbe, en face d’une des
dépressions coniques, au fond desquelles sont placées
isolément les stomates, ils s’y logent, le remplissent
et prennent en se moulant sur sa surface une forme conique,
d’abord hémisphérique ou obtuse, rappelant celle
des périthèces de beaucoup de Sphéries. Cet aspect
a fait soupçonner qu’ils étaient des organes de reproduction
restés imparfaits. En fait, ils n’ont rien de commun
avec de véritables périthèces mais jouent néanmoins un
rôle fort important. En comblant de leur tissu la dépression
au fond de laquelle est un stomate, ils ne s’opposent
pas seulement aux fonctions de celui-ci comme le pensait
Tulasne, mais les filaments dont ils se composent s’allongent
au delà de son sommet et pénètrent dans le bulbe
à travers l’ouverture du stomate qui se trouve vis-à-vis.
Ils se glissent d’abord le long de la surface du bulbe en
désorganisant les cellules de l’épiderme dont les parois
latérales se détruisent et qui se trouve bientôt réduit à
une mince pellicule cuticularisée que l’on distingue encore,
quand, au dessous, la chair de l’oignon est réduite
en bouillie. Puis, les filaments entrant en plus grand
nombre, déchirent le stomate trop étroit et la pellicule
épidermique, et c’est alors par une large ouverture qu’ils
pénètrent à travers la cuticule dans le corps de 1 oignon
où ils s’épanouissent.
Sous leur action, les cellules entre lesquelles ils s’allongent
se décollent et se séparent entièrement les unes
des autres; à leur intérieur la fécule se résorbe progressivement
(fig. 285), il se forme une matière opaque d’un
■ ÎkiÎ "l'i
. r ■
0 0
I ■I