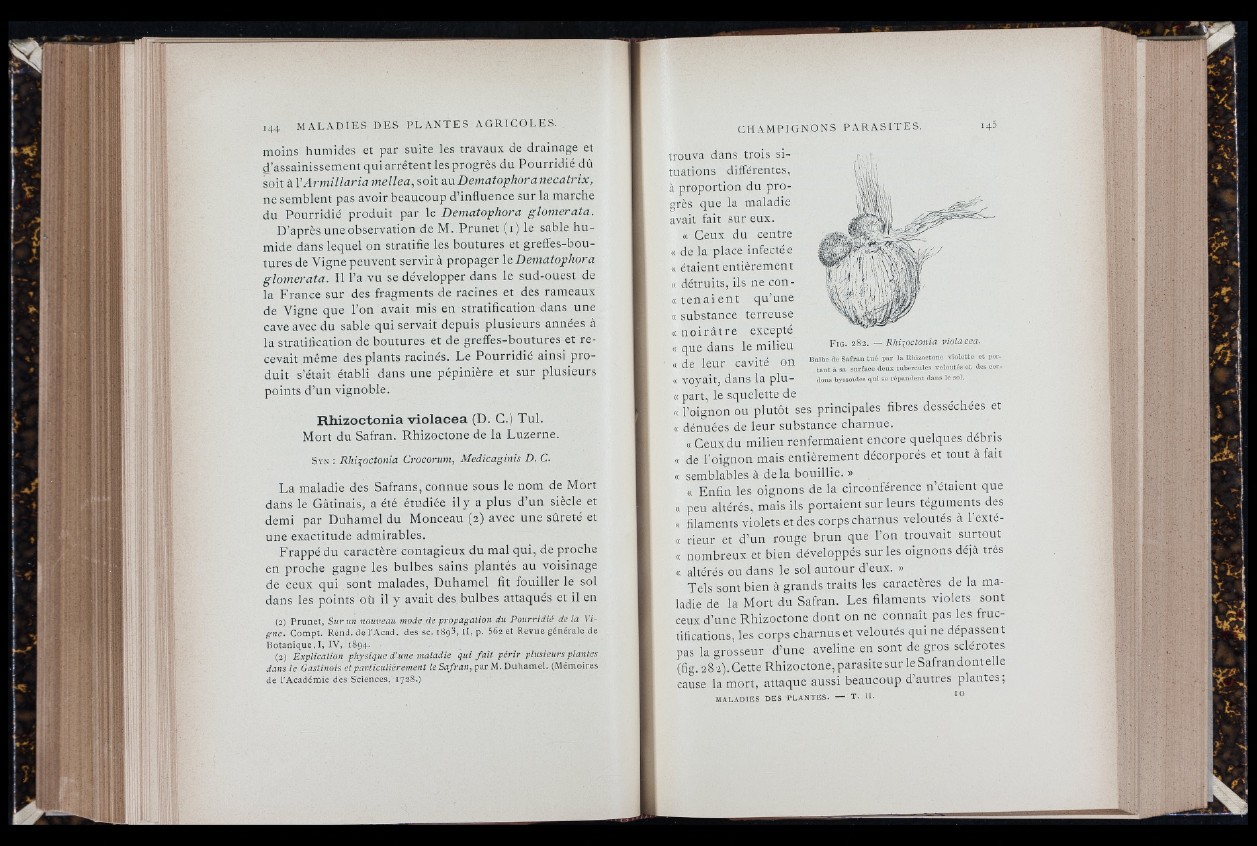
r . - M moins humides et par suite les travaux de drainage et
d’assainissement qui arrêtent les progrès du Pourridié dû
soit à VArmillaria mellea, soit auDematophoranecatrix,
ne semblent pas avoir beaucoup d’influence sur la marche
du Pourridié produit par le Dematophora glomerata.
D’après une observation de M. Prunet (i) le sable humide
dans lequel on stratifié les boutures et greffes-bou-
tures de Vigne peuvent servir à propager le. Dematophora
glomerata. Il l’a vu se développer dans le sud-ouest de
la France sur des fragments de racines et des rameaux
de Vigne que l’on avait mis en stratification dans une
cave avec du sable qui servait depuis plusieurs années à
la stratification de boutures et de greffes-boutures et recevait
même des plants racinés. Le Pourridié ainsi produit
s’était établi dans une pépinière et sur plusieurs
points d’un vignoble.
Rhizoctonia violacea (D. G.) Tul.
Mort du Safran. Rhizoctone de la Luzerne.
S y n : R h i y c t o n i a C r o c o r u m , M e d i c a g i n i s D . C .
La maladie des Safrans, connue sous le nom de Mort
dans le Gâtinais, a été étudiée il y a plus d’un siècle et
demi par Duhamel du Monceau (2) avec une sûreté et
une exactitude admirables.
Frappé du caractère contagieux du mal qui, de proche
en proche gagne les bulbes sains plantés au voisinage
de ceux qui sont malades, Duhamel fit fouiller le sol
dans les points où il y avait des bulbes attaqués et il en
(2) Prunet, S u r un nouveau mode de pro pagation du P o u r r id ié de la Vig
n e . Compt. Re n d .d e l ’Acad. des sc. i 8g3, II , p. 562 et Revue géne'rale de
Botanique, I, IV, i8g4.
(2) E xp lica tion ph y siqu e d ’une maladie qui f a i t p é r ir plusieurs p lantes
dans le Gastinois et particulièrement le S a fra n , par M. Duhamel . (Mémoires
de l’Académie des Sciences, 1728.)
trouva dans trois situations
différentes,
à proportion du progrès
que la maladie
avait fait sur eux.
et Ceux du centre
« de la place infectée
(C étaient entièrement
« détruits, ils ne con-
« t e n a ie n t qu’une
« substance terreuse
(C n o irâ t re excepté
« que dans le milieu
(C de leur cavité on
« voyait, dans la plu-
F i g . - Rhizoctonia violacea.
Bulbe de Safran tné par la Bhizoctone violette et portant
à sa surface deux tubercules veloutés et des cordons
byssoïdcs qui sc répandent dans le soi.
« part, le squelette de
« l’oignon ou plutôt ses principales fibres desséchées et
« dénuées de leur substance charnue.
« Ceux du milieu renfermaient encore quelques débris
« de l’oignon mais entièrement décorporés et tout à fait
« semblables à de la bouillie. »
cc Enfin les oignons de la circonférence n’étaient que
« peu altérés, mais ils portaient sur leurs tégument des
« f i l a m e n t s violets et des corps charnus veloutés a l’exte-
« rieur et d’un rouge brun que l’on trouvait surtout
« nombreux et bien développés sur les oignons déjà très
« altérés ou dans le sol autour d’eux. »
Tels sont bien à grands traits les caractères de la maladie
de la Mort du Safran. Les filaments violets sont
ceux d’une Rhizoctone dont on ne connaît pas les fructifications,
les corps charnus et veloutés qui ne dépassent
pas la grosseur d’une aveline en sont de gros sclérotes
(fig. 28 2). Cette Rhizoctone, parasite surle Safran dont elle
cause la mort, attaque aussi beaucoup d’autres plantes;
M A LA D IE S D E S P L A N T E S . — T . I I . 1°
f I
, à’ , t
K
1 1
f
S f i -
K f ® ■ fi-t
R v t j
,v
i : t
k- • i
t
■i l'
1
f ^