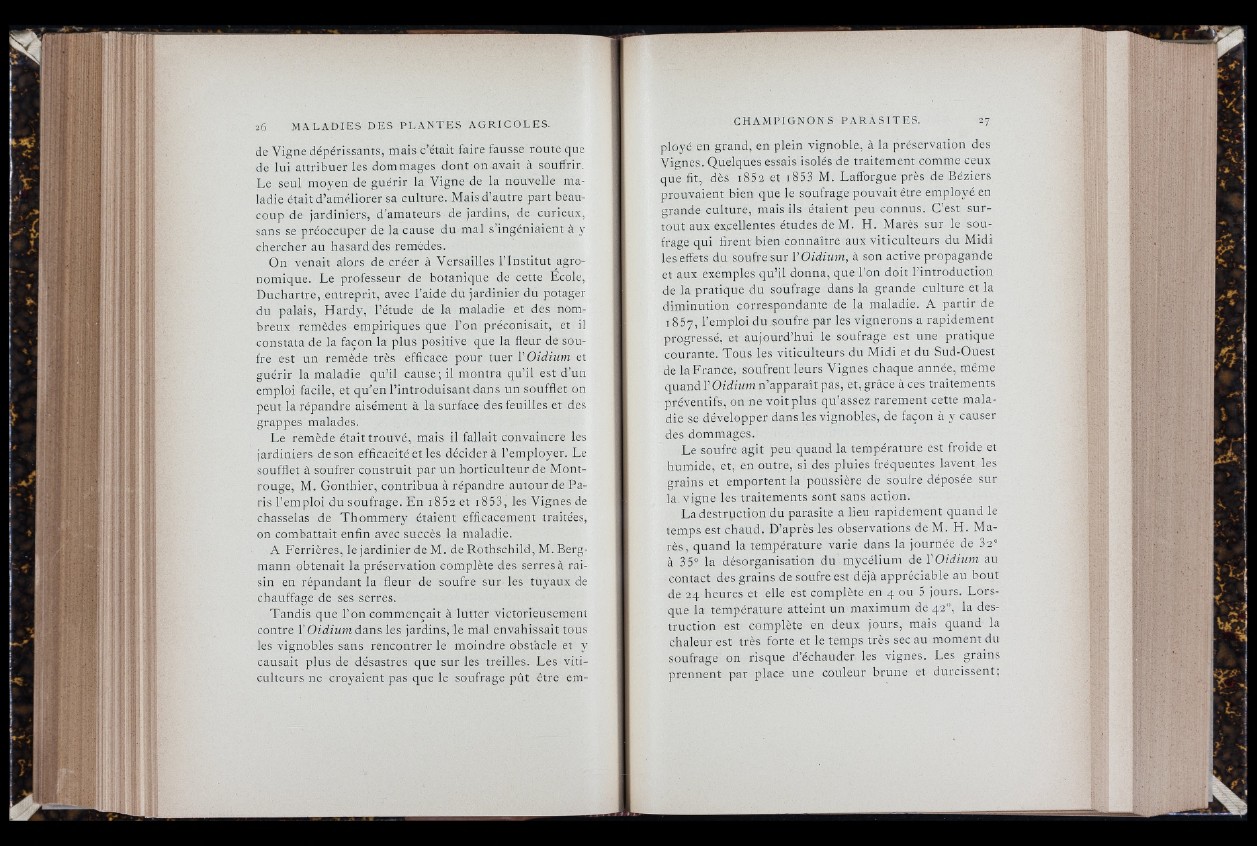
! i:
i î
i t
de Vigne dépérissants, mais c’était faire fausse route que
de lui attribuer les dommages dont on avait à souffrir.
Le seul moyen de guérir la Vigne de la nouvelle maladie
était d’améliorer sa culture. Mais d’autre part beaucoup
de jardiniers, d’amateurs de jardins, de curieux,
sans se préoccuper de la cause du mal s’ingéniaient à y
chercher au hasard des remèdes.
On venait alors de créer à Versailles l’ Institut agronomique.
Le professeur de botanique de cette Ecole,
Duchartre, entreprit, avec l ’aide du jardinier du potager
du palais, Hardy, l’étude de la maladie et des nombreux
remèdes empiriques que l’on préconisait, et il
constata de la façon la plus positive que la fleur de soufre
est un remède très efficace pour tuer V Oidium et
guérir la maladie qu’il cause; il montra qu’il est d’un
emploi facile, et qu'en l’introduisant dans un soufflet on
peut la répandre aisément à la surface des feuilles et des
grappes malades.
Le remède était trouvé, mais il fallait convaincre les
jardiniers de son efficacité et les décidera l’employer. Le
soufflet à soufrer construit par un horticulteur dé Mont-
rouge, M. Gonthier, contribua à répandre autour de Paris
l’emploi du soufrage. En 1 852 et i 8 5 3 , les Vignes de
chasselas de Thommery étaient efficacement traitées,
on combattait enfin avec succès la maladie.
A Ferrières, le jardinier de M. de Rothschild, M. Bergmann
obtenait la préservation complète des serres à raisin
en répandant la fleur de soufre sur les tuyaux de
chauffage de ses serres.
Tandis que l’ on commençait à lutter victorieusement
contre l’Oidium dans les jardins, le mal envahissait tous
les vignobles sans rencontrer le moindre obstacle et y
causait plus de désastres que sur les treilles. Les viticulteurs
ne croyaient pas que le soufrage pût être employé
en grand, en plein vignoble, à la préservation des
Vignes. Quelques essais isolés de traitement comme ceux
que fit, dès i 852 et i 853 M. Lafforgue près de Béziers
prouvaient bien que le soufrage pouvait être employé en
grande culture, mais ils étaient peu connus. C’est surtout
aux excellentes études de M. H. Marès sur le soufrage
qui firent bien connaître aux viticulteurs du Midi
les effets du soufre sur VOidium, à son active propagande
et aux exemples qu’il donna, que l ’on doit l’introduction
de la pratique du soufrage dans la grande culture et la
diminution correspondante de la maladie. A partir de
1857, l’emploi du soufre par les vignerons a rapidement
progressé, et aujourd’hui le soufrage est une pratique
courante. Tous les viticulteurs du Midi et du Sud-Ouest
de la France, soufrent leurs Vignes chaque année, même
quand l’Oidium n’apparaît pas, et, grâce à ces traitements
préventifs, on ne voit plus qu’assez rarement cette maladie
se développer dans les vignobles, de façon à y causer
des dommages.
Le soufre agit peu quand la température est froide et
humide, et, en outre, si des pluies fréquentes lavent les
grains et emportent la poussière de soufre déposée sur
la vigne les traitements sont sans action.
La destruction du parasite a lieu rapidement quand le
temps est chaud. D’après les observations de M. H. Marès,
quand la température varie dans la journée de 32°
à 35° la désorganisation du mycélium àeVOidium au
contact des grains de soufre est déjà appréciable au bout
de 24 heures et elle est complète en 4 ou 5 jours. Lorsque
la température atteint un maximum de 42", la destruction
est complète en deux jours, mais quand la
chaleur est très forte et le temps très sec au moment du
soufrage on risque d’échauder les vignes. Les grains
prennent par place une couleur brune et durcissent;