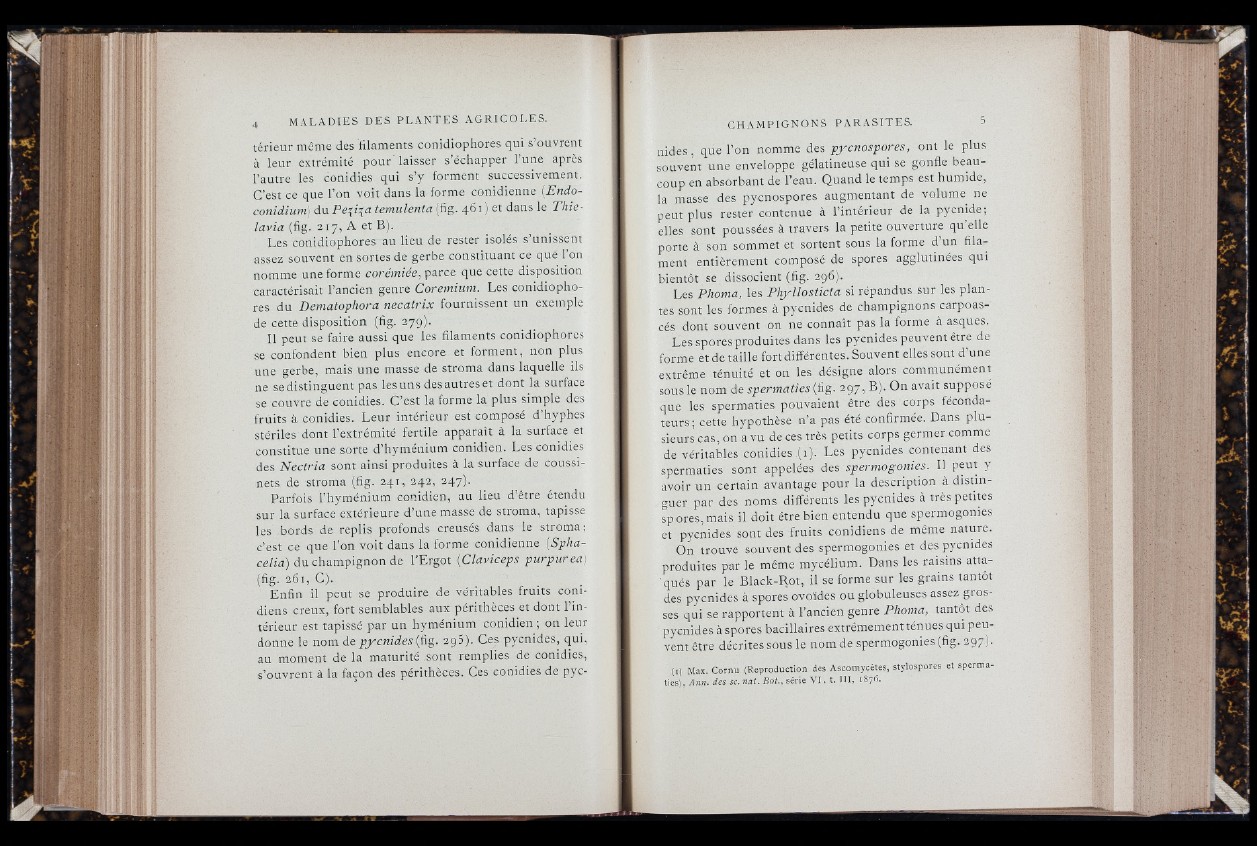
?! i f
I . ) Î if;
térieur même des filaments conidiophores qui s ouvrent
à leur extrémité pour laisser s’échapper l’une après
l’autre les conidies qui s’y forment successivement.
C’est ce que l’on voit dans la forme conidienne (Endo-
conidiunv du P e f fia temulenta (fig. 4 6 1 ) et dans le Thie-
lavia (fig. 2 17 , A et B).
Les conidiophores au lieu de rester isolés s’unissent
assez souvent en sortes de gerbe constituant ce que l’on
nomme une forme corémiée, parce que cette disposition
caractérisait l’ancien genre Coremium. Les conidiophores
du Dematopliora necatrix fournissent un exemple
de cette disposition (fig. 279).
11 peut se faire aussi que les filaments conidiophores
se confondent bien plus encore et forment, non plus
une gerbe, mais une masse de stroma dans laquelle ils
ne sedistinguent pas les uns des autres et dont la surface
se couvre de conidies. C ’est la forme la plus simple des
fruits à conidies. Leur intérieur est composé d’hyphes
stériles dont l’extrémité fertile apparaît à la surface et
constitue une sorte d’hyménium conidien. Les conidies
des Nectria sont ainsi produites à la surface de coussinets
de stroma (fig. 2 41, 242, 247).
Parfois l’hyménium conidien, au lieu d’être étendu
sur la surface extérieure d’une masse de stroma, tapisse
les bords de replis profonds creusés dans le stroma;
c’est ce que l’on voit dans la forme conidienne [Spha-
ce/ia) du champignon de l’Ergot {Claviceps purpurea)
(fig. 261, C).
Enfin il peut se produire de véritables fruits coni-
diens creux, fort semblables aux périthèces et dont l’intérieur
est tapissé par un hyménium conidien ; on leur
donne le nom d e ( f i g . 295). Ces pycnides, qui,
au moment de la maturité sont remplies de conidies,
s’ouvrent à la façon des périthèces. Ces conidies de pycnides,
que l’on nomme des pycnospores, ont le plus
souvent une enveloppe gélatineuse qui se gonfle beaucoup
en absorbant de l’eau. Quand le temps est humide,
la masse des pycnospores augmentant de volume ne
peut plus rester contenue à l’intérieur de la pycnide;
elles sont poussées à travers la petite ouverture qu’elle
porte à son sommet et sortent sous la forme d’un filament
entièrement composé de spores agglutinées qui
bientôt se dissocient (fig. 296).
Les Phoma, les Phyllosticta si répandus sur les plantes
sont les formes à pycnides de champignons carpoas-
cés dont souvent on ne connaît pas la forme à asques.
Les spores produites dans les pycnides peuvent être de
forme et de taille fort différentes. Souvent elles sont d’une
extrême ténuité et on les désigne alors communément
sous le nom de spermaties [fg. 297, B). On avait supposé
que les spermaties pouvaient être des corps fécondateurs;
cette hypothèse n’a pas été confirmée. Dans plusieurs
cas, on a vu de ces très petits corps germer comme
de véritables conidies (1). Les pycnides contenant des
spermaties sont appelées des spermogonies. 11 peut y
avoir un certain avantage pour la description à distinguer
par des noms différents les pycnides à très petites
spores, mais il doit être bien entendu que spermogonies
et pycnides sont des fruits conidiens de même nature.
On trouve souvent des spermogonies et des pycnides
produites par le même mycélium. Dans les raisins atta-
■qués par le Black-Rot, il se forme sur les grains tantôt
des pycnides à spores ovoïdes ou globuleuses assez grosses
qui se rapportent à l’ancien genre Phoma, tantôt des
pycnides à spores bacillaires extrêmement ténues qui peuvent
être décrites sous le nom de spermogonies (fig. 297).
( I ) Max. Cornu (Reproduction des Ascomycètes, stylospores et spermaties),
Ann. des sc. nat. Bot., série V I , t. I I I , 1876,
£ ,
t- I.