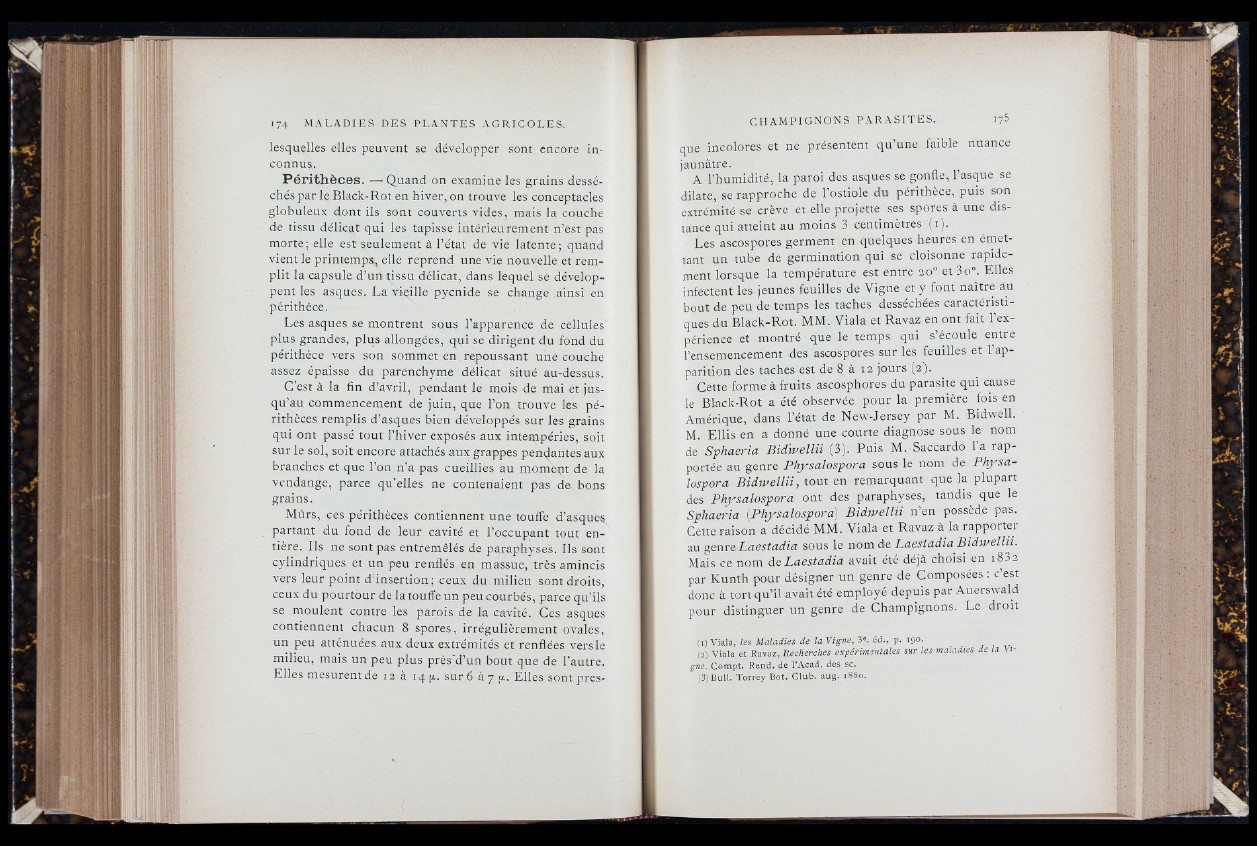
/ ' i'ïre
'i ! i J ®
Y ;
lesquelles elles peuvent se développer sont encore inconnus.
P é r i t h è c e s . — Quand on examine les grains desséchés
par le Black-Rot en hiver, on trouve les conceptacles
globuleux dont ils sont couverts vides, mais la couche
de tissu délicat qui les tapisse intérieurement n’est pas
morte; elle est seulement à l ’état de vie latente; quand
vient le printemps, elle reprend une vie nouvelle et remplit
la capsule d’un tissu délicat, dans lequel se développent
les asques. La vieille pycnide se change ainsi en
périthèce.
Les asques se montrent sous l’apparence de cellules
plus grandes, plus allongées, qui se dirigent du fond du
périthèce vers son sommet en repoussant une couche
assez épaisse du parenchyme délicat situé au-dessus.
C’est à la fin d’avril, pendant le mois de mai et jusqu’au
commencement de juin, que l’on trouve les périthèces
remplis d’asques bien développés sur les grains
qui ont passé tout l’hiver exposés aux intempéries, soit
sur le sol, soit encore attachés aux grappes pen(jantes aux
branches et que l ’on n’a pas cueillies au moment de la
vendange, parce qu’elles ne contenaient pas de bons
grains.
Mûrs, ces périthèces contiennent une touffe d’asques
partant du fond de leur cavité et l’occupant tout entière.
Ils ne sont pas entremêlés de paraphyses. Ils sont
cylindriques et un peu renflés en massue, très amincis
vers leur point d’insertion; ceux du milieu sont droits,
ceux du pourtour de la touffe un peu courbés, parce qu’ils
se moulent contre les parois de la cavité. Ces asques
contiennent chacun 8 spores, irrégulièrement ovales,
un peu atténuées aux deux extrémités et renflées vers le
milieu, mais un peu plus près'd’un bout que de l’autre.
Elles mesurent de 12 à 14 ¡a. sur 6 à 7 g. Elles sont presque
incolores et ne présentent qu’une faible nuance
jaunâtre.
A l’humidité, la paroi des asques se gonfle, l’asque se
dilate, se rapproche de l’ostiole du périthèce, puis son
extrémité se crève et elle projette ses spores à une distance
qui atteint au moins 3 centimètres (i).
Les ascospores germent en quelques heures en émettant
un tube de germination qui se cloisonne rapidement
lorsque la température est entre 20" et 3o°. Elles
infectent les jeunes feuilles de Vigne et y font naître au
bout de peu de temps les taches desséchées caractéristiques
du Black-Rot. MM. Viala et Ravaz en ont fait l’expérience
et montré que le temps qui s’ écoule entre
l’ensemencement des ascospores sur les feuilles et l’apparition
des taches est de 8 à 12 jours (2).
Cette forme à fruits ascosphores du parasite qui cause
le Black-Rot a été observée pour la première fois en
Amérique, dans l’état de New-Jersey par M. Bidwell.
M. Ellis en a donné une courte diagnose sous le nom
de S p ha e ria B id w e l li i (3). Puis M. Saccardo l’a rapportée
au genre P h y sa lo sp o ra sous le nom de P h y s a lospora
B id w e l l i i , tout en remarquant que la plupart
des P h y sa lo sp o ra ont des paraphyses, tandis que le
Sphaeria [Physalo spo ra] B id w e l li i n’en possède pas.
Cette raison a décidé MM. Viala et Ravaz à la rapporter
au g ta r tL a e s ta d ia sous le n om à t L a e sta d ia B id w e llii.
Mais ce nom à t L a e s ta d ia avait été déjà choisi en i 832
par Kunth pour désigner un genre de Composées ; c’est
donc à tort qu’il avait été employé depuis par Auerswald
pour distinguer un genre de Champignons. Le droit
(1) Viala, les M a la dies de la Vigne, 3^ éd., p. 190-
(2) Via la et Ravaz, Recherches expérimentales sur les maladies de la V®
gne. Compt. Rend, de l’Acad. des sc.
(3) Bull. Torrey Bot. Club. aug. 1880.